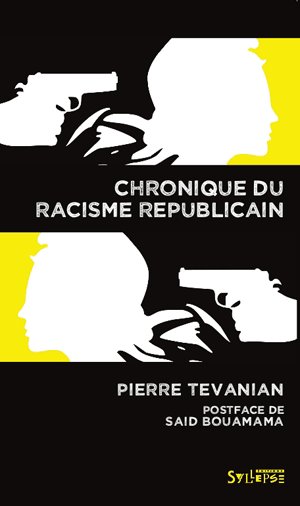
Ce que d’ordinaire on appelle l’État d’exception est une suspension du droit commun décrétée par le pouvoir souverain. Cette suspension vaut toujours pour une période et un territoire délimités – par exemple un « état d’urgence » liée à une période de guerre ou de guerre civile – mais elle s’applique à tous. Il existe en revanche une autre formulation, pour ainsi dire inverse, de l’exception, dont la délimitation n’est ni spatiale ni temporelle mais plutôt corporelle : c’est le contours de chaque corps qui constitue la frontière, de sorte que seuls certains corps – de la mauvaise couleur, du mauvais « type », enveloppés dans le mauvais tissu – sont soumis au traitement d’exception, mais en tout lieu et en tout temps.
Le pouvoir souverain n’est en somme pas seulement celui qui, selon la formule consacrée de Carl Schmitt, détient le pouvoir de décréter l’État d’exception : il est aussi celui qui, en temps normal, gère au quotidien, de manière « chirurgicale », une pluralité d’États d’exception permanents, et qui pour cela doit produire – à l’aide de discours, d’expertises, de lois, décrets et circulaires – ce que Sidi Mohammed Barkat a nommé des corps d’exception [1].
Cette production et cette gestion des corps d’exception porte un autre nom : racisme. Le racisme n’est en effet pas une simple opinion, se situant sur un terrain strictement psychologique et individuel, mais un rapport de domination, voire un mode de gouvernement : les groupes racisés ne sont pas simplement perçus et pensés par des « citoyens à part entière » comme des citoyens « entièrement à part », ils sont aussi, dans le même mouvement, traités d’une manière particulière. Cette différence, qu’il convient de qualifier plutôt d’inégalité de traitement (dans la mesure où elle consiste toujours à maltraiter, défavoriser, reléguer, discriminer), se traduit très concrètement par le déni de droit ou a minima par l’inégalité des droits et des chances – la chance par exemple, quand on est noir ou arabe, de trouver un emploi ou un logement, ou le droit, quand on est musulmane et qu’on porte un foulard, d’aller à l’école publique.
L’intérêt de la notion de corps d’exception est précisément là : en renvoyant explicitement au concept politique d’État d’exception, elle permet de rappeler sans équivoque possible que le racisme, y compris sous ses formes les plus et quotidiennes et populaires, n’est pas un réflexe naturel de peur face à une différence elle-même naturelle [2], mais plutôt le produit d’une construction juridique, politique et étatique – par exemple, pour ce qui concerne le racisme anti-noir, anti-arabe ou antimusulman contemporain : le système colonial puis les politiques publiques dites d’immigration ou d’intégration.
C’est de cette production institutionnelle du racisme que traitent les textes retenus dans ce recueil : discriminations légales dans l’accès à l’emploi (cf. « Revers inopiné »), « lois d’exception » [3] conçues sur mesure pour cibler un groupe bien particulier (cf. « Voiles noirs, masques blancs »), Justice d’exception dérogeant à toutes les garanties ordinaires en termes notamment de présomption d’innocence (cf. « Chronique d’un lynchage annoncé » et « Les mots de Pontoise »), violence et impunité policière (cf. « Pour le Malien », « Disproportion, crime, émotion » et « Omerta dans la polis »).
La production étatique du racisme prend aussi la forme d’un travail idéologique de production d’une « image du corps d’exception » [4] : « débat » sur l’identité nationale (cf. « Cinq belles réponses à une vilaine question »), matraquage médiatique et construction, à l’aide de sondages et de commentaires autorisés, d’une « opinion » qui n’est « pas prête » pour la moindre avancée de l’égalité de traitement (cf. « Retour de flamme ») – et qui est en revanche « prête », et même « demandeuse », pour des mesures répressives et régressives (cf. « Pour 100% des musulmans, les sondages sont une menace »). Sans oublier le travail spécifique des petits et grands clercs qui veulent nous habituer à incriminer les victimes du racisme, coupables de « racisme anti-blanc » (cf. « Les nouveaux souchiens de garde »), et réciproquement à compatir avec les racistes (cf. « La souffrance du lepéniste »).
Si cette production institutionnelle du racisme est de longue date (depuis le Dictionnaire de la lepénisation des esprits [5], co-écrit en 1998 avec Sylvie Tissot) au coeur de mes réflexions, c’est en réaction à une tout autre analyse, qui prédomine encore dans l’espace officiel du commentaire politique autorisé : le racisme, quand il n’est pas purement et simplement nié, n’est attribué qu’à un bas peuple immature et mal éduqué, que des élites éclairées, au sein ou en dehors de l’appareil d’État, se doivent à la fois d’écouter, de rassurer et de réformer en douceur.
Cette vision repose sur une double réduction : d’une part la réduction du racisme à ses manifestations électorales (et plus précisément à sa manifestation électorale la plus évidente, le vote Front national), et d’autre part la réduction de l’électorat Front national à sa composante ouvrière et chômeuse (qui est en réalité très loin d’avoir le poids qu’on lui prête [6]). Au-delà du caractère très partiel et partial de l’analyse officielle du vote lepéniste, il convient donc de rappeler que le racisme ne s’exprime pas que dans les urnes – et que ce ne sont pas des membres du Front national qui, dans les ministères et au parlement, conçoivent et votent des lois xénophobes sur l’entrée et le séjour des étrangers ou des lois d’exception ciblant « le voile ». Que ce ne sont pas non plus de simples électeurs qui organisent – et « couvrent » en cas de « bavure » – les rafles de sans-papiers ou les descentes de police « musclées » dans les quartiers dits sensibles. Que ce ne sont pas nécessairement des électeurs FN – et en tout cas certainement pas ceux d’entre eux qui sont ouvriers ou chômeurs – qui pratiquent la discrimination à l’embauche, dans l’emploi ou dans le secteur du logement. Et que ce ne sont pas davantage des ouvriers ou des chômeurs lepénistes qui tiennent salon de TF1 à Arte, de RTL à France Culture et du Parisien au Nouvel Observateur, en agitant continuellement le spectre du « clandestin », de l’« islamiste » ou de la « racaille » banlieusarde et basanée.
Il ne s’agit pas, en rappelant tout cela, de fantasmer une classe populaire immaculée, indemne de tout racisme – mais simplement de lui retirer le monopole de l’infamie que lui ont généreusement réservé les classes dirigeantes, d’en relativiser la portée au regard de la force de frappe autrement plus lourde que détiennent un patron, un bailleur, un policier, un juge ou un enseignant racistes, et enfin de relier les formes populaires que prend le racisme (essentiellement des injures, des agressions physiques, et parfois effectivement le vote lepéniste) à l’incitation et à la légitimation permanente que lui adressent, en parfaits pompiers pyromanes, les plus honorables professeurs de « valeurs de la République ». Je reviens d’ailleurs sur cette dialectique entre « le haut » et « le bas » dans l’un des textes de ce recueil (« Pour 100% des musulmans, les sondages sont une menace »), en soulignant le caractère performatif des productions discursives autorisées (en l’occurrence les sondages d’opinion), qui finissent par façonner des subjectivités et par générer des comportements effectivement racistes, dans toutes les couches de la population.
Ce travail de décentrement, du peuple lepéniste vers le « racisme qui vient d’en haut » (comme nous l’avions appelé en 1998 dans le Dictionnaire de la lepénisation des esprits), a d’ailleurs commencé, ces trois dernières années, à devenir audible dans des sphères presque grand public où il n’avait jusque-là pas eu droit de cité (les pages « Opinions » du Monde ou de Mediapart, ou certaines émissions comme « Ce soir ou jamais » sur France 3), porté par quelques figures médiatiques nouvelles et « issues de l’immigration » comme Maboula Soumahoro ou Rokhaya Diallo [7], mais aussi par quelques « grands noms » du monde intellectuel [8].
Cette émergence progressive d’une autre grille d’analyse fait incontestablement partie des aspects intéressants et encourageants d’une période qui n’en compte pas beaucoup. Les années 2010, 2011 et 2012 qui sont celles que couvre ce recueil ont en effet été caractérisées par ce qu’il est convenu d’appeler une surenchère, voire un emballement du racisme d’État : c’est au début de l’année 2010 que le fameux « débat sur l’identité nationale », lancé officiellement en octobre 2009, atteint son acmé en termes de « bruit médiatique » et de « petites phrases » bêtes et méchantes, et c’est au même moment qu’est tout aussi bruyamment et méchamment « discutée » puis votée la loi anti-niqab – tandis que le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux multiplie les rafles contre les Gens du voyage, en incriminant explicitement « la délinquance roumaine ».
C’est enfin le 30 juillet 2010 que Nicolas Sarkozy prononce son fameux discours de Grenoble sur « l’insécurité », qui marque le début d’une interminable pré-campagne présidentielle quasi exclusivement consacrée à la stigmatisation de « l’immigration » et de « l’Islam ». Voiles, menus halal, « prières de rue » : le moindre fait divers, le moindre résidu d’islamité « ostensible », tout et n’importe quoi finit par être élevé, avec le concours irresponsable d’une presse et d’une télévision privées de tout recul, au rang de « problème de société » et de « préoccupation des Français ».
C’est cet emballement que racontent, pour ainsi dire, les treize textes retenus dans ce recueil. Rédigés « à chaud » tout au long de ces trois années, ils s’arrêtent, en les analysant, sur treize moments significatifs d’une période singulière, qui aura vu le racisme d’État atteindre une radicalité inédite – au point, comme l’a formulé avec justesse Saïd Bouamama, de faire « éclater » le « verrou idéologique » hérité de la lutte contre le nazisme :
« La prétention de l’État à définir une identité nationale a été, à juste titre, considérée depuis 1945 comme appartenant à une logique de pensée fascisante et à une pratique étatique assumant et revendiquant une xénophobie d’État. Il y a donc une dimension de rupture dans l’introduction officielle de l’identité nationale comme prérogative de l’appareil d’État. Il ne faut jamais sous-estimer les effets de l’éclatement d’un verrou idéologique quand bien même celui-ci se limiterait à la sphère symbolique. La disparition d’un verrou idéologique libère et autorise, invite et incite, légitime et rend utilisable, des termes et des concepts, des logiques de pensées et des modes de raisonnement, jusque là prohibés par l’état du rapport des forces. (…) Que l’on constate que la prohibition antérieure ne signifie pas la disparition complète de ces pratiques ne change rien à la situation : bien qu’existantes elles étaient de fait limitées par le verrou en question. » [9]
Saïd Bouamama a parfaitement raison de prêter attention aux singularités, aux aléas, aux évolutions et même aux ruptures qui s’opèrent au sein d’un même régime politique, au sein d’un même État, au milieu même d’un même mandat présidentiel, plutôt que de se complaire dans cette facilité théorique et militante trop répandue qui consiste à ressasser, avec la morgue du professeur de radicalité à qui on ne la fait pas, que « la République a toujours été coloniale » et qu’il n’y a pas de « mieux » ou de « pire » en la matière puisque, dixit Frantz Fanon, « une société est raciste ou ne l’est pas », point barre. Mais il a tout autant raison lorsqu’il met en garde contre l’écueil inverse, qui est la sous-estimation du « pôle invariances » :
– « Se centrer sur le pôle invariances, c’est sous-estimer l’ampleur et donc les conséquences de ce qui est enclenché par l’explosion du verrou. »
– « Sous-estimer le pôle invariances, c’est se contenter, comme beaucoup l’ont fait, de critiquer la rupture sans jamais interroger les racines qui l’ont rendue possible. » [10]
Un long épilogue revient, à la fin du livre, sur ce « pôle invariances », en soulignant le caractère ancien, profond, systémique, du racisme républicain – et en répertoriant tout ce qui, de cet héritage, survit à la défaite et au départ de Nicolas Sarkozy. Mais un point peut dès à présent être souligné : ledit « pôle invariances » est déjà présent, au moins en creux ou en puissance, dans chacun des treize épisodes qui composent ma « chronique ».
D’abord parce que plusieurs des problèmes abordés – comme les emplois réservés ou l’impunité policière – préexistent de beaucoup à l’avènement du sarkozysme.
Ensuite parce que si la plupart de ces épisodes a eu pour point de départ une initiative du pouvoir UMP, et si certaines desdites initiatives sont à l’évidence allées dans le sens de l’« explosion du verrou », elles l’ont fait presque toujours sans rencontrer, de la part de l’opposition de gauche, de véritable opposition et de véritable contre-discours, à la hauteur de la situation. Je le souligne dans chacun de ces textes : des emplois réservés à l’impunité policière en passant par le scandaleux « Procès de Villiers-le-Bel », c’est le silence et la passivité qui ont prédominé à gauche – et parfois même à l’extrême gauche.
Au-delà de ce consentement passif, c’est parfois un véritable consensus droite-gauche, une véritable connivence qui peut être observée – en particulier pour ce qui concerne l’islamophobie, qu’elle prenne la forme d’une défense de la liberté d’expression (cf. « La liberté d’expression n’est pas à défendre, elle est à conquérir ») ou d’une défense de la condition féminine (cf. « Voiles noirs masques blancs »).
Tantôt suiviste, tantôt avant-gardiste, une certaine gauche travaille même activement à disqualifier des revendications antiracistes ou à populariser des thématiques racistes : c’est par exemple un groupuscule fasciste qui assigne en justice Houria Bouteldja pour « racisme anti-blanc », mais c’est un journal farouchement anti-sarkozyste (Marianne) et un écrivain de gauche (Mouloud Akkouche) qui valident le chef d’inculpation et confirment la culpabilité de l’intéressée – et c’est un mouvement antiraciste historique (le MRAP) qui finit par adopter, par un vote de congrès, ce vocable directement issu de l’extrême-droite (cf. « Les nouveaux souchiens de garde »). C’est aussi une journaliste se réclamant de la gauche (Caroline Fourest), notoirement engagée contre le candidat Sarkozy et pour le candidat Hollande, qui publie dans les colonnes du Monde un ahurissant concentré de rhétorique réactionnaire destiné à enterrer une nouvelle fois la promesse socialiste d’un droit de vote pour les étrangers (cf. « Retour de flamme »).
Il est significatif enfin que, des cinq contre-mots d’ordre que j’oppose en ouverture de ce recueil à la vision sarkozyste de l’identité nationale, aucun n’émane des grandes organisations politiques, syndicales ou associatives qui assurent officiellement la représentation du « peuple de gauche » (cf. « Cinq belles réponses à une vilaine question »). C’est des marges et d’elles seules qu’est venue jusqu’à présent une véritable opposition – et il en va malheureusement de même sur la plupart des questions abordées dans ce livre.
Cette opposition réelle n’est pas forcément négligeable numériquement, mais elle demeure dispersée et surtout peu visible, politiquement, dans l’espace public officiel tel que le délimitent quelques grands partis et quelques grands médias. Il reste que d’innombrables collectifs ont résisté et continuent de le faire, du GISTI au Réseau Éducation Sans Frontières, des Indivisibles à Mamans Toutes Égales, de l’Association des Travailleurs Maghrébins de France au Forum Social des Quartiers Populaires, de la Brigade Anti-Négrophobie au Collectif Contre l’Islamophobie en France, des TumulTueuses au Collectif des Féministes Pour l’Égalité, sans oublier bien entendu la multitude des Coordinations de Sans-papiers et des Comités Vérité Justice qui se forment autour des victimes d’homicides policiers. C’est à tous ces groupes que l’on doit la visibilité et l’intelligibilité du racisme d’État dont voici la chronique, et c’est en toute logique à eux que je dédie ce livre – ainsi qu’aux millions d’étrangers ou de « mauvais Français » qui, de mille façons, endurent et combattent l’exception au pluriel et au quotidien.


