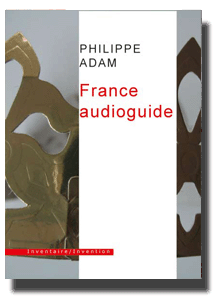
Le peintre ne peint pas sur une toile vierge, ni l’écrivain n’écrit sur une page blanche, mais la page ou la toile sont déjà tellement couvertes de clichés préexistants, préétablis, qu’il faut d’abord effacer, nettoyer, laminer, même déchiqueter pour faire passer un courant d’air issu du chaos. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la Philosophie ?, Editions de Minuit, 1990
DOUCE FRANCE, aux extraits naturels de plantes, sodium, aqua, glycerin, vaseline, alcohol, etidronic acid, benzyl salicylate, prunus, citronnellol, eugenol, petrolatium, ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants, éviter tout contact avec les yeux. Philippe Adam, France audioguide, Inventaire-Invention, 2007
Il y a plusieurs manières de s’opposer littérairement à Nicolas Sarkozy. La première est ce qu’on appelle le pamphlet, la déclaration de haine – car assurément cet homme, la politique qu’il mène, les intérêts qu’il défend, les valeurs et l’imaginaire qu’il véhicule, les mots qui sortent de sa bouche, ses intonations, sa voix, sa gestuelle, ses regards, ses sourires – ses rictus – et sa démarche, bref tout ce qu’il représente, cette arrogance, ce culte de l’argent et des puissants, cette exaltation du sentiment national, ce dégoûtant amour de la France, ces minables rêves de grandeur, ces rappels à l’ordre, au travail, à la famille et à la patrie, ce mépris pour tout ce qui n’est pas blanc, masculin, marié, chef de famille et d’entreprise, toute cette politique, cette éthique et cette esthétique microfasciste [1] qu’il met en œuvre et en scène dans la moindre de ses paroles, la moindre de ses mimiques, le moindre de ses haussements d’épaule, le moindre de ses râclements de gorge, ne mérite rien d’autre qu’une profonde, légitime, indiscutable haine. Une haine sacrée, qui devrait être sublimée, esthétisée, chantée interminablement par les plus grands poètes tant que la bête immonde n’est pas terrassée.
Mais on peut aussi se détourner de cette haine juste et nécessaire, ignorer la personne de Nicolas Sarkozy et combattre par le réalisme. Le principe est simple : Nicolas Sarkozy assoit son pouvoir sur le mensonge et l’occultation du réel, par conséquent le simple fait de montrer le réel constitue un acte de résistance. Le simple fait de raconter la vraie vie des ouvriers, des immigrés, des femmes, des musulmans, de leurs voisins blancs, des chômeurs, des précaires, des mal-logés, des cheminots, des grévistes, des filles voilées exclues de l’école, des émeutiers, des détenus ou de tous ceux qu’on nomme les délinquants, le seul fait de raconter l’abjection que furent la conquête et l’empire colonial, le seul fait de raconter dans un récit, un roman, une chronique, un carnet de voyage, ce qu’est vraiment aujourd’hui la vie d’un paysan malien, d’une paysanne malienne, d’un citadin Sénégalais, d’une Togolaise, d’une Camerounaise, dans leurs pays ou en France, le simple fait de montrer ce qu’est vraiment la vie d’un Irakien ou celle d’une Palestinienne, constitue un acte de résistance contre la mythologie libérale et coloniale sarkoziste [2].
France audioguide emprunte un autre chemin. Nulle mention de Nicolas Sarkozy, nulle description du chômage, de la précarité, de la violence policière ou des expulsions de sans-papiers – d’autres livres s’en chargent, et ils ne sont pas inutiles. Ici, il ne s’agit pas d’attaquer Nicolas Sarkozy sur ce qu’il dit ou fait, ni de dire ce qu’il ne dit pas, ni de montrer ce qu’il s’évertue à cacher. Il s’agit de s’emparer des objets sarkoziens – et plus précisément du plus sarkozien des objets [3] : cette abstraction à la fois vide et trop pleine qu’est la France, avec ses déclinaisons : la terre, le terroir, le patrimoine, la légende dorée, les Grands Hommes – et de produire, avec ces objets, une autre rhétorique et d’autres affects : autre chose que la fameuse fierté d’être français. Comme certains philosophes, sociologues, historiens ou activistes luttent pour démythifier, décoloniser, désétatiser et dénationaliser non seulement l’histoire de France mais aussi les politiques publiques et les rapports sociaux actuels, Philippe Adam est de ceux qui, en usant des moyens spécifiques de la littérature, travaille à démythifier et dénationaliser notre vie imaginaire et affective, et notamment notre rapport le plus intime, et en apparence – trompeuse – le moins médiatisé par le politique, au pays et au paysage, à la patrie et au patrimoine.
France
Il est en effet des mots qu’on ne peut, dans certaines situations historiques, manier à sa guise, des mots qui nous projettent qu’on le veuille ou non dans le politique : par exemple le mot Juif dans la France de 1940, ou le mot Esclave dans un pays esclavagiste. Même si ces mots ne sont pour nous que des métaphores, même si nous prétendons ne pas faire de politique, même si nous refusons d’en faire, même si très sincèrement nous nous situons ailleurs, même si par exemple nous brodons littérairement sur le thème du Juif Errant dans un conte philosophique, ou si nous parlons du judaïsme d’un point de vue théologique, le simple fait d’employer le mot Juif et de le faire en 1940, alors qu’une politique antijuive criminelle se déploie à très grande échelle, nous positionne d’office dans un camp politique : résistance ou collaboration. Soit l’usage littéraire que nous faisons du mot Juif déconstruit et démolit la mythologie raciste des nazis et de leurs collaborateurs, soit il la nourrit, soit il ne fait ni l’un ni l’autre mais alors ce désengagement prend, dans un tel contexte, la signification d’une dénégation, d’un consentement, d’une complicité avec le pire.
Il en va de même pour le mot France : nous avons atteint depuis plusieurs mois un tel niveau dans la névrose nationale que l’emploi de ce mot dans un texte littéraire – et a fortiori dans son titre – est nécessairement politique : l’écrivain qui parle de la France à la fin des années 2000 ne peut être que sarkoziste ou antisarkoziste, il n’y a pas de milieu. Est-ce chez Philippe Adam une conviction, une conscience, une intuition ? En tout cas il le sait manifestement, et ce que dans son livre il fait – nous allons voir comment – du signifiant France est, l’air de rien, profondément et joyeusement antisarkoziste.
Audioguide
En ce temps-là l’air n’était ni trop chaud, ni trop froid…
En ce temps-là les saisons étaient douces…
Ici tombèrent nos amis…
Ici s’élevaient les ruines d’un temple…
Ici étaient deux statues…
Ici se trouvait la place où…
C’est dans cette rue que…
Ainsi débute chacun des soixante et onze fragments qui composent le livre. Tantôt en quelques lignes tantôt en quelques pages, chacun de ces fragments nous projette sur un site – le mot revient à plusieurs reprises, dans l’audioguide de Philippe Adam comme dans tout audioguide qui se respecte. Car, comme son nom l’indique, ce n’est pas d’un roman qu’il s’agit mais d’un audioguide, c’est-à-dire d’un texte destiné à être lu, enregistré et écouté, à l’aide d’un casque audio, à l’occasion d’une visite de – de quoi donc, au fait ? De la France, justement. L’ensemble du paysage est visité, rien ne manque : jardins, peupliers, fontaines, églises, chapelles, cimetières, cellules des Carmélites, tavernes, ateliers des artisans, arrière-cours, pensionnat des jeunes filles, stade municipal, courts de tennis, mairie, tribunal, guillotine, remparts de la ville, toilettes publiques. Et comme dans tout audioguide digne de ce nom, chaque lieu est un lieu de mémoire. Chaque lieu, comme on dit dans les audioguides, a une histoire. Nous voici donc conviés à revivre la fête des blés, la fête des vins, les fêtes de la nouvelle année, les fêtes foraines, les foires, les combats de monstres et d’animaux, les pèlerinages, les tournois de football, l’inauguration du canal, la messe du dimanche, le mariage de la petite et autres récits de hauts-faits ou de bons mots.
De cette matière, on peut faire beaucoup de choses, le meilleur et le pire. Guide Vert, Guide Michelin, Lonely Planet, Gérard de Nerval [4], Marcel Pagnol, Jean-Pierre Pernaut, Nicolas Sarkozy… On peut être folklorique, patriotique, épique, poétique, bucolique, mélancolique. On peut aussi produire tout autre chose, en injectant à doses variables, au coeur du patrimoine et de « l’identité nationale », des violentes décharges d’inquiétante étrangeté. C’est ce que propose cet audioguide très singulier.
Inventaire / Invention
Ce faisant, l’audioguide remplit, plus consciencieusement qu’aucun des autres livres qui la composent, le cahier des charges de la collection Inventaire / Invention, dans laquelle il est publié. Car c’est bel et bien un inventaire qu’il dresse – un état des lieux, des paysages, des bâtiments, des monuments , des ruines, des fouilles archéologiques même – mais ces lieux sont inventés, comme sont inventés les personnages et les anecdotes qui s’y rattachent et qui en constituent, dans les deux sens du mot, la légende.
Comme beaucoup d’inventaires – ceux de Prévert, ceux de Perec, ceux de Boris Vian ou de Nino Ferrer – l’inventaire de Philippe Adam est souvent comique. Par l’excès dans l’énumération, par l’hybris dans le souci de précision et d’exhaustivité, par l’attention scrupuleuse au détail insignifiant, par les juxtapositions incongrues, il nous fait rire. Et comme il s’agit d’un inventaire inventé, un autre ressort comique est activé, un ressort assez classique mais qui fonctionne parfaitement ici : il consiste à inventer des noms de famille, de villages, de lieux-dits, de forêts, des histoires, des anecdotes, dont le caractère fictif voire invraisemblable est ostensible mais qui présentent par ailleurs tous les attributs de la vérité la plus triviale, parmi lesquels : la banalité et la profusion de détails inutiles. Le rire naît, assez mécaniquement, de cette contradiction, de ce choc entre la vérité la plus vraie et la fiction la plus fictive – tout sonne à la fois faux et « trop vrai », faux parce que trop vrai, trop beau et trop vrai pour être vrai – mais il naît aussi de la distorsion entre l’énoncé – des noms qui nous sont parfaitement inconnus, et pour cause puisqu’ils sont fictifs – et l’énonciation – ces noms sont évoqués comme s’ils étaient connus de tous. Qu’on nous permette donc ici de présenter les héros de France Audioguide : Madame Kerguelec, Madame Le Saznec, les Mignard, Emilie Granlay, Pierre Lepetit, Émile Lecat, Clément Curieux, Raymond Roulaud, Hyppolite Le Fol, Antoine Chardonnet, Jean-René Maxime, Germain Loison, le Vicomte René Édouard de Villiers du Terrage, les ingénieurs Desmoulins et Néchaux, Raoul Fulgent, Geneviève Saint-Prix, Juliette Millepoix, le roi Alfred VII et le prince Eugène XVIII.
Ces noms de personnages sont par ailleurs comiques en eux-mêmes, tant ils sont non seulement vraisemblables mais aussi profondément et caricaturalement français. Sans doute ce rire est-il un peu bête, mais justement, rire bêtement de la France, en France, en 2009 – je veux dire : sous Nicolas Sarkozy – est une activité très intelligente, une véritable ascèse, un salutaire exercice d’hygiène personnelle et de salubrité publique.
Déception
La première phrase, celle qui ouvre la visite guidée, est au sens fort la matrice de tout ce qui va suivre :
À cet endroit furent entreprises des fouilles qui ne donnèrent pas grand-chose, confirmant l’intuition de ceux qui ne s’étaient jamais demandé ce qu’il pouvait y avoir en dessous.
La plupart des étapes suivantes de la visite fonctionnent suivant un même dispositif déceptif : solennité des deux ou trois premiers mots de la phrase, promesse d’un récit édifiant – en l’occurrence : promesse d’une découverte archéologique, et du récit épique à laquelle renverrait la pièce découverte – puis une fin de phrase qui opiniâtrement s’évertue à nous faire déchanter – par exemple, ici : les fouilles ne donnent rien. Le site 4, de la même manière, suit un lent decrescendo :
Ici s’élevaient les ruines d’un temple qui eut peut-être ses fidèles, ses adeptes et ses curieux mais où, de toute façon, plus personne n’allait et dont il ne reste rien, aujourd’hui, absolument rien, le visiteur découvrant peu à peu un espace vide, plat, offrant une vue bien dégagée sur la ville.
Quand il n’est pas devenu vide, le lieu visité s’avère inhospitalier, ou sans intérêt, ou un peu petit – les remparts de la ville sont par exemple décrits, avec une fierté qui ne dissipe pas loin s’en faut le ridicule, comme une Muraille de Chine miniaturisée – et ce qu’on apprend en fin de compte de chacun de ces lieux, c’est qu’il ne s’y est à peu près rien passé, ou rien d’intéressant, en tout cas rien de glorieux :
Ici la ville investit 5 sous pour un baquet à laver les cottes de maille, 40 pour la réparation des brancards, 12 pour l’entretien des jardins de l’évêché ainsi qu’une subvention spéciale accordée pour nettoyer et aérer les sarcophages, suite aux plaintes et récriminations des voisins. (Site 20)
Sauf erreur, le 10 avril 1903, la ville comptait 1 604 chevaux, 1 mulet, 37 ânes, 10 moutons, 6 truies et 50 jeunes porcs, 6 taureaux bientôt en âge de se reproduire et de combattre (Site 23)
Au 7bis de la rue Couronne vécut Germain Loison, dont tout le monde aimait la compagnie. (site 49)
Il arrive que la déception soit encore plus radicale puisque sur certains sites, comme le 31, il ne se passe absolument rien :
Ici, les yeux clos, dorment des rois, et allongées tout contre leur dépouille des reines attendent, attendent, elles attendent, jetant parfois un coup d’œil aux gisants les plus proches pour voir si, de leur côté, il ne se passerait pas de temps en temps quelque chose.
L’audioguide en vient même à nous raconter ce qui aurait pu avoir lieu mais n’a finalement pas eu lieu – et qui n’a pas eu lieu pour des raisons elle mêmes sans grandeur ni intérêt :
Ici aurait dû s’étendre la fête foraine qui fut interdite après que le conseil municipal eut jugé, à quinze voix contre sept, que le mélange des montagnes russes, des gaufres, de la grande roue, des chichis et des barbes à papa, constituait un danger pour la santé publique. (Site 33)
Ou bien il nous raconte ce qui a eu lieu mais est tellement navrant – par exemple : le mariage de la petite – qu’il vaut mieux parler de ceux qui n’en furent pas que de ceux qui en furent :
On avait invité le frère, qui ne vint pas, l’oncle et sa femme, retenus pour cause d’un marché près de Provins, des amis de la petite qui se trouvaient malades le jour de la cérémonie (…) (Site 17)
L’audioguide ne cesse donc de nous suggérer qu’il n’y a au fond, sur la France, rien à raconter – comme si la phrase d’ouverture avait valeur de métaphore, l’intuition juste consistant bien à ne pas se demander ce qu’il peut bien y avoir là-dessous. Si l’on doit résumer à grands traits, la France n’a pas mieux à nous proposer, en guise de grands hommes, que des voisins, des parents, des petits commerçants, des notables locaux ou des absents, en guise de grandes actions il n’y a que la routine – le travail, la messe, les mariages, la fête de Nouvel An – et en guise de bons mots ou de sentences méritant l’immortalité ne subsiste que la parole la plus vulgaire, dans tous les sens du terme – ce qu’il y a de plus commun, ce qu’il y a de plus trivial, ce qu’il y a de plus grossier :
Alors là, franchement, heureusement qu’il y a des gens comme vous ! entendit-elle ici même, le site devenant à juste titre célèbre pour la qualité, la douceur et l’amabilité de ses voix. (Site 37)
C’est là, précisément là, dans ces toilettes municipales à présent protégées, classées et interdites au public, que fut écrit pour la première fois Merde à celui qui lira, trouvaille souvent reprise, jamais égalée. (Site 50)
Tout s’avère de toute façon pas terrible, pas glorieux, pas joli-joli, en deçà de nos espérances ou en tout cas de la promesse implicite que porte tout audioguide. Tout est moins grand que prévu, moins propre même, et moins sérieux :
Un bouquet de fleurs fanées porté juste à hauteur de l’endroit où, sur sa chemise, il y avait une tache, Justin donna ici rendez-vous à Paulette, qui ne vint pas, cherchant comme elle l’écrivit le soir même dans son journal intime daté du 13 août 1920, à rencontrer plutôt des garçons sérieux. (Site 40 )
C’est en somme tout le drame français qui se rejoue de page en page, de phrase en phrase, et même souvent à l’intérieur de la phrase : ça commence comme du mythe national et ça finit en comédie bouffonne, en brève de comptoir ou en ragot villageois, en tout cas en eau de boudin ou en ce que vous voulez mais toujours en beaucoup plus petit et en beaucoup moins reluisant que ça avait commencé. Et c’est cette déception, ou plutôt la répétition mécanique de cette déception, qui, comme dans un Buster Keaton ou un Laurel et Hardy, provoque le rire. Nous rions en lisant l’audioguide comme nous pouvons parfois rire, lors d’une soirée, quand un convive s’enferre au-delà du raisonnable dans des efforts aussi pathétiques que vains pour amuser l’assistance, ou dans le récit interminable d’une histoire qui n’a strictement aucun intérêt. Un rire plutôt bête et méchant, là encore, mais irrésistible et salutaire en ces temps de nationalisme exacerbé, vu que c’est ici la France qui tient le rôle du fâcheux, du convive ridicule, pas drôle et pas intéressant.
Dans cette mécanique, il y a toutefois de la variation, donc de la littérature. Comme dans un Columbo, où l’on connaît dès l’ouverture le coupable et où seule nous captive la question de savoir comment le socratique inspecteur va l’amener à se démasquer, nous comprenons très vite en lisant l’audioguide que le cher pays de notre enfance n’est pas bercé de tendre insouciance, qu’il est même immanquablement et désespérément décevant, mais une véritable incertitude renaît, à chaque page, sur chaque nouveau site, quant à la nature de la déception, c’est-à-dire quant aux formes de la négation – va-t-on tomber sur du rien ou sur du presque rien, ou bien du petit, du médiocre, du mesquin, du dégoûtant, du sordide, du morbide ? – et quant à ses modalités et son rythme – la déception vient-elle par décharge fulgurante, dès les premiers mots de la phrase (1), s’insinue-t-elle au contraire tout au long du paragraphe, par progression (2) ou par effet d’accumulation (3), ou nous tombe-t-elle dessus sur le mode du coup de théâtre, en fin de visite, dans les derniers mots de la dernière phrase d’un paragraphe qui avait presque réussi à nous élever au-dessus du marasme (4) ?
– (1) Ici glissa Juliette Millepoix, dont la jambe gauche se brisa, laissant la malheureuse boiteuse et à jamais seulette, perpétuellement triste, portant un regard mauvais sur toute chose, à commencer par cette maudite jambe qu’elle devrait dorénavant porter plus qu’elle ne la porterait. (Site 65)
– (2) En ce temps-là les saisons étaient douces, tellement qu’on les sentait passer comme des caresses, des mains qui peu à peu se faisaient plus nombreuses, plus douces, plus nombreuses et plus lourdes, et chaque année plus lourdes, et chaque année plus nombreuses, pesantes au point qu’on finissait par doucement s’incliner, voyant de plus près la terre, voyant de plus près le sol, et bientôt ne voyant plus rien, s’allongeant alors pour se laisser une dernière fois câliner. (Site 26)
– (3) Passé au détecteur de métaux, le site regorgeait de petites pièces jaunes et de petites pièces blanches salies, souillées et légèrement verdies par le temps, pièces qui furent toutes soigneusement numérotées, lavées puis passées à la brosse, laquelle découvrait à chacun de ses mouvements davantage du front dégarni d’un homme au visage affreux, traversé d’une longue cicatrice allant du sommet du crâne à la base du nez où ses deux yeux stupidement louchaient. (Site 9)
– (4) Il a regardé devant lui, a regardé derrière puis, voyant qu’il n’y avait personne, il s’est arrêté au 5 de cette même rue, a cette fois regardé à droite, regardé à gauche avant de se décider à sonner en priant pour qu’on lui ouvre vite, ce qui advint, pas aussi vite qu’il l’aurait souhaité mais quand même, vite, et là, prenant les airs d’un prophète offrant à Dieu tous ses troupeaux, d’un ministre remettant une légion d’honneur ou d’un premier communiant s’offrant corps et âme à la Sainte Vierge, il a tendu trois billets de 1 000 à Melle Gilberte avant de passer au bidet comme tout le monde. (Site 32)
Temps perdu
Il existe différentes manières de célébrer le banal, le quotidien, le petit et l’insignifiant, soit en le grandissant artificiellement, en s’armant de considérations philosophiques – La grandeur n’est pas là où on le croit, la vraie vie est ici-bas, il y a plus dans un sourire d’enfant que dans tous les livres, rien ne vaut une petite marche, pieds nus sur le sable [5] – soit en inventant une petite musique censée en restituer le charme [6]. L’audioguide, au contraire, ne sort pas l’insignifiant de son insignifiance : la petitesse reste sans charme, la mort rôde un peu partout et le travail du négatif a ceci de particulier – et, là encore, d’antisarkozien – qu’il ne produit aucune dialectique et aucun dépassement. Le négatif n’est pas un simple moment voué à être dépassé, la souffrance n’est pas un moyen nécessaire pour atteindre une joie plus profonde, la destruction n’est pas le prélude d’une reconstruction, la mort n’ouvre sur aucune résurrection. Travailler plus n’est pas gagner plus mais perdre plus sa vie à la gagner. Et quand par miracle tout se passe à peu près bien, on ne décolle pas de la plus profonde médiocrité et du plus mortel ennui. La fête villageoise se déroule par exemple
sans incident notable, le maire lisant bien son discours, mais peut-être un peu trop lentement, l’eau coulant dans le bon sens, mais peut-être un peu trop vite, les vannes s’ouvrant et se refermant à leur rythme qui fut jugé parfois trop rapide, parfois trop lent, et la fanfare ayant de son côté joué ses morceaux sans fausse note, ou presque… (Site 57)
Au moins, alors, cette médiocrité pourrait-elle produire une jouissance nostalgique, ne serait-ce que dans certains segments socio-économiques, ethniques et générationnels du lectorat – Ah, moi aussi j’ai joué à la marelle sur la place du village avec un clocher, moi aussi les terrasses, la fraîcheur des fontaines, l’ombre des treilles aux senteurs de myrtille, le crépitement d’un bon vieux feu de bois, l’odeur de la craie blanche sur le tableau noir, la messe, les discours du Maire, mon premier amour, ma première surprise-partie… – comme en produisent, même si ce n’est pas leur objectif unique, le Je me souviens de Georges Perec et ses différentes déclinaisons. Il n’en est rien. Aucun effet-madeleine proustien dans l’audioguide, ou plus exactement : aucun effet-madeleine qui ne soit aussitôt gâté, comme si la madeleine était rassie au point d’être immangeable. Il faut imaginer France audioguide comme une réminiscence proustienne ratée, un Je me souviens foireux qui ne produirait que de la déception ou du malaise – mais encore une fois d’une manière tellement systématique et mécanique que l’expérience devient burlesque. Une Recherche du temps perdu détraquée, prenant plaisir à décrire une jeune femme
filant aux toilettes, prise d’un petit écœurement qu’elle soulageait, ses doigts fins caressant du bout des ongles la glotte, les amygdales, l’œsophage d’où remonteraient une à une, en masses compactes, gluantes et glaireuses, des barres de chocolat aux amandes, aux raisins, à la pâte d’amande, aux noisettes,à la menthe, au lait, praliné, à l’orange, au nougat, au vomi. (Site 31)
En cela l’audioguide rappelle De beaux restes, le premier roman de Philippe Adam, qui déjà nous montrait un revival complètement détraqué, déréglé et morbide [7]. Le message est finalement analogue : le revival de la grandeur de la France est tout aussi improbable, pathétique, glauque, foiré que l’était dans De beaux restes le revival du vrai tango à l’ancienne. Max Gallo [8] a beau multiplier les manifestes aux titres aussi explicites que ridicules (L’âme de la France ! Une histoire de la Nation, des origines à nos jours ! Fier d’être français ! L’Amour de la France expliqué à ma fille ! Même Philippe Adam n’aurait pas osé), il nous inspire, en lieu et place du rêve et de l’élan qu’il voudrait générer, le même effroi mêlé de pitié que le délire du narrateur cancéreux, en phase terminale, du premier roman de Philippe Adam.
Ensemble, tout n’est pas possible
Ensemble tout devient possible nous ment Nicolas Sarkozy. Riches ou pauvres, patrons ou employés, nous devons tous nous unir entre Français, et cette union engendrera des miracles [9]. Dans l’audioguide, non seulement tout n’est pas possible ensemble, mais on pourrait même dire : il n’est pas possible du tout d’être ensemble. Toutes les possibilités de vie commune ont l’air d’avoir été épuisées, chacun semble épuisé par son prochain, nous ne sommes de toute façon pas ensemble et nous ne l’avons jamais été. Divisions, chamailleries, jalousies, humiliations publiques, rancoeurs privées, haines remâchées, fourberies, traquenards, guet-apens, empoisonnements, c’est tout le refoulé du Tous ensemble sarkozien qui réapparaît – et c’est par là que l’audioguide retrouve, à sa façon, l’option réaliste :
On s’ennuyait avec eux. Dans cette façon si particulière qu’on avait de les saluer en leur demandant des nouvelles qu’ensuite on n’écoutait pas, dans cette précipitation qu’avaient leurs interlocuteurs à leur donner raison, à ne pas leur rendre leurs invitations (…) ils sentaient bien qu’entraient le désir de fuir, l’envie de les rayer de la carte, de les jeter par-dessus bord, eux, les cinquièmes roues d’un carosse qui, chaque jour, leur passait sur les pieds. (Site 38)
Arrière-cours où s’étendaient le linge et les arrière-pensées, et la petite du second file un mauvais coton, disait Mme Kerguelec, mais celle du troisième ne vaut pas mieux, répondait Mme Le Saznec, on l’aurait vu traîner près des étangs en bonne compagnie, et pas seulement près des étangs, aussi derrière la gare, ajoutait une autre, et pas seulement en bonne compagnie, aussi en très mauvaise compagnie, disait une autre (…) (Site 23)
Tavernes dont nul ne sortait indemne, soit que la tête tourne au point de donner des nausées accompagnées de renvois et d’hallucinations, soit que l’argent faisant subitement défaut, l’envie d’un dernier godet s’en trouve on ne peut plus contrariée, de violentes querelles opposant alors les convives qui sortaient les fourches et se menaçaient de leurs couteaux à bois, de leurs serpes, ou tout simplement de leurs mains, qu’ils avaient petites, rougeaudes et trapues comme des verges. (Site 6)
Dans ces pages, c’est à Freud que nous fait penser Philippe Adam – le Freud du Malaise dans la civilisation, prenant un évident plaisir à froidement nous rappeler les mauvaises pensées, la cruauté, la pulsion d’agression qui perdurent sous le vernis de la civilisation :
Combats de monstres et autres curiosités, cirques où s’affrontaient des taureaux et des chiens, où l’on venait en famille voir le spectacle de sangliers lutter contre des ours, des coqs se crever les yeux, où l’on misait sur des duels de bouledogues, espérant qu’au passage on serait les témoins de l’accident qui emporterait la main du dresseur dans la gueule du tigre, du contretemps qui laisserait l’éleveur désemparé au milieu de ses taureaux furieux et prêts à charger, rêvant que le toréador se fasse étriper ou qu’un ours un peu moins pataud que les autres s’échappe, monte les gradins et s’ouvre la voie dans le public à grands coups de pattes, grandes giclées de sang. (Site 24)
Ici se trouvait la place où, les mains liées, torse nu, à genoux et la nuque prise entre deux grosses bûches, les condamnés à l’humiliation s’exposaient aux insultes des passants qui ne se privaient pas de les traiter d’ânes bâtés, d’andouilles et parfois même, quand la colère et l’indignation dépassaient vraiment les bornes, de couillons, de tordus, d’enflures, de raclures de bidet, pauvre merde, tu vas voir, salaud, on va te trouer la peau. (Site 25)
Même l’amour – la seule chose qui compte selon le catéchisme sarkozien [10] – n’est pas un refuge :
Ici vivaient les Mignard qui n’étaient guère causants, à peine le bonjour, deux mots aux commerçants, elle toujours habillée en noir, sombre et triste veuve d’un mari qui allait pourtant lui survivre, et qui ne se priverait pas, une fois resté seul, d’ouvrir bien grand la bouche pour dire tout le mal qu’il pensait d’elle, racontant là qu’elle n’était bonne à rien, ici qu’elle lui avait toujours fait honte, la vomissant sur tous les toits et sur tous les comptoirs de la ville, disant qu’elle puait le tabac froid, qu’elle lui avait fait perdre les plus belles années de sa vie et qu’il aurait dû partir, la laisser là sans attendre qu’elle prenne les devants, qu’elle lui avait tout de même légué de l’herpès, des chancres et des hémorroïdes en guise d’adieu, qu’elle l’avait littéralement dégoûté des femmes (…) (Site 58)
Anamnèse
Ce qui est drôle, dans l’audioguide, est aussi son économie paradoxale : le propos est aussi laconique et euphémique sur l’essentiel qu’il est incontinent sur l’inessentiel. En même temps qu’il élève des faits insignifiants au rang d’événements grandioses, dignes du plus grand sérieux, de la narration la plus laborieuse et des descriptions les plus méticuleuses (1), l’audioguide n’accorde qu’un mot en passant aux rares vrais événements (2) :
– (1) Des familles se pressaient à l’entrée de la chapelle ; c’était dimanche, elles s’étaient habillées, et le petit Lucien était pressé de montrer à Dieu sa nouvelle veste jaune.(…) Emilie Granlay avait mis du velours noir et du rouge à lèvres, Antoine Chardonnet un pantalon de lin. (Site 27)
– (2) Grands travaux, chantiers, bruits de pelles et de marteaux, camions, grues et semi-remorques envahissant toutes les routes, soulevant la poussière, roulant, portant des gravats, semant du goudron, des tôles et des bouts de verre, on y va, toi tu transportes le sable, moi je décharge le sable, toi tu montes la grue, moi j’en tombe, tu coules une chape de béton, et moi je suis dedans, bref, on avance, on se remue, on fait tout ce qu’il faut, quoi. (Site 29)
Ce qui est mis en scène ici, c’est une dénégation, une incapacité bien française à problématiser le réel social : quand enfin se produisent des ruptures dans le flux cyclique des saisons, du labeur quotidien et des réunions de famille, quand adviennent en somme des événements, des accidents, des scandales (je tombe de la grue, puis je suis dans la chape de béton), ils sont traités comme des faits minuscules et anecdotiques, des détails sans importance qui viennent s’insérer au milieu de la phrase, entre deux virgules, dans la routine du travail (toi tu montes la grue, bref on avance). Ils viennent même se fondre dans la phrase, s’y engloutir comme le corps de l’ouvrier est englouti dans le béton. Cet engloutissement, qui est à la fois une réalité et – par métonymie – le symbole le plus radical de l’injustice sociale, se démultiplie : à l’anéantissement physique (la mort d’une part, mais aussi la disparition du corps) s’ajoute l’effacement des traces et l’organisation de l’oubli (ce glaçant bref on avance, version contremaître sympa de l’injonction policière Circulez y’a rien à voir) – et cette négation est exhibée par la structure et le rythme de la phrase. L’écriture opère en somme un travail d’anamnèse, en venant nous rappeler non seulement qu’on meurt au travail dans notre Douce France, mais aussi que cette Douce France ment – par omission, dissimulation, effacement de la violence sociale. En s’appropriant ainsi, pour la caricaturer et la pousser à sa limite, cette façon de traiter le non-événement comme un événement et l’événement comme un non-événement, Philippe Adam nous fait rire, mais il nous dit aussi beaucoup, à la fois sur les audioguides, dont tout le livre est une brillante parodie, et sur la France, où ces inversions de priorité et ces tours de passe-passe historique sont une spécialité nationale.
D’autres éclairs de ce type traversent à l’occasion le texte, et viennent nous rappeler juste en passant, de manière ostensiblement dissimulatrice, une réalité violente, brutale, hideuse, en bref tout le refoulé du récit national, notamment les rapports de classe, la violence d’État, le colonialisme :
Ouvriers alignés, baissant la tête, tenant entre leurs mains les casquettes offertes par Monsieur le directeur. (Site 59)
Ici s’élevait la guillotine. À deux pas, la prison. Et c’est bête, mais je n’ai rien à dire, pensait-il, la langue tirée sur la feuille où il était supposé noter ses dernières paroles. (Site 62)
D’une fillette aussi mal élevée et d’un fils ayant cette tête-là, disait-elle, personne ne voudrait, même les colonies les refuseraient, on me les renverrait comme deux lettres mal adressées.(Site 41)
Du mécanique dans du mourrant
L’audioguide est en somme une traduction rigoureuse, dans une langue très écrite, presque précieuse, d’une vérité que des lascars, bien placés pour le savoir, résument parfois d’une manière plus concise, mais qui elle aussi possède sa force, sa poésie et sa vérité :
La France, c’est tout pourri !
Car tout pourrit bel et bien dans l’audioguide. La saleté, les mauvaises odeurs, la sueur ou les relents de vin mal digéré viennent gâcher la fête et nous rappeler à notre condition de mammifère voué à la mort. Un mot revient, obsédant : tout est mauvais – regard mauvais, mauvaise compagnie, mauvaise concience, mauvais moment, mauvais coton, mauvaise haleine, mauvaise odeur, sans oublier la fameuse Secte des Mauvais Apôtres. Le lait des vaches du site 23 est tiède, blanchâtre et crémeux, indigeste, écœurant, et au sens le plus rigoureux du terme, tout ou presque pue la mort :
Quand le soleil se levait, on était déjà debout ; quand il se couchait, on était déjà mort, et les nouvelles générations reprenaient gaiement la tâche laissée en plan par les aînés, tel maudissant son père d’avoir sorti les chèvres sans se soucier de les traire, tel autre constatant qu’il manquait la corde au puits où il avait pourtant bien décidé de se pendre, tous ruminant des vengeances qui condamneraient la ville à n’être plus qu’un tas de cendres, une arène, une étable où les bouses l’emporteraient de très loin sur le foin. (Site 3)
Ici l’odeur était terrible. Aux chairs mortes s’ajoutaient la sueur et la mauvaise haleine des tanneurs, et le cuir, parfois, pourrissait avant d’avoir été porté. (Site 11)
Ici d’un bout de bois on savait faire un mur, de deux planches un salon, de trois cartons sortait la chambre à coucher des enfants, les bouteilles en plastique faisaient une cabine de douche quand elles ne servaient pas de toilettes, on pissait dedans, la nuit, et l’un remplissait son litre de Coca-Cola, l’autre ses trois quarts d’Evian, rien ne finissait à la poubelle, tout en sortait, on vidait, on nettoyait, on se levait de bonne heure, poussant devant soi un chariot de supermarché, un sac en plastique avait sa valeur, on faisait des cannes à pêche avec des morceaux de cageots rafistolés, des essuie-mains avec des prospectus ramassés dans les boîtes à lettres, on avait des chaussures sans semelle ni lacet, on se lavait parfois les pieds, on les faisait prendre l’air, les chaussettes posées sur les bords d’une vieille machine à laver qui servait d’habitude de frigo, et on remettait les vêtements, ils sentaient mauvais, nous ne sentions pas bons, chez nous sentir le propre voulait dire avoir trouvé quelque chose, une serviette de bain entre un sac d’épluchures et une rangée de coquilles d’huîtres, un vieux déodorant mal fini, laissant encore échapper quelques bouffées d’anti-odeur quand on appuyait sur le bouton après avoir bien agité le tube, et donc on puait, mais ça allait, quand même, certains jours, ça allait. (Site 34)
Le négatif, le délabrement, la mort se font d’ailleurs de plus en plus envahissants au fil des pages :
Fêtes de la nouvelle année, et comme d’habitude les plus vieux en profitent pour rassembler leurs plus vieux souvenirs tandis qu’assise à leurs pieds la marmaille peine, elle aussi, à retenir ses selles. (Site 10)
Et que dire de la belle-famille, du gendre à moitié scrofuleux, du père aux trois-quarts diabétique tenant le bras de la mère toute molle et toute décharnée, le père ne lâchant le bras de la mère que pour la remise des anneaux (…) (Site 17)
Des gamins jouant à faire glisser leurs petits corps gracieux sur la glace des marais ne restent à présent que les patins en os d’ours. (Site 45)
Malheurs réels, malheurs redoutés, malheurs fantasmés, minuscules avanies et grandioses catastrophes finissent par se mêler dans un final tragi-comique :
Désastres en tous genres qui laissaient pressentir l’imminence de malheurs bien plus grands, poussières nucléaires, brusques retombées de la nuit, ralentissements de la planète, fonte des glaces, fonte des continents, réveil surprise de tous les volcans, catastrophes, gels au mauvais moment, soleils mal placés, inondations de toutes les terres visibles, viande d’âne à midi, engloutissements, pannes d’ascenseurs, désertification des lieux habitables, hausses simultanées du niveau de la vie et du niveau de la mer, envolée des œufs, encore des embouteillages sur l’autoroute A6, encore un accident, encore aux urgences, encore et encore et encore au secours. (Site 70)
D’un désespoir furtif restent quelques rides à la surface de l’eau, un pli au détour des branches, quelque chose qui voudrait se prolonger, s’accrocher comme une ombre suivant pas à pas le long cortège des têtes mortes et des corps ensevelis, toutes choses enfouies, recouvertes, tellement passées qu’elles sont maintenant sans importance, la pluie promenant goutte à goutte et de strate en strate les nouvelles d’en dessus, ceux d’en dessous les recevant comme un poids qui viendrait s’ajouter pour rien sur leurs tonnes et leurs tonnes d’ossements, pauvres squelettes, déambulateurs laissés là pour seconder à tout hasard l’éternité. (Site 71)
D’être français il n’y a donc pas lieu d’être fiers, nous dit l’audioguide, ensemble tout ne devient pas possible, travailler plus ne fait pas gagner plus et de toute façon nous allons tous mourir. Rien de très exaltant donc, et pourtant paradoxalement – mais est-ce tellement paradoxal ? – cette finitude franco-française – telle en tout cas que Philippe Adam la met en scène, dans une microfiction en forme d’inventaire inventé qui constitue, au plan formel, l’exact antipode des grandiloquentes envolées sarkoziennes – est, autant qu’inquiétante, profondément et délicieusement comique. Si vous ne trouvez pas ça drôle, si vous ne voyez pas quel plaisir on peut retirer d’autant de petitesse et de misère, ce n’est pas grave : ce livre n’est pas pour vous. Mais si votre âme est à ce point accablée d’optimisme, de fierté nationale et de grandeur de la France qu’un peu, rien qu’un peu de petitesse, de médiocrité, d’insignifiance et de pessimisme vous fait l’effet d’un soulagement, alors l’audioguide vous remplira de joie.



