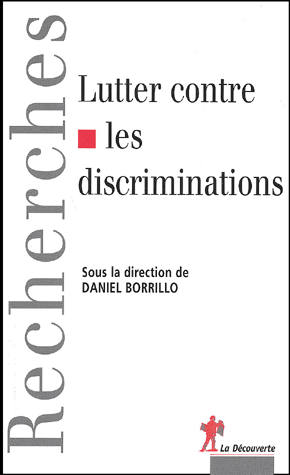
Si la « loi d’airain » du marché produit inéluctablement de la discrimination, toute intervention de l’État visant à en juguler les effets suppose tout aussi inéluctablement d’encadrer la liberté contractuelle et le jeu de la concurrence. Dire cela, c’est mettre le doigt sur les apories de la lutte contre les discriminations dans la sphère marchande : car jusqu’où peut-on restreindre la liberté contractuelle et la libre concurrence sans porter atteinte aux fondements mêmes de l’économie de marché ? Le législateur peut bien prohiber les discriminations les plus choquantes, réglementer les modalités de passation ou le contenu des contrats là où la dissymétrie entre les contractants est la plus flagrante, son intervention connaît forcément des limites. Une fois reconnue l’impossibilité d’éradiquer les discriminations dans le cadre du marché, il ne reste d’autre solution que de s’affranchir de la logique du marché, à chaque fois qu’elle entrave l’égal accès à des droits fondamentaux, pour faire prévaloir une logique de la solidarité.
La prohibition des discriminations les plus choquantes
Le législateur a progressivement renforcé l’arsenal répressif et en a étendu le champ d’application à des formes de discriminations toujours plus nombreuses. Mais ce mode d’intervention rencontre des limites. Les unes sont inhérentes à tout dispositif de répression, lourd à mettre en œuvre pour un bénéfice aléatoire. Les autres découlent de l’impossibilité de dénier aux entreprises le droit de sélectionner leurs clients ou leurs salariés sur des critères qui ne soient pas strictement impersonnels et objectifs, sauf à décider qu’elles sont tenues, à l’instar des services publics, à un strict principe d’égalité – ce qui reviendrait précisément à nier leur liberté contractuelle et la légitimité de choix opérés en fonction d’un impératif de profit [3]. Le statut ambigu des discriminations fondées sur l’état de santé fournit une bonne illustration de cette contradiction.
Les discriminations interdites
C’est la loi du 1er juillet 1972 contre le racisme qui a pour la première fois introduit dans le code pénal des dispositions réprimant la discrimination fondée sur l’origine ou l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. À ces critères sont venus s’ajouter successivement le sexe et la situation de famille en 1975, les mœurs en 1985, le handicap en 1989, l’état de santé en 1990. Le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, y a inclus les discriminations fondées sur les opinions politiques ou les activités syndicales, la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, l’apparence physique, le patronyme, l’âge, et la loi du 4 mars 2002, sur les droits des malades, les discriminations fondées sur les caractéristiques génétiques. Le code pénal définit la discrimination comme la distinction opérée entre des personnes physiques ou morales sur la base d’un des critères que l’on vient de rappeler. Elle ne tombe toutefois sous le coup de la loi pénale que si elle consiste en l’un des comportements énumérés à l’article 225-2, parmi lesquels figurent le refus de fournir un bien ou un service et les discriminations en matière d’emploi.
Le code du travail a connu une évolution similaire. Depuis les lois Auroux de1982, qui y ont introduit pour la première fois des dispositions interdisant les discriminations, la liste des critères de discrimination et des comportements interdits a été progressivement allongée, sur le modèle du code pénal. La loi du 16 juillet 2001, transposant sur ce point les directives communautaires du 27 novembre 2000 (dite « directive emploi ») et du 29 juin 2000 (dite « directive race »), a également institué un renversement partiel de la charge de la preuve lorsque la victime fait état d’éléments laissant présumer le caractère discriminatoire de la décision de l’employeur.
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, enfin, a introduit dans la loi de 1989 sur les rapports locatifs une disposition expresse qui interdit de refuser la location d’un logement pour l’un des motifs énumérés par le code pénal, et qui prévoit, comme en matière d’emploi, un renversement partiel de la charge de la preuve.
L’ensemble de ce dispositif n’a cependant qu’un impact très marginal sur le phénomène qu’il entend conjurer. La lourdeur de l’action en justice, le caractère aléatoire du bénéfice escompté, les difficultés de preuve, enfin, qui subsistent en dépit des progrès législatifs et jurisprudentiels récents [4], n’incitent pas les victimes à se lancer dans le contentieux. De façon plus générale, la discrimination prohibée passe facilement inaperçue dans un environnement qui, comme on l’a rappelé plus haut, non seulement autorise la discrimination mais fonctionne à base de discrimination.
Le statut ambigu des discriminations fondées sur l’état de santé
C’est pour « mieux protéger les droits des malades et des handicapés » et « mieux prévenir les phénomènes d’exclusion ou de discrimination » que les pouvoirs publics, alertés sur les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne par les personnes touchées par le VIH, ont décidé, par la loi du 12 juillet 1990, de sanctionner pénalement les discriminations fondées sur l’état de santé, en particulier dans le cadre de la fourniture de biens et de services ou dans le cadre de l’emploi.
Mais les exceptions apportées par le législateur à l’interdiction des discriminations fondées sur l’état de santé réduisent à peu de chose la protection accordée. La première, aisée à justifier et difficilement évitable, concerne les refus d’embauche et les licenciements lorsqu’ils résultent du constat, par le médecin du travail, de l’inaptitude médicale du salarié. La seconde exclut l’assurance de personnes du champ d’application de la loi pénale [5].
Il faut savoir que cette exclusion, qui ne figurait pas dans le projet initial, a été introduite à la demande expresse des compagnies d’assurance. Pourtant, même sous sa forme initiale, le texte n’excluait pas toute sélection des risques, puisqu’il prévoyait la possibilité d’invoquer un motif légitime pour justifier le refus de fournir un bien ou un service : il aurait simplement obligé les compagnies à préciser les motifs du refus, introduisant un peu plus de transparence dans un domaine où l’opacité reste la règle. En reconnaissant aux assureurs, plus explicitement qu’aucun texte ne l’avait jamais fait, le droit de sélectionner les candidats à l’assurance ou de fixer le montant des primes sur des critères de santé, en cédant à la pression d’un groupe économiquement puissant, le gouvernement a fait la démonstration que la lutte contre les discriminations pouvait être mise en échec par la loi d’airain du marché. Il a également réussi ce paradoxe qui consiste à entériner l’exclusion des personnes malades de l’accès à l’assurance dans une loi qui prétendait les protéger contre les discriminations !
En ce qui concerne l’interdiction de la prise en compte des caractéristiques génétiques, en revanche, l’opposition des assureurs n’a pas été aussi déterminée. Il est vrai que le diagnostic génétique n’est encore ni suffisamment généralisé, ni suffisamment performant pour être utilisé par les assureurs comme outil de sélection des risques dans leur pratique courante. Dès le début de 1994, de fait, la Fédération française des sociétés d’assurances a d’elle-même adopté un moratoire de cinq ans, reconduit en mars 1999, sur les examens génétiques.
Avant que la loi du 2 mars 2002 sur les droits des malades ne vienne trancher la question, les avis concernant, tant la licéité de la sélection sur critères génétiques au regard des textes en vigueur que l’opportunité de les interdire, restaient très partagés. Sans doute les lois bioéthiques de 1994 ont-elles exclu la réalisation de tests génétiques pour une finalité autre que médicale ou de recherche scientifique, et sanctionné pénalement le détournement des informations ainsi recueillies ; mais il n’était pas évident que soit assimilable à un détournement la communication à l’assureur, par le candidat à l’assurance, du résultat d’un test réalisé pour des raisons médicales. Sans doute aussi la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo, 1997) interdit-elle « toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son patrimoine génétique » (article 11), interdiction qu’on retrouve dans la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de 1997, qui proclame que
« nul ne doit faire l’objet de discriminations fondées sur ses caractéristiques génétiques, qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et à la reconnaissance de sa dignité » [6].
Mais on pouvait objecter que la sélection des risques n’est pas constitutive d’une discrimination, dès lors qu’elle est au fondement de l’assurance.
Le Comité consultatif national d’éthique s’était clairement prononcé, en 1995, pour une interdiction totale de l’utilisation des données génétiques à des fins de sélection ou de discrimination, que ce soit dans le domaine des politiques de santé, de l’emploi ou des systèmes d’assurance [7]. Mais le Conseil d’État, pour sa part, faisait valoir que l’assureur étant déjà en droit de solliciter des renseignements médicaux pour évaluer les risques qu’il prend en charge, la prise en compte des tests génétiques ne constituerait qu’une simple différence de degré et non de nature. Écartant l’idée d’une interdiction absolue, il optait pour une solution intermédiaire, consistant à interdire aux compagnies d’assurance d’imposer à leurs souscripteurs de se soumettre à des tests, mais admettant qu’un souscripteur pourrait être tenu de produire le résultat d’un test de prédisposition qu’il aurait subi volontairement avant la conclusion de son contrat [8].
La loi du 4 mars 2002, qui complète le code du travail et le code pénal en prohibant toute discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, interdit clairement le recours aux tests génétiques dans le champ de l’assurance, généralisant ainsi l’interdiction déjà posée par la loi CMU de 1999 pour les organismes de protection complémentaire. Désormais, l’article 1141-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 133-1 du code des assurances, interdit aux assureurs qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès de tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. Il leur est également interdit de poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats ou de demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques, que ce soit avant la conclusion du contrat ou pendant la durée de celui-ci. La violation de ces interdictions est pénalement réprimée : la loi ajoute à l’article 225-3 du code pénal, qui autorise les assureurs à opérer des discriminations fondées sur l’état de santé, une disposition prévoyant que la discrimination est en revanche constitutive d’un délit lorsqu’elle se fonde
« sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ».
Reste à savoir si cette interdiction résistera longtemps à la pression des intérêts économiques et à la logique de la sélection des risques, alors que les compagnies d’assurance sont en concurrence au niveau européen et que certains pays, comme la Grande-Bretagne, ont accepté la prise en compte des tests génétiques [9].
La solidarité contre le marché
Si la logique du marché non seulement est incapable de produire de l’égalité, mais engendre de nouvelles formes de discrimination que l’encadrement de la liberté contractuelle ne suffit pas à juguler, force est de recourir à d’autres modes de régulation si l’on ne veut pas laisser la réalisation des droits fondamentaux dépendre des aléas du marché.
Parmi les droits les plus directement menacés par la loi du marché figurent, on l’a vu, le droit à l’emploi et le droit à la santé, garantis par le Préambule de 1946, le droit au logement, proclamé à plusieurs reprises par le législateur, mais aussi – il convient de s’y arrêter un instant – la possibilité de s’assurer. Car s’il n’existe pas à proprement parler de droit à l’assurance, l’assurance est devenue, directement ou indirectement, la condition de l’exercice d’une série de droits fondamentaux, de sorte que l’impossibilité d’accéder à l’assurance équivaut à être privé de ces droits. Le droit au logement, l’exercice d’une activité professionnelle et donc la liberté d’entreprendre, le droit de disposer des biens de consommation indispensables, sont de plus en plus souvent conditionnés par le recours à l’emprunt ; or l’accès au crédit est lui-même conditionné par l’accès à l’assurance, puisque les banques exigent que le remboursement du prêt soit garanti par une assurance couvrant les risques décès, invalidité et maladie.
L’émotion suscitée, en février 2000, par la décision de la compagnie Axa de doubler les cotisations des contrats souscrits par les parents d’enfants handicapés pour garantir, après leur décès, une rente à leurs enfants, fournit une illustration supplémentaire du rôle vital joué par certaines formes d’assurance. Mais cette affaire a aussi constitué l’aveu, de la part d’un organisme géré à l’aune du profit, de son incapacité à garantir à tous, et pas seulement aux plus fortunés, l’accès aux prestations qu’il offre [10].
Avec le désengagement programmé de l’État, ce type de problèmes risque de se poser avec une acuité croissante. L’existence, en France, d’un système de sécurité sociale obligatoire et universel a permis jusqu’à présent de faire échapper la protection sociale à la loi du marché et à la sélection des risques. Mais la part des assureurs privés dans le secteur de la protection sociale complémentaire est appelée à s’accroître, et les compagnies d’assurances revendiquent désormais d’être présentes dans le financement et la gestion de l’assurance maladie, à côté, voire à la place des systèmes publics ou mutualistes [11] : la logique du marché ne risque-t-elle pas de contaminer la logique de la solidarité ? La crainte n’est pas vaine, car l’expérience des pays étrangers qui ont introduit la concurrence dans le secteur de l’assurance maladie, comme les États-Unis et les Pays-Bas, montre qu’en dépit d’une réglementation stricte visant à éviter la sélection des risques (obligation d’accepter toute demande d’adhésion, compensation des risques entre les caisses), l’organisation concurrentielle pousse malgré tout inéluctablement à des formes de sélection indirecte, aboutissant soit à l’exclusion du système d’une partie de la population, soit à des inégalités dans les prestations et la qualité de service offertes en fonction de l’état de santé [12].
Si la question de l’assurance mérite à ce point qu’on s’y attarde, c’est bien sûr parce que les discriminations s’expriment et se déploient dans le secteur de l’assurance privée plus ouvertement et plus librement que nulle part ailleurs. C’est également parce que, compte tenu des besoins auxquels elle répond, de la fonction économique et sociale désormais essentielle qu’elle remplit, les discriminations dans l’accès à l’assurance emportent avec elles d’autres discriminations.
Mais l’assurance est aussi une technologie [13], un mécanisme susceptible d’applications différenciées, dont il faut s’attacher à saisir l’ambivalence. Intégrée à une logique de marché, elle semble décidément incapable de produire autre chose que de la discrimination et de l’exclusion ; mais elle peut fonctionner, à l’inverse, « comme une sorte de main invisible de la solidarité » [14]. L’État providence s’est ainsi développé sur la base d’un système assuranciel couvrant les principaux « risques » de l’existence : maladie, chômage, retraite, invalidité, et instaurant une solidarité entre tous les membres de la société, malades et bien-portants, pauvres et riches, inactifs et actifs.
Techniquement, pour que l’assurance produise de la solidarité, il faut accepter une forme de subvention croisée entre bons risques et mauvais risques, et donc faire prévaloir trois principes, que seul l’État est capable d’imposer : une tarification uniforme, l’interdiction pour les assureurs de refuser de couvrir les « mauvais risques », et l’obligation pour les « bons risques » de s’assurer, de manière à garantir l’assiette de la redistribution [15]. Autrement dit, aller à contre-courant de la tendance à l’hyper-segmentation des tarifs, fondée sur une appréciation fine de la probabilité du risque de chacun.
Le choix qui consisterait à « jouer la carte de la solidarité entre bonnes et mauvaises classes de risques, donc jouer la carte de l’opacité sans se renseigner sur le profil des souscripteurs » [16]
a-t-il des chances de l’emporter ? On peut en douter. Ainsi, c’est la philosophie inverse qui inspire le dispositif récemment mis en place pour couvrir les risques de santé aggravés, dans le sillage de la convention sur l’assurabilité des personnes séropositives, signée en septembre 1991 entre les assureurs et l’État. Les concessions consenties par les pouvoirs publics aux compagnies – auxquelles était reconnu le droit à la fois de sélectionner les candidats en fonction de leur état de santé et d’exiger d’eux un test de séropositivité – aboutissant à exclure les séropositifs des dispositif de droit commun, la convention leur ouvrait la possibilité, moyennant supprime, de souscrire un contrat d’assurance en cas de décès pour garantir un prêt immobilier. Cette convention a été un échec, pour une série de raisons dont les plus évidentes sont la limitation des garanties offertes (n’étaient couverts ni les prêts à la consommation, ni le risque invalidité), le montant trop élevé de la surprime, mais aussi la réticence aisément compréhensible à recourir à un dispositif par définition stigmatisant.
C’est pourtant ce modèle qui a été repris et développé par la convention du 19 septembre 2001 sur l’assurance des personnes présentant des risques de santé aggravés. Transversale à l’ensemble des pathologies, elle inclut cette fois les prêts à la consommation. Elle permet aussi de proposer des prêts immobiliers avec surprime aux personnes considérées comme inassurables, grâce à la mutualisation des risques entre les assureurs par la mise en place d’un « pool de risques aggravés » et d’un « pool de risques très aggravés ».
Faut-il voir dans ce dispositif, entériné par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades [17], une incursion de la solidarité dans le monde de l’assurance, comme on l’a dit, et la preuve qu’on peut concilier marché et solidarité ? Ne signe-t-il pas au contraire l’échec de la solidarité ? Consacrant la mise à l’écart des personnes malades ou qui ont été victimes d’une affection grave des dispositifs de droit commun, il repose en effet sur une double discrimination : entre malades et bien portants, puisque les conditions d’assurance offertes aux personnes couvertes par la convention sont beaucoup moins avantageuses que celles dont bénéficie le reste de la population ; entre riches et pauvres, puisque seuls les plus fortunés pourront s’assurer aux tarifs proposés, tandis que les autres, dans l’incapacité de payer les surprimes demandées, resteront exclus de l’accès à l’assurance.
La solution adoptée aujourd’hui pour les risques aggravés pourrait bien servir demain de modèle pour la couverture d’autres « mauvais risques », ouvrant ainsi la voie à une segmentation toujours plus forte du marché de l’assurance. L’hypothèse est d’autant plus plausible que la pression des intérêts économiques n’est pas la seule à pousser en ce sens. Le progrès de la connaissance des inégalités naturelles entre les hommes, la « déchirure du voile d’ignorance » [18], sous l’effet des progrès de la médecine, notamment de l’épidémiologie et du diagnostic génétique, pourrait bien miner à la base le principe d’une mutualisation universelle qui présupposait que les individus étaient égaux devant les différents risques sociaux susceptibles d’affecter l’existence, et, à terme, faire voler en éclats l’ensemble de notre système de protection sociale.
Si cette perspective pessimiste se confirmait, elle signifierait la double victoire du marché : victoire matérielle, le consacrant comme mode hégémonique de régulation sociale ; mais aussi victoire intellectuelle et morale, puisqu’il apparaîtrait alors en pleine lumière que la loi du marché a inscrit profondément sa marque en chaque individu, et que des décennies d’État providence n’ont pas réussi à déraciner la propension à raisonner, bien au-delà de la sphère marchande, en termes de coût-bénéfice.


