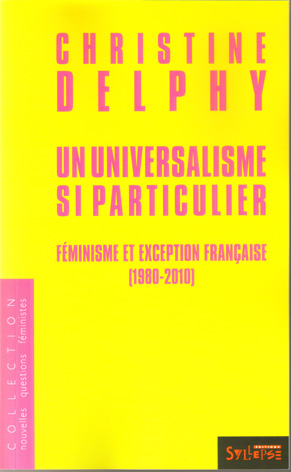
On parle souvent des acquis du mouvement féministe. Mais aucun acquis social, y compris quand il est inscrit dans la loi, n’est gravé dans le marbre ; l’histoire contemporaine le démontre à l’envi. Les acquis féministes sont particulièrement fragiles. Ils sont en butte à plusieurs types d’obstacles : les attaques des lobbies « masculinistes » dans certains secteurs, le baquelache idéologique, la mauvaise volonté politique de l’ensemble de la société, tant civile que politique ; et finalement le matraquage du mythe de « l’égalité-déjà-là », appuyé en France sur une idéologie qui a pris la notion de république en otage. Avancer en dépit des résistances et des attaques, c’est l’un des enjeux du mouvement féministe.
La contre-offensive patriarcale prend la forme de lobbies « masculinistes » fortement organisés, véritablement internationaux et très riches – et en ces trois aspects ils diffèrent du mouvement féministe – qui déposent sur les bureaux des ministres et des députés, jour après jour, année après année, des propositions de remise en cause des lois sur l’avortement, sur le harcèlement sexuel, sur le divorce. Leurs actions visibles, comme celles des commandos anti-avortement, sont des exceptions ; c’est de façon souterraine, en formant des « experts » qui témoigneront devant les tribunaux, en écrivant des livres de psychologie, qu’ils œuvrent. Leurs cibles : le droit à l’avortement, mais aussi la pénalisation des violences masculines contre les femmes et contre les enfants. Leurs ouvrages constituent des systèmes théoriques où les avocats des hommes violents et des pères incestueux, ainsi que les auteures d’ouvrages baquelachiens, puisent leurs arguments : « fausses allégations », syndrome des « faux souvenirs », etc.
Dans tous les pays, on constate le même retour de bâton. En France comme ailleurs, ce sont en majorité des femmes qu’on envoie en première ligne pour dire que le féminisme ne passera pas, ou n’est pas passé, n’est pas, ou n’est plus utile, a toujours été nocif ou l’est devenu. Comme ailleurs, parmi ces femmes, d’anciennes féministes ou sympathisantes, dont la parole est dégustée avec la gourmandise un peu obscène réservée auparavant aux confessions d’anciens Staliniens. Les thèmes sont les mêmes qu’ailleurs, qu’aux USA notamment où ils sont empruntés : les féministes exagèrent, l’oppression des femmes c’est fini, le viol ça n’existe pas, le harcèlement sexuel non plus.
Ces discours sont pris dans une sauce cocorico : il existerait dans le domaine des mœurs aussi une « exception française ». En France, les rapports entre les sexes seraient idylliques. Le grossier sexisme étranger laisserait la place, en France, à la fine « séduction » gauloise. On peut se demander comment des gens intelligents par ailleurs arrivent à croire, en dépit des enquêtes, des chiffres, des faits divers qui en montrent l’extraordinaire similitude d’un pays à l’autre, que l’oppression des femmes s’arrête tout net à Annemasse et à Port-Bou comme en son temps le nuage de Tchernobyl.
Quand les conventions internationales ou les directives européennes restent lettre morte, quand les lois internes interdisant la discrimination sexuelle ne sont pas plus appliquées que celles interdisant la discrimination raciste, on est obligée de parler d’une collusion non-dite entre tous les acteurs : employeurs, syndicats, appareil judiciaire, État, médias. Certaines lois tendent tout simplement à ne pas être appliquées, en France, et parmi celles-là, particulièrement celles qui concernent l’égalité entre les sexes.
La loi de 1983 sur l’égalité dans le travail n’a jamais été mise en œuvre, et elle était faite, si on peut dire, pour ne pas l’être, puisqu’elle ne comportait aucune sanction ; la loi « Génisson » de 2001 comporte quelques sanctions ; le chef de l’État aurait l’intention de la faire appliquer : c’est une admission du fait qu’il ne faut pas moins qu’une intervention présidentielle pour qu’une loi soit autre chose qu’un chiffon de papier. La loi sur l’avortement est violée matin midi et soir par les hôpitaux, les chefs de service, les services sociaux et l’État, qui ne mettent pas en place les centres d’IVG prévus par ses décrets d’application. Un combat constant est nécessaire pour empêcher qu’entre les « dysfonctionnements » et le travail de sape des lobbies anti-choix, l’IVG ne disparaisse purement et simplement.
Mais si faire passer des lois et ensuite les faire appliquer consomme une bonne part de l’énergie du mouvement féministe, ce ne saurait constituer son seul but. En effet, l’inégalité flagrante entre femmes et hommes sur le marché du travail s’adosse à l’exploitation du travail domestique des femmes. L’attribution aux seules femmes de 90% du travail domestique fait partie de l’ossature, de la structure du système social, comme la division en classes sociales. Or la structure sociale n’est pas rectifiable par la loi – c’en est au contraire le fondement, même si ce fondement est caché.
Par où attaquer ce volet de l’exploitation économique des femmes qui semble n’être susceptible que de négociations interindividuelles dans les couples, quand il s’agit de la base de l’organisation patriarcale de nos sociétés ? Trouver un angle d’attaque qui soit en résonance avec une période globalement réformiste – ayant abandonné toute idée de changement hors du cadre institutionnel existant – est un défi auquel le mouvement féministe n’a pas encore trouvé de réponse, même si quelques pistes ont été suggérées.
Le mythe de l’égalité-déjà-là
Deux, trois générations de jeunes femmes, qui auraient dû prendre le relais des féministes de 1970, se sont tenues à l’écart du mouvement. La parole de celui-ci, confidentielle, ne peut rivaliser avec celle des médias. Or ceux-ci ont été très habiles dans leur campagne anti-féministe. Certes, elle inclut une présentation négative des féministes « moches et frustrées », « anti-hommes », « toutes des lesbiennes ». Mais l’arme la plus efficace de cette campagne est le matraquage de l’idée que « Tout est gagné, il n’y a plus rien à faire »… Sauf, sous-entendu, à retrousser ses manches et à prouver qu’on est digne de cette égalité.
Cette idée culpabilise les femmes : si vous n’y arrivez pas, ce n’est pas de la faute de la société, mais la vôtre. Mais surtout elle présente les inégalités flagrantes comme constituant… l’égalité ! Or si les femmes, donc moi, se disent les jeunes femmes, ne méritent pas plus, si l’inégalité est équitable, juste, c’est que nous sommes vraiment inférieures. L’égalité-déjà-là n’est pas seulement un mensonge : c’est un poison qui entre dans l’âme des femmes et détruit leur estime d’elles-mêmes, leur croyance souvent fragile qu’elles sont des êtres humains à part entière – et pas à moitié. C’est un des enjeux du féminisme aujourd’hui – y ramener les femmes.
Or cela implique non seulement de lutter contre le patriarcat mais de faire passer le message : oui, il faut se battre encore et toujours ; non, nulle part, dans aucun pays et dans aucun rapport social, les dominants ne renoncent de bon gré à leurs privilèges. Mais combattre la vision idéologique du « progrès-qui-marche-tout-seul » et ne va que dans un sens – le bon – n’est pas suffisant. Pour ramener les femmes à la lutte, il ne suffit pas de leur montrer que l’égalité est encore à réaliser ; il faut aussi, et c’est là toute la difficulté, les convaincre qu’elles « le valent bien ».
Partout se sont mis en place des barrages idéologiques à toute action en faveur de l’égalité substantielle. Ce barrage est fait, paradoxalement, au nom de l’égalité elle-même, et complète le dispositif de « l’égalité-déjà-là ». En France, la classe politique – gauche et droite confondues – et une partie de l’intelligentsia s’appuient sur le concept de république pour s’opposer à toute revendication de groupes qui sont constitués par une oppression partagée, comme les femmes, les homosexuels, les ouvriers, les victimes du racisme. Ces « républicains » estiment que parler de groupes ou de catégories serait déjà anti-républicain – puisque la république ne les connaît pas, c’est en en parlant qu’on les invente ; toute mention de catégories ou de groupes, étant contraire à l’esprit de la république, est donc contraire à l’esprit de l’égalité.
Tels sont les syllogismes qui ont été opposés à la proposition de quotas (de 25%) pour les femmes sur les listes électorales par le Conseil constitutionnel en 1982. C’est au nom de l’universalisme républicain que la campagne pour la parité a été attaquée ; or on pouvait reprocher à cette campagne son argumentaire essentialiste, mais pas de dénoncer et de vouloir corriger une discrimination indéniable dans l’accès aux fonctions électives. Les homosexuels, ou les descendants d’immigrés sont soupçonnés de comploter contre les principes républicains, quand, réunis par une communauté d’exclusion, ils ne demandent qu’à y entrer, dans cette république.
Ainsi, grâce à des sophismes transparents, et surtout à la confusion volontaire entre l’égalité proclamée et l’égalité réelle, le mot de « république » devient-il de plus en plus le cri de ralliement de ceux qui nient que l’inégalité de fait règne dans la nation. Ils sont parvenus à faire dire aux mots le contraire de ce qu’ils signifient, et par un renversement véritablement pervers, à transformer l’égalité républicaine en arme contre l’égalité réelle. Rappeler que l’égalité n’existe pas encore, qu’elle est un idéal qui reste à construire contre une réalité faite d’inégalité est aussi un enjeu majeur.
Compatir n’est pas pâtir : éloge de la non-mixité
Un mouvement ne consiste pas seulement à avancer sur une route mais à la tracer. Un enjeu qui peut paraître plus interne, mais qui est crucial pour le mouvement féministe, consiste à retrouver l’élan qu’il doit à la spécificité de ses principes de non-mixité – de réunions entre femmes, pour avancer sur les routes déjà balisées, mais aussi pour en baliser d’autres, pour ouvrir des perspectives ; car la cartographie de l’oppression et le dessin de la libération ne sont jamais terminés. Les principes de non-mixité font du mouvement féministe un modèle d’auto-émancipation – où les opprimé-e-s non seulement luttent pour leur libération, mais la définissent, ce qui n’est pas le cas dans les mouvements comme le mouvement ouvrier où l’on admet le rôle directeur d’une avant-garde.
Les luttes féministes sont plurielles : pour l’avortement, les droits des lesbiennes, contre les violences, etc. Elles sont aussi diverses dans leurs formes d’organisation : groupes locaux, fédérations nationales (comme Solidarité-femmes), coalitions comme le CNDF, commissions dans des ligues ou des ONG internationales. Une grande partie de l’action féministe se fait dans des groupes mixtes (composés de femmes et d’hommes) : qu’il s’agisse de groupes mixtes par choix – comme MixCité, le Collectif contre le publisexisme, la Meute – ou que la mixité soit une condition de fait, comme c’est le cas pour les commissions femmes dans les syndicats ou ONG, ou dans les coalitions dont la plupart des groupes ou partis adhérents sont eux-mêmes mixtes. Cette mixité ne peut être remise en cause ; elle est la conséquence du mainstreaming de l’action féministe, de sa présence dans un grand nombre de lieux tant militants qu’institutionnels – les études féministes par exemple se développent dans la recherche et l’université. Ces relais mixtes sont à la fois le signe de la capacité de l’action féministe à gagner une large audience, et la condition de sa réussite à exercer une influence.
La non-mixité est-elle pour autant obsolète ? Non, elle est aussi nécessaire qu’avant. Quand elle a été inventée en 1970, la non-mixité du MLF a choqué l’ensemble de la société, y compris les féministes de la génération précédente. Car la non-mixité est la conséquence d’une rupture théorique qui remet en cause les analyses antérieures sur la subordination des femmes. Avec le MLF, il n’est plus question d’une « condition féminine » dont tous, femmes et hommes confondus, nous pâtirions également, mais de l’oppression des femmes.
Passer des lois n’était pas la préoccupation majeure du MLF. Le but du mouvement féministe était autrement ambitieux, autrement utopique. Les lois ont été le sous-produit bienvenu d’un travail gratuit – sans finalité concrète immédiate, comme la recherche fondamentale. Et si ce sous-produit a été généré, c’est aussi parce qu’il n’était pas particulièrement visé, ou plutôt que la barre était placée plus haut. C’est cette ambition « irréaliste » – se permettant de mettre entre parenthèses l’efficacité immédiate – qui a finalement donné un élan tel que des choses ont été gagnées dans la réalité.
La campagne pour re-criminaliser le viol est issue de la réflexion des groupes dits de « prise de conscience » : de mise en commun et de partage de leurs expériences par les femmes, qui découvraient ainsi que leurs problèmes n’étaient pas particuliers, et n’avaient donc pas de solution individuelle. C’est la critique de la sexualité qui a permis la campagne pour le droit à l’avortement, pour la re-criminalisation du viol, contre la violence masculine dans les couples. Elle prenait à bras le corps les théories savantes et vulgaires sur la sexualité, et les déclarait nulles et non avenues, autant de rationalisations de la domination masculine. Cette critique est devenue quasiment inaudible devant le retour vengeur d’un érotisme patriarcal : la banalisation de la prostitution, de la pornographie, et du sado-masochisme qui est leur substrat commun.
Trente-trois ans après, le mouvement féministe vit toujours sur les renversements de perspective qui ont été accomplis dans les premières années grâce à la pratique non-mixte. La non-mixité est nécessaire parce que les hommes n’ont pas le même intérêt, ni objectif ni subjectif, à lutter pour la libération des femmes. Mais surtout parce que les opprimé-e- s doivent définir leur oppression et donc leur libération elles / eux-mêmes, sous peine de voir d’autres les définir.
Et il est impossible de le faire en présence de personnes qui d’une part appartiennent au groupe objectivement oppresseur ; et d’autre part ne savent pas, et ne peuvent pas savoir, par définition et sauf circonstances exceptionnelles, ce que c’est que d’être traitée comme une femme – comme un-e Noire, comme un pédé, comme un-e Arabe, comme une lesbienne, comme un-e ouvrièr-e – tous les jours de leur vie. Aucun degré d’empathie ne peut remplacer l’expérience. Compatir n’est pas pâtir.
Que la force soit avec nous
Cela n’empêche pas les hommes d’avoir un rôle dans le mouvement féministe ; mais il ne peut pas être le même que celui des femmes. Or si la non-mixité existe toujours, elle n’est plus appréciée à sa juste valeur ; elle est déconsidérée, parfois même vue comme un stade archaïque du mouvement, qui serait aujourd’hui dépassé. Même dans les groupes non-mixtes, on n’en tire pas forcément parti, et l’ordre du jour prend le pas sur la mise en commun des expériences. C’est sauter les étapes, et on en voit le résultat : beaucoup de femmes aujourd’hui tiennent sur leur propre oppression un discours politique au pire sens du terme, on dirait qu’elles parlent d’un électorat quelconque, ou des autres, mais pas d’elles.
Le secret du mouvement des années 70, c’est d’avoir utilisé les découvertes profondes des paysans chinois et du mouvement Noir américain : « parler la souffrance pour se rappeler la souffrance ». Car la lutte politique, si elle n’est pas alimentée sans cesse par la conscience vécue, quasiment charnelle, de la réalité de l’oppression, devient un combat philanthropique ; et quand des femmes deviennent les philanthropes d’elles-mêmes, ne se souviennent plus ou veulent oublier qu’elles sont les humiliées et les offensées dont elles parlent, la force n’est plus avec elles. Garder, retrouver les sources de cette force, c’est aussi l’un des défis du nouveau siècle pour le mouvement féministe. Et pour tous les mouvements d’opprimé-e-s.


