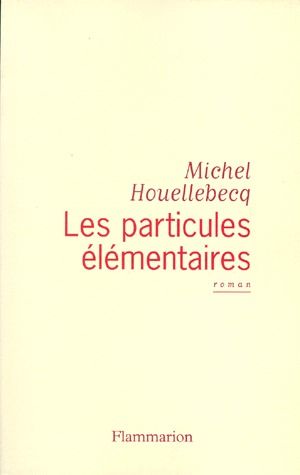
Rappelons-nous : hier encore, nos meilleures têtes allaient partout vantant le charme discret de l’érotisme français. Depuis le début des années 1990, les essayistes célébraient à l’envi l’heureuse exception nationale de l’harmonie entre les sexes. C’était bien sûr par contraste avec l’Amérique de la guerre des sexes, exception symétrique, que s’écrivait alors le roman rose de la sexualité française : les délices du consentement répondaient aux horreurs de la confrontation.
En miroir d’un Nouveau Monde doublement défini par le puritanisme et le féminisme, la France intellectuelle aimait alors à se penser comme l’héritière des salons d’Ancien Régime au moins autant que des assemblées de la Révolution - quelque peu libertine, et terriblement féminine. Sur le mode historique, Philippe Raynaud ébauchait ainsi la première esquisse de ce tableau galant en réaction au Bicentenaire, et c’est en 1995 que Mona Ozouf devait le parachever en brossant un “essai sur la singularité française” agrémenté d’une guirlande de portraits de femmes.
Ce régime d’exception semble aujourd’hui remis en cause : l’irénisme érotique n’est plus de mise. Au tournant du siècle, il appartient déjà à l’histoire. Du moins si l’on prend pour indice l’imaginaire de la fiction, plutôt que des essais : à l’évidence, ni la littérature ni le cinéma contemporains ne renvoient l’image d’une sexualité épanouie, non plus que d’une harmonie entre les sexes.
Il est vrai que la fiction française, contrairement à sa réputation, se remet à parler du monde présent - au moment même où les essais se révèlent empreints de nostalgie. Et en matière de politique sexuelle, peut-être les débats de société simultanément soulevés à partir de 1997 par les lois sur le Pacte Civil de Solidarité et sur la parité sont-ils pour quelque chose dans ce changement de ton : désormais, on y réfléchit sans doute à deux fois avant de chanter la liberté de l’amour et l’empire des femmes dans notre pays.
Au roman rose succède ainsi le roman noir de la sexualité française - constat sévère ou dénonciation virulente. Nos deux dernières rentrées littéraires l’illustrent à merveille, l’une et l’autre également placées sous le signe d’une mise à la question de la sexualité, à la lumière d’une réflexion sur “la différence des sexes” (pour reprendre le vocabulaire du moment).
En particulier, chacune aura été marquée par un “événement” ou un “coup” (selon qu’on en ait), propulsant leurs auteurs dans la notoriété - en 1998, à l’occasion du deuxième roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires ; un an plus tard, autour d’un nouveau livre de Christine Angot, L’inceste. On s’attachera ici au premier, en attendant d’analyser ailleurs, avec la seconde, l’autre versant de notre roman noir contemporain.
Renonçons d’emblée à faire la part, dans de telles “affaires”, des œuvres et des auteurs, du talent littéraire et des provocations idéologiques. Sans doute se propose-t-on bien de traiter la littérature comme un “fait social”. Toutefois, plutôt que de limiter l’approche sociologique à l’étude de la réception, puis de réduire celle-ci à l’analyse du marketing éditorial et de la fabrication médiatique, on tentera d’appréhender le roman de l’intérieur, dans sa spécificité littéraire.
D’abord, en vue de cerner le discours sur la sexualité et la société qu’il développe. Ensuite, afin d’appréhender les conditions proprement littéraires de son efficacité sociale - car c’est bien en tant que littérature qu’il se fait entendre dans notre société. Non seulement le roman dit autre chose que l’essai, mais surtout, il le dit autrement. La sociologie de la littérature n’est pas condamnée à oublier qu’elle parle de littérature.
Une sociologie des classes moyennes
Michel Houellebecq parle de la réalité sociale, et il le revendique hautement. Son premier roman, Extension du domaine de la lutte, pouvait être lu comme la description d’un milieu (les cadres de l’informatique, dont l’auteur est issu), de lieux (Paris et la proche banlieue, Rouen ou La Roche-sur-Yon), de modes de vie (le Minitel rose, Radio-Nostalgie et les vacances de ski) et de consommation (les Trois Suisses, les Nouvelles Galeries, la Peugeot 104 et la 205 GTI).
La description ethnographique y débouchait sur une analyse à vocation sociologique : “Je me retourne, je lance à la cantonade, d’une voix forte : ‘J’ai rendez-vous avec un psychiatre !’ et je sors. Mort d’un cadre.” (EDL, 134). Ou bien : “Avouer qu’on a perdu sa voiture, c’est pratiquement se rayer du corps social” (EDL, 9). La sociologie des classes moyennes se confond ici avec sa dénonciation, où l’auteur rejoint le narrateur : “Je n’aime pas ce monde. Décidément, je ne l’aime pas. La société dans laquelle je vis me dégoûte ; la publicité m’écœure ; l’informatique me fait vomir.” (EDL, 82-83) On vomit d’ailleurs beaucoup chez Houellebecq.
On retrouve la même démarche dans Les particules élémentaires. Si l’on reconnaît des éléments identiques (l’hôpital et les psychiatres, les Trois Suisses) ou équivalents (Monoprix, le Gymnase Club), les lieux sont quelque peu différents (Meaux, mais aussi “la Côte”, l’Irlande), et le milieu diversifié (à côté du privé, avec la chirurgie esthétique, le public, avec le CNRS, côté scientifique, et le lycée, côté littéraire). Les boîtes échangistes ont remplacé les discothèques, et les déplacements professionnels en province ont cédé la place au camping sexuel, New Age ou naturiste.
De l’ethnographie, on passe pareillement à une forme de sociologie : les personnages sont des types sociaux, tel Bruno, “représentatif de son époque” (PÉ, 82), telle aussi sa mère Janine, qui entre dans “la décourageante catégorie des précurseurs” (PÉ, 34), tel enfin son demi-frère Michel, figure plus rare du “révolutionnaire” ou du “prophète” (ibid.). Enfin, le dégoût s’exprime moins désormais par la violence du rejet que dans une lassitude ironique :
Michel vivait dans un monde (...) rythmé par certaines cérémonies commerciales - le tournoi de Roland-Garros, Noël, le 31 décembre, le rendez-vous biannuel des catalogues 3 Suisses. Homosexuel, il aurait pu prendre part au Sidathon, ou à la Gay Pride. Libertin, il se serait enthousiasmé pour le Salon de l’érotisme. Plus sportif, il vivrait à cette même minute une étape pyrénéenne du Tour de France. Consommateur sans caractéristiques, il accueillait cependant avec joie le retour des quinzaines italiennes dans son Monoprix de quartier. (PÉ, 152)
L’ambition nouvelle, avec Les particules élémentaires, c’est que la sociologie du présent immédiat (la première partie s’ouvre le 1er juillet 1998, soit au lendemain du dépôt légal de l’ouvrage) s’inscrit dans une histoire de notre modernité - doublement tournée vers le passé et vers l’avenir. Sans doute en trouvait-on l’esquisse dans le roman précédent : le bruit de l’actualité accompagnait le récit (manifestations et grèves), mais surtout, le “mouvement historique” de l’uniformisation individualiste le portait : “Le troisième millénaire s’annonce bien.” (EDL, 16)
La perspective chronologique n’est pourtant pleinement développée que dans le nouvel ouvrage. L’histoire d’une génération (celle de l’auteur, né en 1958) y est présentée dans le prolongement de notre siècle, voire d’un stade moderne de la civilisation, qui nous conduit au seuil d’une “mutation métaphysique” (PÉ, 10). Aboutissement logique d’un individualisme radical, l’humanité nouvelle se reproduira demain par clonage : le roman se termine ainsi sur le mode de la science-fiction.
Au croisement de l’ethnographie et de l’histoire, la fiction se donne ici comme science du monde social. La référence scientifique jouait déjà dans le premier roman, où le narrateur proposait par exemple, sous l’égide de Claude Bernard, “le théorème central de (s)on apocritique.” (EDL, 93). Dans le second, elle est omniprésente - depuis le titre, jusqu’à l’utopie finale, de la physique d’Einstein et de Niels Bohr à la biologie de Michel Djerzinski et de son épigone Hubczejak. La science prend ainsi le relais des sciences humaines :
Le ridicule global dans lequel avaient subitement sombré, après des décennies de surestimation insensée, les travaux de Foucault, de Lacan, de Derrida et de Deleuze ne devait sur le moment laisser le champ libre à aucune pensée philosophique neuve, mais au contraire jeter le discrédit sur l’ensemble des intellectuels se réclamant des ‘sciences humaines’ ; la montée en puissance des scientifiques dans tous les domaines de la pensée était dès lors devenue inéluctable. (PÉ, 391)
De la même manière, la fiction prend le relais des sciences sociales. Les personnages eux-mêmes proposent leurs théories sociologiques. Parfois, ce sont celles que critiquent les romans de Houellebecq - comme lorsqu’un cadre esquisse une théorie libérale des réseaux : pour lui, “la liberté n’était rien d’autre que la possibilité d’établir des interconnexions variées entre individus, projets, organismes, services. Le maximum de liberté coïncidait selon lui avec le maximum de choix possibles.” (EDL, 40)
Plus souvent, les personnages font écho au narrateur, et à l’auteur. Ainsi, lorsqu’un prêtre parle de sexualité : “Notre civilisation souffre d’épuisement vital. Au siècle de Louis XIV, où l’appétit de vivre était grand, la culture officielle mettait l’accent sur la négation des plaisirs et de la chair”. Il n’en va plus de même aujourd’hui : “Nous avons besoin d’aventure et d’érotisme, car nous avons besoin de nous entendre répéter que la vie est merveilleuse et excitante ; et c’est bien entendu que nous en doutons un peu.” (EDL, 31-32)
Une critique de l’individualisme sexuel
Il est vrai que la théorie n’est guère novatrice - l’auteur ne l’ignore pas : “Comme la plupart des gens il estimait détestable cette tendance à l’atomisation sociale bien décrite par les sociologues et les commentateurs.” (PÉ, 193 - 194). Houellebecq reprend en effet à son compte la description et la dénonciation de l’individualisme moderne, en particulier du double mouvement d’uniformisation et de différenciation, les distinctions de détail complétant l’indifférenciation générale : d’un côté,
l’expérience m’a rapidement appris que je ne suis appelé qu’à rencontrer des gens sinon exactement identiques, du moins tout à fait similaires dans leurs coutumes, leurs opinions, leurs goûts, leur manière générale d’aborder la vie.
Mais d’un autre côté,
j’ai également eu l’occasion de me rendre compte que les êtres humains ont souvent à cœur de se singulariser par de subtiles et déplaisantes variations, défectuosités, traits de caractère et ainsi de suite - sans doute dans le but d’obliger leurs interlocuteurs à les traiter comme des individus à part entière. Ainsi l’un aimera le tennis, l’autre sera friand d’équitation, un troisième s’avèrera pratiquer le golf. (EDL, 21)
De même que Bruno rédige en sociologue son carnet de terrain dans un camping naturiste du Cap d’Agde, version “social-démocrate” d’une sexualité individualiste (“cet article devait être refusé de justesse par la revue Esprit”, PÉ, 267), de même, bien des analyses proposées dans l’un ou l’autre roman semblent inspirées par la lecture d’un sociologue de l’individualisme comme Gilles Lipovestky, que Houellebecq a pu lire au cours des années 1980.
À l’inverse, certaines de ses réflexions annoncent des analyses sociologiques sur “dépression et société”. Extension du domaine de la lutte était bien la chronique d’une dépression, symptôme de l’individualisme contemporain. Pour autant, l’auteur récusait toute interprétation psychique. Le narrateur explique son dégoût pour les femmes qui “lisent des bouquins sur le développement du langage chez l’enfant” (EDL, 5), sa détestation des “étudiantes en psychologie” - “des petites salopes, voilà ce que j’en pense” (EDL, 145) -, et surtout, sa haine des femmes en analyse : “Impitoyable école d’égoïsme, la psychanalyse s’attaque avec le plus grand cynisme à de braves filles un peu paumées pour les transformer en d’ignobles pétasses, d’un égocentrisme délirant, qui ne peuvent plus susciter qu’un légitime dégoût.” Aussi la rupture avec Véronique ne lui inspire-t-elle qu’un regret - “ne pas lui avoir tailladé les ovaires.” (EDL, 103, 105)
C’est que les discours “psy” participent du même individualisme que la dépression ; ils sont du côté du symptôme, non de l’explication. La psychologie fait donc obstacle à une approche sociologisante. C’est ainsi qu’à l’hôpital, le narrateur s’entend reprocher “de parler en termes trop généraux, trop sociologiques” : pour la psychologue,
je devais au contraire m’impliquer, essayer de me ‘recentrer sur moi-même’.
“Mais j’en ai un peu assez, de moi-même... objectais-je.
– En tant que psychologue je ne peux accepter un tel discours, ni le favoriser en aucune manière. En dissertant sur la société vous établissez une barrière derrière laquelle vous vous protégez ; c’est cette barrière qu’il m’appartient de détruire pour que nous puissions travailler sur vos problèmes personnels. (EDL, 145)
Or, toute l’analyse de Houellebecq tend à montrer que la dépression est un problème non pas personnel, mais social - justiciable d’une analyse sociologique, et non psychologique.
On songe aux travaux d’Alain Ehrenberg, pour qui la dépression est “la pathologie d’une société où la norme n’est plus fondée sur la culpabilité et la discipline mais sur la responsabilité et l’initiative.” Autrement dit, pour résumer ce basculement historique, la “fatigue d’être soi” remplace “l’angoisse névrotique” : “si, comme le pensait Freud, l’homme devient névrosé parce qu’il ne peut supporter le degré de renoncement exigé par la société’, il devient déprimé parce qu’il doit supporter l’illusion que tout lui est possible.” Cette pathologie de l’individu moderne nous rappellerait à l’inverse que tout n’est pas possible : c’est pourquoi “la dépression est le garde-fou de l’homme sans guide, et pas seulement sa misère”.
Nous sommes ici au plus près de Houellebecq : chez l’écrivain, le “domaine de la lutte” s’oppose au “domaine de la règle” (EDL, 14), comme chez le sociologue les règles sociales à l’initiative individuelle. D’ailleurs, avant de devenir pour la deuxième édition (sous la menace d’un procès) “Le lieu du changement”, le camping New Age des Particules élémentaires (paru en même temps que La fatigue d’être soi ) s’appelait justement “L’espace du possible”.
L’originalité de Houellebecq, c’est de fonder son analyse critique de l’individualisme libéral sur une économie politique de la sexualité. Tandis que son second roman raconte l’histoire de la montée en puissance “d’une consommation libidinale de masse” et “l’extension progressive du marché de la séduction” (PÉ, 35-36), il posait déjà dans le premier pour “théorème” que “la sexualité est un système de hiérarchie sociale.” (EDL, 93) Autrement dit, à côté du capital économique, il inscrit le capital sexuel :
Dans nos sociétés, le sexe représente bel et bien un second système de différenciation, tout à fait indépendant de l’argent (...). Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l’amour tous les jours ; d’autres cinq ou six fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l’amour avec des dizaines de femmes ; d’autres avec aucune. C’est ce qu’on appelle la ‘loi du marché’. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l’adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. (...) Le libéralisme économique, c’est l’extension du domaine de la lutte (...). De même, le libéralisme sexuel, c’est l’extension du domaine de la lutte (EDL, 100).
Sexualité et différence des sexes
À première vue, la charge contre la sexualité contemporaine semble concerner également les hommes et les femmes, homosexuels aussi bien qu’hétérosexuels : tous ne sont-ils pas de purs individus sur le marché sexuel ? Pourtant, lorsque “certains font l’amour avec des dizaines de femmes”, on comprend bien qu’il s’agit d’hétérosexualité, vue d’un point de vue masculin.
L’homosexualité n’est sans doute pas absente (du moins chez les hommes), mais elle apparaît essentiellement comme la pointe avancée de la consommation hédoniste : l’auteur l’évoque surtout pour son rôle moteur dans la double valorisation de la taille du pénis (PÉ, 238) et de la jeunesse des corps (PÉ, 131) - deux thèmes obsédants chez Houellebecq, il est vrai : “Comme en bien d’autres cas, les prétendus homosexuels avaient joué un rôle de modèle pour le reste de la société” (PÉ, 132) (prétendus, puisque leur “jeunisme” en ferait toujours des “pédérastes”).
En revanche, la dissymétrie entre les sexes joue un rôle fondamental dans l’analyse du marché de la sexualité. C’est vrai pour la misère sexuelle : “je le savais, elle avait tellement besoin d’être tronchée. Ce trou qu’elle avait au bas du ventre devait lui apparaître tellement inutile. Une bite, on peut toujours la sectionner ; mais comment oublier la vacuité d’un vagin ?” (EDL, 47) C’est tout aussi vrai dans la consommation : la sexualité de la femme semble la promettre à une mort certaine. Après Annick et Christiane, premier et dernier amour de Bruno, c’est le destin d’Annabelle, qui aura gâché sa vie dans un amour inutile pour Michel. Ils essaieront pourtant - mais trop tard : “Au milieu du suicide occidental, il était clair qu’ils n’avaient aucune chance.” (PÉ, 295) On remarquera toutefois que c’est Annabelle qui meurt, et non Michel : ils n’avaient aucune chance - elle moins encore que lui.
Si, à côté de ces femmes engageantes, mais périssables, l’un et l’autre romans sont peuplés de “boudins”, de “minettes” et de “vieilles peaux”, sans oublier une “mère dénaturée” archétypale, l’auteur n’ignore pas qu’il s’adresse aussi à des lectrices : “Il se peut, sympathique ami lecteur, que vous soyez vous-même une femme. Ne vous en faites pas, ce sont des choses qui arrivent.” (EDL, 15-16)
Houellebecq récuse par avance tout soupçon de misogynie : ne proclame-t-il pas la supériorité morale des femmes ? “Décidément, les femmes étaient meilleures que les hommes. Elles étaient plus caressantes, plus aimantes, plus compatissantes et plus douces”. Par contraste, “il est possible qu’à des époques antérieures, où les ours étaient nombreux, la virilité ait pu jouer un rôle spécifique et irremplaçable ; mais depuis quelques siècles, les hommes ne servaient visiblement à peu près plus à rien.” (PÉ, 205) L’auteur décline ainsi dans la presse les variations d’un slogan emprunté à la publicité, qui prendra in fine une coloration métaphysique : “Demain sera féminin.” (PÉ, 153 et 388).
Pourquoi, sur le marché sexuel des individus, cette dissymétrie entre les sexes ? L’explication est assez attendue : la libération de la sexualité aurait tué l’amour, qui était l’essence de la féminité : “l’âge d’or du sentiment amoureux”, durant “les années 50 et le début des années 60”, quand l’Église et le Parti portaient ensemble “le mariage d’amour”, a cédé la place à “l’option hédoniste-libidinale d’origine nord-américaine” (PÉ, 69-71).
Bref, la destruction des femmes, c’est le symbole d’une “génération sacrifiée” : “L’amour comme innocence et comme capacité d’illusion, comme aptitude à résumer l’ensemble de l’autre sexe à un seul être aimé, résiste rarement à une année de vagabondage sexuel, jamais à deux.” (EDL, 114) L’histoire de la sexualité se résume donc à l’autonomisation du plaisir, coupé de la reproduction : entre 1967 et 1975, de la loi Neuwirth sur la contraception à la loi Veil sur l’avortement, “l’agnosticisme de principe de la République française devait faciliter le triomphe hypocrite, progressif, et même légèrement sournois, de l’anthropologie matérialiste” (PÉ, 90).
Bien entendu, c’est (pour une large part) la faute au féminisme. Extension du domaine de la lutte s’ouvre sur un strip-tease dérisoire, dans une soirée entre collègues, avec “une connasse qui a commencé à se déshabiller” ; or, “c’est une fille qui ne couche avec personne”. En même temps, “deux boudins” approuvent la minijupe d’une “fille du service” : “elle avait bien le droit de s’habiller comme elle voulait”, “ça n’avait rien à voir avec le désir de séduire les mecs”. Pour le narrateur, ce sont là “les ultimes résidus, consternants, de la chute du féminisme.” (EDL, 5-6) Dans leur sagesse, les femmes font écho à cette dénonciation : “J’ai jamais pu encadrer les féministes”, explique Christiane à son amant dans Les particules élémentaires :
Ces salopes n’arrêtaient pas de parler de vaisselle et de partage des tâches ; elles étaient littéralement obsédées par la vaisselle. (...) En quelques années, elles réussissaient à transformer les mecs de leur entourage en névrosés impuissants et grincheux. À partir de ce moment - c’était absolument systématique - elles commençaient à éprouver la nostalgie de la virilité. Au bout du compte elles plaquaient leurs mecs pour se faire sauter par des machos latins à la con (...), puis elles se faisaient faire un gosse et se mettaient à préparer des confitures maison avec les fiches cuisine Marie-Claire. (PÉ, 182-183)
Le féminisme n’est donc pas accusé d’être au principe d’une libération de la sexualité, mais tout au contraire de mettre en péril la sexualité (à vrai dire, l’hétérosexualité). Sans doute l’indivualisme féministe contribue-t-il au partage entre sexe et procréation ; mais en même temps, dès lors qu’il parle de droits et d’égalité, il menace les hommes d’impuissance, et les femmes de frustration.
Car au fond, ce que celles-ci désirent de ceux-là, à l’instar de “la vache bretonne” dans une fable métaphysique du narrateur, n’est-ce pas, “comme le disent les éleveurs dans leur parler cynique, ‘se faire remplir’” ? (EDL, 10) Le problème, ce serait donc la reproduction ; mais pour Houellebecq, c’est aussi la solution. Notre époque a coupé la sexualité de la reproduction ; en retour, pourquoi ne pas arracher la reproduction à la sexualité ?
L’auteur prolonge ici Aldous Huxley : “Contrôle de plus en plus précis de la procréation, qui finira bien un jour ou l’autre par aboutir à sa dissociation totale d’avec le sexe (...). Disparition par conséquent des rapports familiaux, de la notion de paternité et de filiation. Élimination, grâce aux progrès pharmaceutiques, de la distinction entre les âges de la vie.” (PÉ, 195)
L’effacement individualiste de la différence des sexes et des générations nous entraînerait bien dans Le meilleur des mondes. D’où l’épilogue ironique sur le clonage, paradoxale subversion de l’individualité. “La fin de la sexualité comme modalité de la reproduction ne signifiait nullement - bien au contraire - la fin du plaisir sexuel.” En revanche, le clonage implique “la suppression des différences sexuelles” : “l’humanité devait disparaître ; l’humanité devait donner naissance à une nouvelle espèce, asexuée et immortelle, ayant dépassé l’individualité, la séparation et le devenir.” (PÉ, 389, 385) “Demain sera féminin” (PÉ, 388), repris en slogan pour la nouvelle mutation métaphysique, signifierait en réalité la disparition des sexes, et l’extension à tous du pouvoir féminin de la reproduction. Houellebecq résout ainsi par l’absurde, avec la science-fiction, les apories qu’il découvre dans notre modernité sexuelle.
Ni droite, ni gauche
Avec la différence des sexes et des générations, la filiation et le clonage, l’hétéro- mais aussi l’homosexualité, à l’évidence, Les particules élémentaires (tout comme, un an plus tard, L’inceste de Christine Angot) entre en résonance avec les débats qui traversent au même moment notre société. L’enjeu politique semble donc sans équivoque : dans les entretiens que donne Houellebecq, comme dans ses romans, la critique de la modernité est parfaitement explicite : “Tout ennemi de la liberté individuelle peut devenir un allié objectif. Je n’ai qu’un ennemi : le libertaire, le libéral. Le libertaire est un libéral en puissance, avec quelques cas particulièrement horribles, comme le sataniste ou l’écologiste radical.”
Les choses semblent donc tout à fait claires : Houellebecq dénonce la mondialisation, et répète partout que c’est contre Maastricht qu’il a voté pour la dernière fois. S’il peut dire avec coquetterie : “bon, c’est vrai, j’aime bien Staline”, c’est pour préciser aussitôt : “Parce qu’il a tué plein d’anarchistes.” Et lorsqu’il évoque avec nostalgie le double pilier, catholique et communiste, de la société française des années 1950, on songe à un autre contempteur de l’individualisme contemporain qui se réclame aussi d’une sociologie - le Paul Yonnet du Voyage au centre du malaise français.
Il est d’autant plus frappant que les commentateurs, comme déroutés par son ton pince-sans-rire, se soient montrés aussi embarrassés pour en proposer une lecture politique : “Karl Marx du sexe”, ou bien “notre Céline à nous” ? Dans les entretiens, Houellebecq s’amuse d’ailleurs de ces malentendus : “Allez y comprendre quelque chose ! Prenez les rédacteurs d’Immédiatement, une revue catholique et royaliste qui m’a soutenu autrefois : eh bien, ils sont furieux. Pour eux, j’ai écrit un live d’extrême-gauche branché.” À l’inverse, qu’on n’aille pas croire cet antimoderne passéiste : “Je ne suis pas réactionnaire. Pour l’être, il faudrait croire qu’on peut revenir en arrière. Or tout est irréversible. Je peux être au contraire d’un progressisme choquant” - par exemple, en parlant d’eugénisme. Sans doute dénonce-t-il l’avortement ; mais en même temps, il ne récuse pas a priori le clonage... Sans doute déplore-t-il notre modernité sans Dieu dans des romans hantés par la religion ; mais en même temps, il se proclame athée, pour raconter l’histoire d’une béance spirituelle. S’il joue ainsi, c’est pour déjouer les catégories politiques.
Pour comprendre l’embarras des critiques, il convient d’abord de prêter attention à la rhétorique de Houellebecq. Pour mieux l’appréhender, il convient de l’inscrire dans deux traditions intellectuelles, littéraire et idéologique, qui s’attachent, chacune à sa manière, à subvertir les clivages politiques traditionnels.
La première filiation nous entraîne vers une autre fin de siècle, avec Villiers de l’Isle-Adam. L’Ève future, publiée en 1886, proposait déjà en effet l’utopie futuriste d’une humanité réinventée par la science. Il est vrai que Thomas Edison n’y fabriquait qu’un prototype, destiné à s’abîmer dans les eaux ; et surtout que, loin de dépasser la différence des sexes, le savant s’employait à imaginer la femme parfaite. On retrouve pourtant chez l’écrivain décadent l’essentiel du propos de Houellebecq - du rejet de la modernité, bourgeoise ou libérale, à l’idéalisation de la femme, remède à la modernité, en passant par l’ambivalence de la référence religieuse, mais aussi scientifique : la science-fiction permettait également à Villiers de l’Isle-Adam de sortir de la fin de siècle - vers l’avenir, et par l’absurde. Et comme Houellebecq, ce réactionnaire pouvait ainsi se montrer d’un progressisme choquant - déroutant pour ses contemporains.
La deuxième filiation nous ramène, plus près de nous, à l’entre-deux-guerres. Aux États-Unis, les comptes rendus n’ont pas manqué de souligner l’antiaméricanisme du romancier. Encore faut-il bien s’entendre : il ne s’agit plus, comme c’était le cas pour le roman rose de la sexualité, de préserver l’exception française par contraste avec l’Amérique. Dans la version noire qu’écrit Houellebecq, l’américanisation est irrémédiablement en marche : “Il n’y a aucun exemple qu’une mode venue des États-Unis n’ait pas réussi à submerger l’Europe occidentale quelques années plus tard ; aucun.” Pas plus “les seins siliconés” que “l’allongement des bites” (PÉ, 93). Aussi Seth Armus parle-t-il justement, en référence à la traduction des Scènes de la vie future de Georges Duhamel, d’une “menace américaine”.
Par son antilibéralisme, Houellebecq renoue avec la génération des “non-conformistes” des années 1930, “faisant écho à Georges Bernanos, Emmanuel Mounier, Robert Aron, ainsi qu’à une vieille tradition française d’auto-critique exigeant une résurgence spirituelle, sans trouver d’amis à droite non plus qu’à gauche.”
Cette critique du capitalisme nourrie de personnalisme, Luc Boltanski l’avait bien montré, a joué un rôle important dans la définition idéologique d’un groupe social dont Houellebecq a précisément fait le portrait sociologique : les cadres. En revanche, on voit aussi comment elle n’entre plus dans le modèle analytique que développe le sociologue dans son dernier ouvrage. Avec Ève Chiapello, Luc Boltanski propose en effet de distinguer (pour les dépasser) deux figures de la critique du capitalisme. D’une part, la “critique artiste” : nourrie d’un “mode de vie bohème”, elle revendique, contre l’inauthenticité du monde bourgeois, la liberté de l’artiste. D’autre part, la “critique sociale” : “inspirée des socialistes”, elle dénonce l’égoïsme des uns, et la misère des autres. Autrement dit, ce pourraient être Baudelaire et Marx.
À l’évidence, l’antilibéralisme sexuel de Houellebecq n’entre dans aucune des deux catégories. Sans doute, hostile à l’individualisme esthétisant de la première, se prend-il à rêver, dans un lexique qui rappelle la seconde, de sexualité “social-démocrate” (PÉ, 269), voire de “communisme sexuel” - mais sans y croire (PÉ, 171). Et de fait, il met l’accent sur la récupération (qu’analyse aussi Boltanski) de la critique artiste (post-soixante-huitarde) par le capitalisme (des années quatre-vingt) : le libertaire est ainsi accusé de servir le libéral.
Pour autant, l’inégalité économique que prend pour cible la critique sociale lui sert uniquement de métaphore pour penser l’inégalité sexuelle. L’égalité revendiquée par celle-ci ne l’inspire pas plus que la liberté préconisée par celle-là, car c’est bien contre le matérialisme moderne que se définit ce personnaliste athée.
S’il emprunte au New Age pour mettre au goût du jour le “positivisme religieux de Comte”, c’est qu’à ses yeux, cette “idéologie confuse et bâtarde” a du moins le mérite de manifester “une réelle volonté de rupture avec le XXe siècle, son immoralisme, son individualisme, son aspect libertaire et antisocial”, témoignant “d’une conscience angoissée qu’aucune société n’est viable sans l’axe fédérateur d’une religion quelconque” (PÉ, 387, 388).
Si donc aujourd’hui les lecteurs ont quelque peine à situer idéologiquement l’œuvre de Houellebecq, c’est peut-être aussi qu’on oublie de penser cette autre critique du capitalisme, qui se donnait dans l’entre-deux-guerres comme une “troisième voie” - et qui reprend sa place dans notre paysage idéologique au moment même où un Boltanski tenter de dépasser l’alternative entre critique artiste et critique sociale.
Un pacte littéraire paradoxal
Il est enfin une autre explication à l’embarras des commentateurs : beaucoup ne savent trop sur quel ton réagir à la lecture. Faut-il prendre au sérieux cet humour noir ? Ou bien serait-ce manquer d’humour que de ne pas rire ? C’est là toute la difficulté. Au lecteur qui serait mal à l’aise, devant la violence sexuelle et raciale du roman, une phrase en exergue souffle ainsi une réponse : “Ah oui, c’était au second degré ! On respire...” (EDL, 123) Pourtant, lorsque Houellebecq dialogue avec Bret Easton Ellis, alors que l’Américain regrette qu’on prenne ses “livres pour argent comptant” (leur violence ressemble à la société, non à l’auteur), c’est le Français qui déplore qu’“à l’inverse, on ne prend pas suffisamment mes livres au premier degré. (...) Je critique le Mal, mais les gens croient que je plaisante.” Mais peut-être plaisante-t-il cette fois ? On reconnaît là le paradoxe du menteur.
C’est bien sûr le lecteur qui se trouve pris dans le double jeu de l’ironie - tour à tour trop crédule ou trop sceptique, ou bien à la fois trop léger et trop sérieux. La difficulté redouble : comment interpréter le contenu politique manifeste dans ces romans ? Houellebecq lui-même nous met en garde, dans le même entretien : “En France, on me voit plutôt comme l’incarnation du politiquement incorrect.” Est-ce à dire qu’une lecture politique de son œuvre est vouée à être “politiquement correcte” ? De fait, “toute personne faisant une lecture politique de mon livre est forcément mécontente.” L’accord n’est pas possible : c’est bien qu’il ne s’agit pas seulement de désaccord. N’est-ce pas plutôt qu’on serait toujours, inévitablement, dans le malentendu ? Autrement dit, la lecture politique serait nécessairement au “premier degré” : littérale, elle serait “forcément” politiquement correcte.
On devine l’explication : c’est qu’il s’agit de littérature - de fiction. Fût-il sociologique, le roman n’est pas un essai. Certes, Houellebecq n’ignore pas les problèmes esthétiques que sa vision de notre société pose au roman : “Cet effacement progressif des relations humaines n’est pas sans poser certains problèmes au roman.” En effet, “la forme romanesque n’est pas conçue pour peindre l’indifférence, ni le néant ; il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne.” (EDL, 42) L’auteur n’hésite pas non plus à aborder (par la bouche de Bruno) les problèmes sociaux que pose à la littérature la société de consommation :
Philippe Sollers semblait être un écrivain connu ; pourtant, la lecture de Femmes le montrait avec évidence, il ne réussissait à tringler que de vieilles putes appartenant aux milieux culturels ; les minettes, visiblement, préféraient les chanteurs. Dans ces conditions, à quoi bon publier des poèmes à la con dans une revue merdique ? (PÉ, 230)
Bref, dans la logique même de Houellebecq, il se pourrait bien que la littérature fût devenue, sous le coup de l’individualisme libéral, esthétiquement impossible, et socialement inutile.
Pourtant, Houellebecq n’en continue pas moins de revendiquer pour le roman tout à la fois l’efficacité et l’irresponsabilité sociales. D’une part, la littérature dit la vérité du monde : elle est la science de notre société. Mais d’autre part, on ne saurait lui demander des comptes, à moins d’être politiquement correct. Comment sceller ce pacte littéraire ambigu ? C’est ici qu’intervient Sollers - le personnage des Particules élémentaires, mais aussi l’écrivain lui-même. Devant les médias, l’écrivain revendique la distinction d’avec son personnage : “D’emblée, il y a confusion entre la réalité et la fiction. On est au cœur du sujet : comment, immédiatement, les gens réduisent une œuvre d’imagination à des positions idéologiques.” Mais ce faisant, l’écrivain joue précisément le rôle de son personnage dans le roman.
En effet, Sollers, éditeur de Bruno, apprécie son texte sur Jean-Paul II : “Vous êtes réactionnaire, c’est bien. Tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski : que des réactionnaires. Mais il faut baiser, aussi, hein ? Il faut partouzer. C’est important.” (PÉ, 229) Plus loin, commentant avec bonne humeur un autre texte (sur les “nègres”, “animaux dotés d’une grosse bite et d’un tout petit cerveau reptilien”) :
Vous êtes authentiquement raciste, ça se sent, ça vous porte, c’est bien. (...) C’est corsé, enlevé, très talon rouge. Vous avez du talent. Des facilités parfois. J’ai moins aimé le sous-titre : On ne naît pas raciste, on le devient. Le détournement, le second degré, c’est un peu... (...) Pas trop d’influences, en plus rien d’écrasant. Par exemple, vous n’êtes pas antisémite !
Sans doute ne le publiera-t-il pas : “Nous ne sommes plus au temps de Céline, vous savez. On n’écrit plus ce qu’on veut, aujourd’hui, sur certains sujets.” (PÉ, 243, 244) Du moins Sollers, le personnage, a-t-il donné l’exemple : plein d’humour, il est tout sauf politiquement correct.
On comprend mieux, dès lors, la provocation idéologique dans l’œuvre de Houellebecq. Elle a pour fonction de prouver qu’il s’agit bien de littérature. Plus les romans sont politiquement choquants, plus ils doivent être littéraires. Sinon, pourquoi s’en accommoderait-on ? Inversement, pour être littéraires, les romans se devront tout naturellement d’être provocants : pour devenir Céline, on commencera ainsi par être antisémite. Des mauvais sentiments naîtra sûrement la bonne littérature. D’où l’importance de Sollers dans ce dispositif. En France, la littérature s’est affranchie de tout jugement idéologique à l’heure du formalisme, à l’époque de Tel Quel. Aujourd’hui, alors même qu’elle ambitionne de parler du monde social, pour préserver cette absolue liberté que lui donnait la gratuité, il lui faut la garantie d’un esthète.
Voilà pourquoi Houellebecq fait équipe avec Sollers : la seule liberté que goûte le premier, c’est celle que lui offre le second. En effet, le libertin affranchit la littérature du monde social dont l’antilibéral entreprend dans le même temps de rendre compte. Ce qu’il nous faut maintenant tenter d’imaginer, c’est ce qui se passerait si, d’aventure, nonobstant Sollers, un lecteur venait à suggérer que les romans de Houellebecq ne sont pas de si bonne littérature. Le charme du pacte littéraire serait rompu : il faudrait bien lire ces textes “au premier degré”. Ils retomberaient sur terre. Chacun verrait alors avec quelque embarras que Michel Houellebecq, qui chante l’été sur les podiums des plages, comme pour réaliser en différé quelque rêve d’adolescent des années 1970, loin d’être délicieusement kitsch, était simplement nu - et tous se demanderaient pourquoi ils ne s’en étaient pas aperçus plus tôt.


