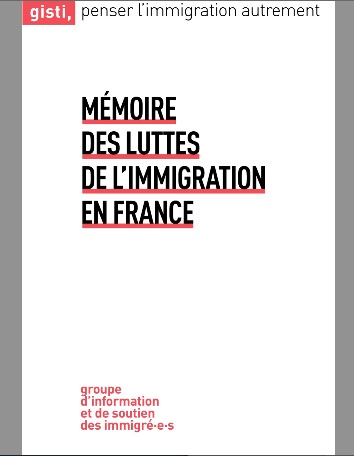Des comités anti-expulsion des années 1970 au Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB), les combats contre la double peine n’ont pas cessé. Pourtant, la double peine existe toujours, symbole d’une véritable discrimination institutionnelle à l’égard des non-nationaux.
À la fin des années 1970, les expulsions de jeunes issus de l’immigration de nationalité étrangère se multiplient. La société française n’a pas encore pris conscience du caractère familial et pérenne de l’immigration, mais les enfants devenus grands sont déjà souvent stigmatisés comme chômeurs indésirables et délinquants. Beaucoup de jeunes expulsés résistent, individuellement ou collectivement. Des comités anti-expulsion se constituent autour d’eux avec les familles et des amis, parfois rejoints par des personnalités ou des militants d’associations antiracistes. De jeunes expulsés qui se considèrent chez eux en France se maintiennent sur le territoire ou reviennent clandestinement. Quelques-uns obtiennent l’annulation de leur expulsion.
Mais la situation d’expulsé en sursis peut durer des années (certains ne sont toujours pas régularisés). D’autres s’enferment sur eux-mêmes ou craquent. En 1980, Ali, de Colombes, s’immole gare Saint-Lazare, à une heure de grande affluence. Ces drames provoquent un début de prise de conscience, et des réseaux informels de jeunes immigrés commencent à se constituer.
C’est dans ce contexte que des hommes d’Église, comme François Lefort à Nanterre ou Christian Delorme et Jean Costil à Lyon, tentent d’attirer l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur la situation des jeunes expulsés. En 1981, la grève de la faim à Lyon de Delorme, Costil et Hamid Boukhrouma propulse la question sur le devant de la scène, en pleine période électorale. Le ministre de l’intérieur Christian Bonnet décide de suspendre les expulsions la veille de la victoire de François Mitterrand, puis le nouveau gouvernement socialiste s’engage à faire revenir les expulsés au sein de leur famille. La loi du 29 octobre 1981 définit des « catégories protégées » de l’éloignement parmi lesquelles les mineurs – protégés en toutes circonstances –, les étrangers nés en France, ceux arrivés avant l’âge de dix ans ou qui résident en France depuis plus de quinze ans ; l’éloignement reste cependant possible en cas d’urgence absolue, c’est-à-dire s’il y a « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique », ou en cas de condamnation à une peine égale ou supérieure à un an de prison ferme.
1983 - 1989 : de la remise en cause des « catégories protégées » à l’oubli des expulsés
Mais sous la pression de syndicats de policiers qui, notamment aux Minguettes (dans la banlieue de Lyon), dénoncent l’arrêt des expulsions de délinquants, la gauche de gouvernement revient peu à peu sur les dispositions qu’elle avait prises et qui sont jugées « excessivement protectrices ». Avec l’adoption de la loi du 17 juillet 1984, elle avalise la possibilité d’expulser pour « récidive » les « délinquants d’habitude ». Dans les coulisses du pouvoir, il se dit que l’opération de régularisation et l’arrêt des expulsions ont été des erreurs, susceptibles de coûter cher à la gauche lors des prochaines consultations électorales.
La droite revenue au pouvoir aura les coudées franches. Malgré la grève de la faim de Djida Tazdaït et de Nacer Zaïr des JALB (Jeunes Arabes de Lyon et banlieue), en juin 1986, pour « le maintien des catégories protégées et des garanties judiciaires », soutenue par le réseau national « J’y suis, j’y reste », malgré l’intervention de Mgr Decourtray et du pape auprès de la « deuxième droite » incarnée par Philippe Séguin alors aux affaires sociales, le ministre de l’intérieur Charles Pasqua renoue avec les expulsions médiatisées à grande échelle [1].
Il fera même usage de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui permettait d’expulser des jeunes de nationalité algérienne « oisifs de leur propre fait depuis plus de six mois ». La gauche et les associations, elles, se remobilisent contre « les expulsions arbitraires » et constituent le Collectif des 120 qui se réunit régulièrement à la Ligue des droits de l’Homme. Le rétablissement de dispositions législatives plus favorables est à l’ordre du jour, et le président de la République déclare, le 9 janvier 1989, à la Sorbonne, que les étrangers condamnés ne doivent pas subir par l’expulsion « une exclusion supplémentaire ».
La loi Joxe du 2 août 1989, brocardée comme « la loi des associations », restaure en partie les garanties contre l’expulsion des personnes ayant des attaches personnelles ou familiales en France. Elle abandonne pourtant à leur sort les nombreux « expulsés Pasqua », et ne revient ni sur l’expulsion en « urgence absolue » ni sur le caractère définitif de certaines interdictions du territoire prononcées par des juges en vertu de la loi du 31 décembre 1970, articles L. 627 et L. 630-1 du code de la santé publique en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Ce « bannissement à vie », aggravé par la loi du 31 décembre 1987 (dite « loi Chalandon ») stipulant que le relèvement de l’interdiction définitive du territoire français (IDTF) est impossible, avait commencé à faire débat. Le Collectif des 120 se dissout, et on entend ici ou là des affirmations selon lesquelles « on ne peut quand même pas défendre des drogués et des violeurs » ou que, de toute façon, la question des expulsés est un problème « résiduel » amené à se tarir tout seul dans la mesure où les jeunes issus de l’immigration ont vocation à devenir français. Un profond et amer sentiment d’abandon se diffuse alors parmi les personnes directement concernées. Elles ressentent la hagra, mélange d’indifférence, de mépris et d’injustice.
Le Comité national contre la double peine
Début 1990, plusieurs expulsables sortis de prison font le tour des associations à la recherche de soutiens, mais on leur fait comprendre que leurs cas sont indéfendables ou, à tout le moins, que les associations ne sont pas compétentes en la matière. Ils se mettent alors en tête de se défendre eux-mêmes. Mohamed Hocine, des Mureaux, jeune de nationalité algérienne né en France, et Boualem, de Melun, père d’enfants français, tous deux touchés par ce qu’ils appellent une « double peine », se mobilisent aux côtés des militants de Résistance des banlieues, un collectif inter-villes de la banlieue de Paris animé entre autres par des acteurs de la Marche pour l’égalité de 1983 ou de Convergence 84. Ces derniers, qui ont aussi participé en 1989 à la campagne de Djida Tazdaït pour son élection au Parlement européen (sur la liste des Verts), mettent à profit les réseaux tissés pendant le « mouvement beur » et une certaine expertise juridique.
Ils se retrouvent dans la capitale, place de la Réunion, où ils fraternisent avec les mal-logés en lutte et avec des militants des squats. Ils trouvent là les conditions (hébergement, nourriture, etc.) pour vivre dans une clandestinité relative – ils sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion – tout en s’exprimant publiquement à visage découvert. Ils interviennent aussi dans l’émission de radio Parloir Libre, très écoutée par les détenus. Pour répondre à l’afflux de cas particuliers qui leur parviennent en retour, ils décident de créer le Comité national contre la double peine (CNCDP) et, quelque temps après, l’Association de soutien aux expulsés et à leur famille (Asef). D’emblée, l’objectif est de donner une dimension collective aux démarches de recours, à la fois pour mutualiser les frais engagés jusque-là à titre individuel et pour poser la question de la double peine sur le terrain politique. Les discussions – animées ! – avec le Mrap, Mémoire Fertile, la Cimade, la Fasti et le Gisti permettent de constituer, le 13 juin 1990, un Collectif des associations contre la double peine autour d’une plate-forme commune. Celle-ci demande des modifications législatives pour rendre inexpulsables les étrangers titulaires d’une carte de résident : abrogation de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’« urgence absolue » et de la loi Chalandon, abrogation des expulsions antérieures et mise en place d’une grâce collective pour les personnes appartenant aux « catégories protégées » sous le coup d’une interdiction du territoire français (ITF).
Une campagne d’interpellation pugnace des associations institutionnalisées faisant la politique de l’autruche par rapport à la double peine est lancée avec, en particulier, l’occupation de SOS-Racisme. Le Comité fait aussi une irruption spectaculaire à la tribune officielle des assises « Banlieue 89 » à Bron (Rhône). Simultanément, il dépose au ministère de l’intérieur les premiers dossiers sous forme de « fiches techniques » et reçoit ses premières réponses positives : des assignations à résidence avec droit au travail, quelques abrogations ou grâces, ainsi que l’engagement de petites subventions pour tenir une permanence juridique à l’Asef. En un an, plus de mille dossiers sont traités par un petit groupe renforcé avec l’arrivée de nouveaux « double peine » comme Alberto, grand malade [2], ou Fatiha Damiche, femme de détenu, qui se révéleront de redoutables « juristes de terrain ».
Des rencontres ont lieu à plusieurs reprises avec le ministre de la justice, Henri Nallet, le directeur des libertés publiques ou le Haut Conseil à l’intégration (HCI). En dépit d’une réelle volonté d’aborder la double peine sur le fond, les interlocuteurs du Comité font preuve de frilosité politique en opposant constamment le contexte politique marqué par la hantise du Front national. Pour le HCI, la modification souhaitée de la loi « est juridiquement, techniquement facile », mais « associer, politiquement, les trois mots de drogue, d’étrangers et d’indulgence (ou de laxisme), dans le contexte actuel, comporte des risques, notamment médiatiques, qu’il faut peser avec une balance d’apothicaire [3] ».
Le Comité considère, lui, que des modifications législatives techniques et partielles adoptées en catimini ne seraient pas mises en application par les préfets et les juges. Il préconise au contraire une large campagne publique afin d’expliquer pourquoi il faut abolir définitivement le principe même de la double peine. « Y’en a marre d’en avoir marre ! » scandent plus de cinq cents personnes lors d’une rencontre nationale des « double peine » le 14 décembre 1991 à la Bourse du travail de Saint-Denis. Une grève de la faim collective y est décidée. Philippe Marchand, ministre de l’intérieur, annonce alors aux futurs grévistes sur un plateau de télévision : « la double peine, c’est fini ! » La loi Sapin, adoptée le 31 décembre 1989, rend effectivement inexpulsables certaines « catégories protégées », se mettant ainsi en conformité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au respect de la vie privée et familiale, et ouvre la possibilité de faire une demande de relevé d’ITF auprès du tribunal qui l’a prononcée. Elle permet aussi de revenir sur des arrêtés d’expulsion antérieurs. Mais elle ne remet pas en cause le principe même de la double peine laissé au pouvoir d’appréciation des juges. Les expulsions restent d’actualité selon la gravité des infractions commises ou en vertu de l’article 26, l’« urgence absolue » étant de plus en plus invoquée pour contourner les garanties inscrites dans la loi. Et elle n’offre aucune garantie quant à l’abrogation des arrêtés d’expulsion Pasqua et le retour des expulsés au sein de leur famille avec délivrance automatique des papiers de plein droit [4].
2 janvier - 22 février 1992 : une grève de la faim nationale
Le 2 janvier 1992, dix-neuf personnes entament donc une grève de la faim dans les locaux de la Cimade à Paris. Cinq Lyonnais passent plusieurs jours avec eux, puis sept « double peine » se mettent en grève à Lyon avec les JALB, du 14 janvier au 8 février. La députée européenne Djida Tazdaït elle-même suit le jeûne. À Lille, vingt et une personnes observent un jeûne de solidarité les 22 et 23 janvier. À la prison de Fresnes, Ahmed Boukechiche, un Algérien sous le coup d’une expulsion en urgence absolue, cesse de s’alimenter dès le début du mouvement. D’autres prisonniers suivront, parmi lesquels soixante femmes de la maison d’arrêt de Fleury. Les femmes, concubines, mères, sœurs ou filles des expulsés montent en première ligne. Avec l’opération « Drapeau blanc des femmes de la double peine », elles multiplient les actions pour affirmer leur solidarité avec les grévistes emprisonnés soumis à l’isolement, se rendent à l’Élysée pour appuyer une demande de grâce collective, et occupent le siège du Parti socialiste. L’apparition au grand jour des femmes et des proches modifiera l’image publique des « double peine » : il ne s’agit plus de quelques jeunes délinquants marginaux, mais de personnes d’âge mûr et de familles entières dont la vie se trouve brisée.
Les grévistes de la faim, quant à eux, ne tiennent plus en place. Ils ne supportent pas de rester allongés sur leur matelas, à voir le défilé des soutiens. Ils sortent de l’église réformée des Batignolles, où ils ont transféré leur QG, pour participer en groupe à des actions de rue. Des observateurs en tireront la conclusion que leur grève de la faim est un simulacre. Qu’importe. Le 1er février, ils manifestent place Saint-Augustin, revêtus d’une camisole de bagnards, sous le mot d’ordre : « On se rend ou rendez-nous nos papiers ! » Certains grévistes sont portés sur des brancards. Le 9, ils se présentent au tribunal de Créteil pour soutenir un des leurs, Hocine Elab, qui comparaît pour refus d’embarquer. Et le 16 février, ils manifestent avec plusieurs centaines de personnes en direction du commissariat de police de Barbès (18e arrondissement de Paris). Puisqu’ils sont considérés comme des délinquants en situation irrégulière, trois délégués des grévistes demandent au commissaire qui les reçoit de les arrêter sur-le-champ. Ils ressortent du commissariat libres, provoquant l’hilarité générale.
Quelque temps après, un motard apporte un pli du ministère qui annonce l’abrogation des arrêtés d’expulsion de plusieurs grévistes, ou des assignations à résidence. Il y a aussi quelques refus. Au 52e jour, la grève est arrêtée sur ce résultat mitigé.
Par la suite, le Comité obtiendra, à force d’obstination, quelques centaines de régularisations avec restitution des papiers. Mais la double peine existe encore, et de nombreux étrangers censés faire partie des « catégories protégées » sont toujours menacés d’expulsion faute de régularisation définitive [5] . Contrairement à une idée fort répandue, ces militants ne se focalisent pas exclusivement sur la double peine. Ils se battent aussi, et avant tout, sur les différents fronts de la hagra en banlieue (discriminations en matière de logement, violences policières, droit à la santé, au travail ou à la scolarité, etc.). Au point, trop souvent, de négliger leur situation personnelle. Cette implication, juridique et politique, les amènera, trois ans plus tard, à la création du MIB, Mouvement de l’immigration et des banlieues. Cependant, pour le Comité national contre la double peine et le MIB, la double peine reste emblématique d’une discrimination institutionnelle flagrante à l’égard des non-nationaux que seule une détermination politique forte pourra abolir.