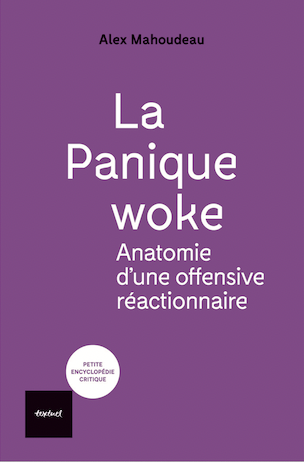
Le terme « woke » a une généalogie qui précède la panique et qu’il ne faut pas minimiser, notamment parce que le développement de cette panique s’appuie sur le détournement, dans un sens négatif, d’un slogan lié à un mouvement social antiraciste.
Toutefois, le terme connaît un réel succès dans le débat public et particulièrement dans les pages d’opinion, dans le cadre du développement de la panique morale, et est utilisé de façon quasi-univoque sur le thème du danger ou de la menace. Il change d’ailleurs quasiment immédiatement de sens : si le mouvement BLM s’est d’abord développé dans la rue, à travers l’action d’activistes noirs, le « wokisme » est généralement présenté comme étant d’origine universitaire, et concernant des étudiants blancs rongés de culpabilité.
En France, quelques interventions reprennent le terme pour se le réapproprier, comme le fait de façon emblématique la candidate à l’investiture écologiste Sandrine Rousseau, interrogée sur son rapport au « wokisme » par Ruth Elkrief durant l’un des débats de la primaire écologiste, ou le député LFI Alexis Corbière face à Laurence Ferrari.
D’autres personnes affublées de ce stigmate n’ont pas choisi la stratégie de la reprise mais ont préféré au contraire dénoncer les mésusages du terme, tout en rappelant ses origines comme slogan ou comme mot employé par le mouvement antiraciste, notamment en ce qui concerne les personnes noires aux États-Unis.
Dès lors, la notion de « woke » et son dérivé idéologique supposé, le « wokisme », prennent corps dans le débat public de la fin 2021 sous deux sens bien établis : soit les termes sont employés comme une dénonciation par des acteurs qui s’en méfient, soit ils sont employés par des acteurs accusés de s’en faire les importateurs, pour se réapproprier le stigmate ou pour critiquer le mot.
Le terme tel qu’il est construit conduit en effet à une telle attitude : s’il n’existe pas de « manifeste wokiste » (bien que des ouvrages aient pu, selon les points de vue, être traités comme tels), la littérature dénonçant le « wokisme » se révèle relativement cohérente.
Indépendamment de la thématique du « wokisme », l’attribution des problèmes politiques au fait que la jeune génération serait excessivement sensible, dû à une vie de confort, fait l’objet d’une certaine popularité dans les milieux conservateurs durant les années 2010. Barbara Lefebvre décrit par exemple, dans un ouvrage de 2018, les dérives de la Génération « J’ai le droit » (2018), tandis que Caroline Fourest alerte sur celles de la Génération Offensée (2020).
Plus qu’une hypothèse à prouver, cette idée est généralement prise comme un fait établi sur lequel il s’agirait d’alerter ou qu’il conviendrait d’expliquer, généralement par une variation autour du thème de l’irrationalité, des réseaux sociaux ou des écrans en général, des parents laxistes et de la douceur de vivre de l’époque contemporaine, qui préserverait ses bambins des difficultés de la vie.
Pourtant, même si la fameuse « génération de jeunes cocoonés par des parents-hélicoptère » (bien que les « millenials » en question approchent la quarantaine) n’a pas grandi dans l’ambiance terrifiante de la Guerre froide, sa vie n’a pas non plus été sans accrocs, du militarisme des années Bush à la multiplication de l’endettement étudiant, de la crise des subprimes à un marché du travail précarisé, par exemple.
Toutefois, des auteurs comme ceux de The Coddling of the American Mind ouvrent leur texte sur un tel constat : « Ce qui est nouveau, c’est le point de départ selon lequel les étudiants sont fragiles. Même ceux qui ne le sont pas eux-mêmes croient que les autres sont en danger et ont donc besoin d’être protégés. Il n’y a pas d’attente à ce qu’ils se renforcent en rencontrant des textes ou discours qu’ils qualifient de “provocants” [triggering] » (2018, p. 17). Cette attitude les pousserait à des attitudes de censure.
En effet, l’idée que les universités sont des lieux particulièrement touchés par les excès d’un militantisme par trop sensible aux questions « d’identité » et à la radicalité, notamment de gauche, n’est un thème nouveau dans le discours conservateur, ni aux États-Unis, ni en France. La polémique ayant directement précédé celle sur le « wokisme » concernait, dans ce dernier pays, « l’islamo-gauchisme » et le « racialisme », dont le thème était essentiellement le même : des activistes d’extrême-gauche situés sur les campus auraient abandonné le sujet de la lutte des classes en faveur d’une approche compassée des minorités (notamment racisées et religieuses). Cette approche les conduirait à une forme de radicalité et de valorisation d’un climat de censure.
À l’automne 2020, c’est la question de la « cancel culture » qui agitait essentiellement les mêmes milieux, à propos des mêmes sujets. Les années précédentes avaient vu les accusations « d’indigénisme » et de « communautarisme » porter les mêmes accusations, cette fois-ci en se centrant sur l’effet supposé du Parti des Indigènes de la République d’une part, et sur le « néoféminisme intersectionnel » d’autre part.
En 2019, plusieurs événements avaient ainsi fait scandale. La décision, à la suite de pressions de manifestantes locales, d’annuler une conférence de la philosophe Sylviane Agacinski, venue y présenter ses oppositions à la gestation pour autrui, avait ainsi été reçue comme une censure de la part d’activistes LGBT+ envers une intellectuelle engagée (Leboucq, 2019), tandis que celle d’annuler une représentation de la pièce d’Eschylle Les Suppliantes, dont une partie des acteurs était maquillée d’une façon qui rappelait des pratiques de grimage relevant de la caricature raciste, était décrite comme l’effet des excès de l’antiracisme, notamment (Carpentier, 2019).
Dans le même temps, le fait que certaines universités proposent des contenus orientés vers le thème du racisme ou de l’intersectionnalité faisait aussi scandale, par exemple à Lyon (Sugy, 2019) ou, quelques années avant, à Créteil (Beyer, 2017).
Au début des années 2010, c’était le verrouillage supposé des départements de sciences sociales par la « théorie du genre » qui avait soulevé les inquiétudes. Celles-ci tournaient autour du même thème : des intellectuels radicalisés par des théories d’extrême-gauche emploieraient les campus comme base de radicalisation idéologique, en employant la censure comme arme et en fermant systématiquement le débat. Bien avant cela, la question du « politiquement correct » avait, dans les années 1990, particulièrement inquiété aux États-Unis, avant de faire l’objet
d’une importation en France.
Dans les années 1980, la critique par certains étudiants, du contenu de cours portant sur la « culture occidentale » risquait de conduire, d’après certains critiques conservateurs, à rien moins qu’une expurgation des textes de la grande culture au profit de la confusion postmoderne. Mais ce serait à tort que l’on situerait le début de ce thème récurrent de conflit aux années Reagan : la crainte de la manipulation gauchiste des facs de lettres était déjà bien agitée dans les années 1970, tant aux États-Unis, par le mouvement néoconservateur, qu’en France, par des intellectuels issus d’horizons divers – qui ne faisaient eux-mêmes, ainsi qu’on va le voir, que reprendre et retravailler des thèmes plus anciens.
Il est à supposer qu’il se trouve, à toute époque, un intellectuel ou un autre pour s’émouvoir du fait que, contrairement à sa propre génération, la jeunesse d’aujourd’hui soit ingrate et se débatte pour des âneries, tandis que, de son temps, il n’en allait pas de même. Il est toutefois possible d’identifier la façon dont ce thème a pu être travaillé au xxe siècle.


