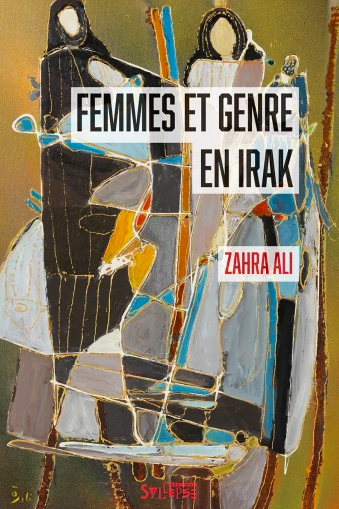
Première partie : Femmes et genre en Irak
Depuis la publication de L’orientalisme d’Edward Said (1977), des progrès importants ont été faits au sein des études académiques sur le Moyen-Orient et les contextes majoritairement musulmans. Influencé en grande partie par les travaux pionniers de Frantz Fanon (1952, 1961) [1] Said élabore une critique sévère de la tendance dans les écrits européens du siècle dernier à essentialiser ce qu’on appelle l’Orient et à le présenter en opposition avec le dit Occident. Dans cette équation dichotomique, l’« Orient » est décrit comme fondamentalement archaïque, barbare, enclin au despotisme. L’Occident est par contraste défini comme moderne, progressiste, libéral. Said montre aussi qu’en représentant l’« Orient » en termes essentialistes et négatifs, l’intelligentsia européenne a construit une représentation positive de l’Occident, qui justifie son entreprise coloniale et sa prétendue mission de civilisation. Dans son ouvrage, Said insiste sur l’importance de déconstruire l’essentialisme, en considérant que ni l’Orient ni l’Occident ne constituent des réalités homogènes, mais sont plutôt des représentations construites sur et suivant les intérêts du colonialisme européen.
Matérialité et hétérogénéité de « la culture »
Bien qu’il dénonce l’impérialisme occidental en révélant la logique de ses mécanismes dis- cursifs dans la lignée de Fanon (1961), Said reste prudent face au risque de tomber dans un essentialisme inversé. Dans Culture et impérialisme (1994), il critique diverses formes de résistance culturelle basées sur une politique identitaire et une représentation homogénéisée de l’Occident. Selon Said, l’« occidentalisme » implique d’accepter les divisions raciales, religieuses, politiques imposées par l’impérialisme lui-même. Par ailleurs, Zubaida (1989) souligne lui aussi l’importance de déconstruire la dichotomie Occident/Orient, en refusant de situer les racines de certains concepts – telles que la modernité et le féminisme – en Occident. Il souligne l’importance de déconstruire les lectures évolutionnistes, linéaires et simplistes de l’histoire occidentale, et de faire apparaître les dynamiques contradictoires de la modernisation au sein des espaces géographiques définis comme Occident et Orient.
La dimension de genre de l’impérialisme culturel est mise en exergue dans la fameuse citation de Gayatri Chakravorty Spivak :
« Des hommes blancs qui sauvent des femmes de couleur des hommes de couleur » (1988).
Le féminisme postcolonial a lui aussi montré que les catégories et agendas modernistes eurocentrées en matière de « droits des femmes » sont souvent basés sur une réification de la « femme du tiers-monde », considérée comme porteuse de la différence. Dans son article pionnier « Under western eyes » et sa version revisitée, Chandra Talpade Mohanty (1988, 2003a) affirme que la pensée féministe blanche vis-à-vis des femmes du « tiers-monde » est marquée d’une part par les postulats de privilège et d’universalité ethnocentrique, et d’autre part par une conscience de soi inappropriée sur les effets de la recherche académique occidentale dominante face au « tiers-monde » dans le cadre d’un système mondial dominé par des pouvoirs économiques, militaires et politiques occidentaux. C’est dans la production de cette « différence du tiers-monde » que le féminisme blanc colonise les complexités caractérisant les vies des femmes dans les pays colonisés. C’est à travers l’homogénéisation et la systématisation de l’oppression des femmes du « tiers-monde » par la « culture » ou la « religion » que la recherche académique féministe blanche existe et parvient à se définir elle-même.
Concernant les contextes dits « musulmans », l’ouvrage de Leila Ahmed (1992) révèle les racines coloniales des débats modernes sur les femmes et le genre en lien avec l’islam. En s’intéressant plus spécifiquement au contexte égyptien, elle montre comment la « question de la femme » a été construite durant l’époque coloniale, pour dépeindre « l’oppression de la femme musulmane » par une « culture musulmane » indifférenciée, essentiellement patriarcale et archaïque, en opposition à une culture occidentale prétendument favorable aux droits et à la dignité des femmes. Pour Ahmed, la construction de la « question de la femme musulmane » guide les débats sur les femmes et le genre dans les pays musulmans et encadre la façon dont la résistance politique à la domination occidentale a été formulée. C’est là le cœur du dilemme auquel sont confrontées les activistes des droits des femmes dans les contextes à majorité musulmane car, comme le dit Ahmed, elles doivent choisir entre « trahison et trahison » dans des environnements où la défense de l’égalité des genres est souvent associée à des « revendications occidentalisées » (Ahmed, 1982). Ahmed aborde en outre le phénomène de « retour du voile » dans les contextes à majorité musulmane, ainsi qu’au sein de communautés musulmanes aux États-Unis, décrivant cela comme l’incarnation d’une forme de « résistance culturelle » aux modèles occidentaux de modernité (Ahmed, 2011).
J’adhère autant à l’approche d’Ahmed, notamment dans la mise en évidence des racines coloniales de la « question de la femme musulmane », que je suis d’accord avec la nécessité d’envisager une pluralité d’islam-s et de ce qui constitue les réalités des femmes musulmanes. Dans la lignée de Beyond Islam de Zubaida (2011), je pense que le colonialisme a engendré un phénomène discursif ayant un effet sur la représentation culturelle de ce que l’on considère « moderne » ou « traditionnel ». Selon Zubaida, la modernité coloniale a induit l’introduction du capitalisme au Moyen-Orient. Des forces socio-économiques de grande envergure ont engendré des transformations dans les relations sociales et politiques. Pour Zubaida, ces forces ont produit divers modèles de transformations culturelles et politiques, en fonction des conjonctures historico-culturelles locales. On ne peut pas englober ces différences dans l’Occident versus le « reste », car elles incluent tout autant l’Occident que le « reste ». En mettant en lumière les réalités matérielles du colonialisme, Zubaida parvient à déconstruire l’importance excessive accordée aux réalités discursives et représentationnelles. Il insiste aussi sur l’importance de déconstruire l’usage indifférencié et décontextualisé du qualificatif « islamique », généralement apposé au mot « culture » et de montrer la complexité des réalités considérées comme « islamiques ».
Je suis d’accord avec la perspective de Zubaida. Dans cette recherche, je propose d’aller plus loin que les analyses basées sur « des discours et des représentations », en enracinant la « culture » dans ses environnements matériels. Les dimensions discursives s’avèrent insuffisantes pour comprendre les aspects multidimensionnels de la vie des femmes dans les contextes grossièrement qualifiés de « musulmans ». Sans nier l’importance du discursif, il me semble qu’en se focalisant sur les dimensions représentationnelles de la « culture », les réalités concrètes peuvent être omises. C’est pourquoi les représentations autant que les réalités matérielles doivent être prises en compte dans l’analyse. Autrement dit, l’usage des expressions « culture islamique » ou « dans l’islam » ne fait sens que s’il est situé économiquement, politiquement et socialement, et analysé conformément à un contexte. Ces expressions n’induisent pas seulement en erreur ; elles participent facilement à une forme d’essentialisation.
« Writing against culture » de Lila Abu-Lughod (1991) fait particulièrement écho à mon processus de recherche. Abu-Lughod a refusé d’utiliser le mot « culture » en réaction à une tendance homogénéisatrice, notamment chez les anthropologues. Car l’usage des termes « culture » ou « culture musulmane » homogénéise non seulement des réalités complexes et multidimensionnelles, mais exclut également l’analyse des réalités matérielles dans lesquelles la « culture » est façonnée, remodelée, vécue, expérimentée. Abu-Lughod appelle à éviter la généralisation, préférant se focaliser sur « des individus en particulier et leurs relations changeantes » afin d’« éviter les connotations problématiques liées à la culture : homogénéité, cohérence, intemporalité » (Abu- Lughod, 1991 : 473-476).
Selon Abu-Lughod, une autre dimension essentielle doit être prise en compte. Formulée par Deniz Kandiyoti, elle concerne les limites de l’adoption d’une approche postcoloniale dans le domaine des études de genre au Moyen-Orient. Cette approche peut en effet être affectée négativement par les arguments de l’orientalisme, dès lors que l’analyse sociale et l’ethnographie sont dévalorisées au profit d’une analyse des représentations s’appuyant principalement sur des sources secondaires. Kandiyoti soutient par ailleurs que la pensée binaire sur l’Orient et l’Occident a habitué les chercheurs à trop se focaliser sur l’Occident et pas suffisamment sur l’hétérogénéité interne des sociétés moyen-orientales. Le point de vue de la critique anti-eurocentriste peut indirectement renforcer ces catégories très binaires, en détournant l’attention des institutions locales telles que « la famille, l’école, l’armée, le marché ou les processus culturels impliqués dans la production de structures de subordination fondées sur le genre » (Kandiyoti, 1996 : 16-18). Je comprends totalement les inquiétudes de Kandiyoti. Elles résonnent dans la critique d’Ella Shohat (2006) concernant l’approche du Moyen- Orient dans certaines recherches féministes, orientée vers un discours orientaliste sur « eux », lesquelles restent soigneusement confinés au sein des études régionales.
Une nouvelle praxis féministe
Dans cet ouvrage, je souhaite analyser les réalités discursives et matérielles en lien avec les réalités sociales, politiques et économiques des femmes irakiennes ainsi que leur activisme. J’adopte pour une approche affranchie de l’analyse impliquant la « culture » ou un islam indifférencié, dans le but d’enrichir l’analyse féministe critique. L’approche féministe proposée considère la contextualité, la complexité, la relationnalité, l’historicité comme fondamentales dans l’étude des femmes et des questions de genre, où que ce soit dans le monde. Elle fusionne l’analyse commune aux féminismes intersectionnels, noirs, tiers-mondistes, transnationaux, postcoloniaux ou décoloniaux, souvent étiquetés différemment pour exprimer cette approche essentielle. L’analyse intersectionnelle est née des études académiques féministes noires qui considèrent la complexité, la relationnalité, le pouvoir, le contexte social, les inégalités et la justice sociale comme des dimensions fondamentales dans la prise en compte des réalités humaines (Bilge et Collins, 2016).
Les études académiques noires, intersectionnelles, transnationales et postcoloniales/ décoloniales ont remis en cause une prétendue solidarité féminine qui réunirait toutes les femmes ensemble et ont souligné les différences entre elles [2]. Ces intellectuelles féministes soutiennent que la classe, le genre, la race, l’ethnicité, la sexualité et la religion sont interconnectés dans la vie quotidienne des femmes. Elles s’accordent sur l’importance d’ancrer l’analyse féministe à l’intérieur de ces « frontières ». Yuval-Davis affirme par exemple qu’il n’existe pas de définition des femmes qui ne soit pas ethnicisée, racialisée, de classe, âgée, sexualisée, etc. (Yuval- Davis, 2007).
Le choix dans l’analyse féministe transnationale du préfixe « trans » au lieu d’« inter » témoigne du besoin de déstabiliser plutôt que de maintenir les frontières de nations, de race, de genre, de sexualité, etc. (Grewal et Kaplan, 2006). Il s’agit aussi de critiquer un soi-disant « féminisme mondial » supposé rassembler toutes les femmes. Cette « association de femmes mondiale » s’appuie sur la notion de la classe moyenne néolibérale eurocentrique de « solidarité » et vise à définir quels sont les besoins des « femmes dans le monde », ainsi que leurs priorités en termes de lutte (Enloe, 2004). Cette recherche académique aborde la mondialisation dans un cadre transnational. Elle montre que les différentes formes de nationalismes encouragent des formes nouvelles de patriarcat, où les femmes sont considérées comme « porteuses de la nation ». Cette « nation » en question est décrite en termes essentialistes et exclusivistes ; elle repose sur une forme militarisée de la citoyenneté dominée par les hommes, au sein de laquelle la définition des identités normatives de genre tient un rôle central. Inderpal Grewal et Caren Kaplan (2006) affirment la nécessité d’articuler la relation de genre à des hégémonies dispersées, telles que les structures économiques mondiales, les nationalismes patriarcaux, les traditions, les structures locales de domination ou l’oppression juridique à divers niveaux. Il est essentiel qu’une approche féministe transnationale reconnaisse le lien entre les femmes, non à travers une universalité factice d’être et de condition – en réalité appartenant à la classe moyenne néolibérale eurocentrique – mais par l’engagement de femmes dans des dynamiques politico-sociales affectant d’autres femmes. Concernant l’Irak, Ali-Ali et Pratt (2009) ont mis en évidence l’instrumentalisation d’un discours « féministe » dans le but de justifier l’occupation et l’invasion menée par les États-Unis, sous prétexte de « sauver les femmes irakiennes ».
Pour Mohanty, la mondialisation est un phénomène économique, poli- tique et idéologique qui conduit activement le monde et ses différentes communautés sous des régimes discursifs et matériels interconnectés. Les existences des femmes, même si elles ne sont pas toutes les mêmes, sont interdépendantes quelle que soit la zone géographique où l’on vit (Mohanty, 2003b : 192-221). Pour Alexander et Mohanty (1997), la praxis féministe dans les contextes mondialisés implique de déplacer l’unité d’analyse « culture » locale, régionale ou nationale, vers des pro- cessus transcendant les frontières des « cultures » définies par les nations, l’ethnicité, la race, la classe, la sexualité et ainsi de suite. Il paraît en effet capital d’étudier la praxis féministe en appréhendant le local en relation avec des processus transnationaux plus vastes. Ce cadre remet en question le statut originel des féminismes occidentaux eurocentrés. Il ne positionne pas simplement le féminisme du tiers-monde comme une réaction face aux lacunes du féminisme occidental. Il fournit un positionnement à partir duquel plaider en faveur d’une praxis féministe comparative transnationale dans sa réponse aux processus mondiaux de colonisation et d’impérialisme (Mohanty et Alexander, 1997). Au lieu du cadre néolibéral eurocentrique de « simultanéité de l’oppression masculine », Mohanty, Russo et Torres (1991) suggèrent que la praxis féministe se fonde sur les histoires du racisme, de l’impérialisme, du capitalisme et des projets néolibéraux d’État-nation.
Dans la même lignée, Ella Shohat argumente en faveur d’une analyse relationnelle prenant en considération les termes opératoires et les axes de stratification propres à des contextes particuliers, mais aussi la façon dont ces termes et stratifications sont traduits lors de leur « voyage » d’un contexte à l’autre. Elle affirme que la différence entre les femmes dites « occidentales » et du « tiers-monde » ne doit pas être définie en termes de culture, mais qu’il faut prendre en compte divers positionnements face aux histoires des formes de pouvoir, surtout depuis l’avènement du colonialisme. Il s’agit de mettre en évidence des histoires et des communautés complexes en vue d’une « rencontre dialogique des différences » (Shohat, 2006 : 1-16).
De nombreuses féministes ont critiqué « la trinité race-classe-genre » de plus en plus présente dans les études intersectionnelles et son utilisation par la simple application de l’analyse additive ou multiplicative des dimensions liées aux réalités sociales, économiques et politiques des femmes. Ce que je soutiens ici, c’est qu’aborder les expériences et l’activisme des femmes irakiennes via un prisme intersectionnel ou relationnel complexe ne signifie pas qu’on doive voir le genre, la classe, la parenté, l’appartenance ethnique, religieuse ou communautaire comme des entités apposées les unes aux autres. Cela signifie ancrer les expériences des femmes irakiennes dans l’analyse sociologique. En ce sens, une ethnographie approfondie est requise, à laquelle j’appliquerai un prisme historique – via le recours aux histoires sociales, politiques et orales – afin d’explorer scrupuleusement les relations entre le genre, la classe, la parenté, les appartenances ethniques, religieuses et confessionnelles, la nature de l’État et l’idée de nation, qui revêtent un sens différent selon l’espace et le temps.
Cela signifie en outre d’enraciner les expériences des femmes irakiennes dans leurs contextes spécifiques et leurs positionnements locaux, sans perdre de vue les dynamiques transnationales qui façonnent leurs existences. Il s’agit d’analyser les façons complexes par lesquelles les différentes formes de pouvoir et de positionnement interagissent les unes avec les autres. Mettre en avant les dimensions transnationales/intersectionnelles/relationnelles du féminisme est une façon de dire que ce qui est communément nommé « local » ne se limite pas à un espace ou à un temps spécifique, et peut aussi être défini par des dynamiques transnationales/régionales. De la même façon, ce qui est considéré comme « mondial », au lieu de mêler divers intérêts locaux ou de s’appliquer par-delà les frontières nationales, peut en réalité représenter des préoccupations néolibérales très spécifiques. Soucieuse de ne pas tomber dans le piège des politiques identitaires simplistes, je tiens à la non-fixité de ces catégories et à la nécessité de renouveler en permanence l’analyse en fonction de dynamiques changeantes.
Les préoccupations liées à la complexité, à la contextualité, à l’historicité et à la relationnalité impactent la façon dont on « mène » la recherche. Mon ethnographie sur l’activisme politique et sociale des femmes irakiennes depuis 2003 a été guidée par cette approche com- plexe, ce qui m’a poussée à considérer attentivement les diverses dimen- sions de leurs réalités quotidiennes observées lors de mon travail de terrain à Bagdad, Erbil et Sulaymaniyah (Kurdistan irakien), Najaf-Kufa, Karbala et Nasiriyah. En plus d’interroger les femmes irakiennes sur leur famille, leur formation, leur itinéraire professionnel, social et politique, j’ai porté une attention particulière aux conditions concrètes de leur vie et de leur activisme.
Adopter une telle approche dans l’étude ethnographique du militantisme des Irakiennes signifie aussi s’intéresser à leur vie de tous les jours : leurs bureaux et les lieux où elles se rassemblent, se mobilisent, manifestent. J’énumère ainsi les diverses dimensions de la vie et de l’activisme des Irakiennes lorsque j’explore les espaces privés et publics dans lesquels elles circulent. Cela implique d’observer leurs foyers, leur voisinage, les rues des villes, les quartiers où elles vivent, les campus universitaires où beaucoup d’entre elles travaillent ou étudient, les espaces culturels et sociaux où elles interagissent, les centres culturels où elles tiennent leurs réunions et activités. En multipliant les espaces d’observation liés à la vie personnelle des activistes irakiennes et à leur militantisme, je parviens à une perspective plus large et à une vision approfondie des réalités matérielles dans lesquelles elles militent pour les droits des femmes. J’arrive ainsi à une approche complexe « des discours et représentations » des activistes irakiennes pour les droits des femmes, mais aussi des normes et représentations de genre, me permettant d’aller au-delà du « discursif » pour étudier les réalités concrètes de leur existence et de leur militantisme. Mon recueil des histoires orales d’activistes politiques irakiennes au cours de deux années de travail approfondi sur le terrain, suivi de divers brefs terrains, ainsi que l’utilisation de documents historiques exhaustifs sur les évolutions sociales, politiques et économiques, m’ont permis de réaliser une analyse com- plexe des femmes, des questions de genre et de féminisme dans l’Irak contemporain.
Dernière partie : Aborder les femmes, le genre et le féminisme en Irak


