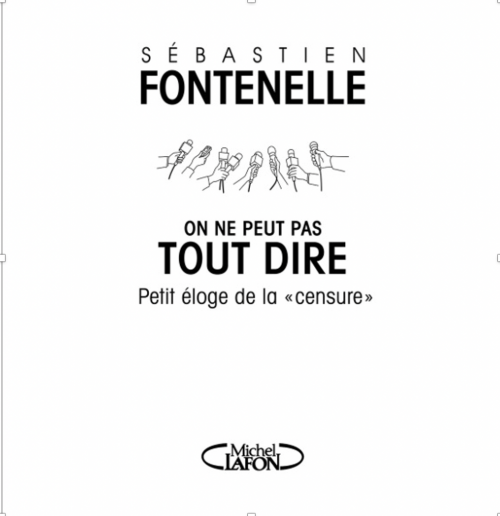
En octobre 2020, donc, Jean-Michel Blanquer assène : « Ce qu’on appelle l’islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l’université, [...] il fait des ravages quand dans les rangs de La France insoumise vous avez des gens qui sont de ce courant-là et s’affichent comme tels. Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire. »
Ce ministre lance donc contre des universitaires et contre un parti politique d’opposition cette accusation extraordinairement grave : ils seraient, par leurs prises de position – dont cet éminent personnage ne précise évidemment pas en quoi elles seraient si dangereusement problématiques –, des complices intellectuels du terroriste qui vient alors d’assassiner un enseignant.
Deux jours plus tard, dans Le Journal du dimanche, Jean-Michel Blanquer, réitérant ses attaques, détaille encore sa pensée dans cette longue tirade, où il s’en prend nommément au journaliste Edwy Plenel, fondateur du site Mediapart et auteur, notamment, d’un livre en forme de plaidoyer contre l’islamophobie :
« Il y a, assure le ministre, un combat à mener contre une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses [...] qui veulent essentialiser les communautés et les identités, aux antipodes de notre modèle républicain [...]. Cette réalité a gangrené notamment une partie non négligeable des sciences sociales françaises, je défie quiconque de me dire le contraire. Certains font ça consciemment, d’autres sont les idiots utiles de cette cause. [...] Ça se constate aussi dans le monde médiatique, où un homme comme Edwy Plenel déploie méthodiquement une stratégie de conquête des esprits dont le ressort collectif est la haine de soi. »
Le vocable « islamo-gauchisme » – formé sur le modèle du mot composé « judéo-bolchevisme », inventé par la droite nationaliste au début du vingtième siècle – ne figure bien sûr dans aucun dictionnaire. Il a été forgé par des idéologues pour discréditer quiconque s’insurge, au sein de la gauche antiraciste, contre la discrimination à l’égard des musulmans. Lorsqu’il évoque l’islamo-gauchisme, Jean-Michel Blanquer use donc, en conscience, d’une expression dont il ne peut ignorer qu’elle est lourdement connotée, et qu’elle n’est utilisée que pour disqualifier des contradicteurs.
Ce ministre, dans ses interventions du mois d’octobre 2020, s’inscrit du reste pleinement dans cette entreprise de disqualification quand il présente entre autres Edwy Plenel, dont le seul tort est de s’être publiquement élevé contre l’islamophobie et le racisme, comme un agitateur incitant ses lecteurs à la « haine de soi », c’est-à-dire comme un activiste antifrançais.
En incriminant aussi – mais sans produire là non plus le moindre élément probant à l’appui de ses accusations – « une partie non négligeable des sciences sociales françaises », Jean-Michel Blanquer va d’autre part très au-delà du dénigrement de ces enseignants et de ces chercheurs : il suggère également, lorsqu’il prétend qu’ils sont « gangrenés » par une prétendue « matrice intellectuelle » présentée comme antirépublicaine – c’est-à- dire, là encore, comme antifrançaise –, qu’il conviendrait de leur administrer un traitement de choc pour les guérir de ce mal, qui dans ses formes les plus graves se soigne, comme on sait, par l’amputation.
Très logiquement, ces vitupérations ministérielles soulèvent chez les premiers intéressés une vive indignation. La Conférence des présidents d’université (CPU), qui n’est pas exactement un repaire de gauchistes, publie un vif communiqué invitant le ministre « à éviter amalgames et raccourcis inutiles ».
Ses auteurs redisent au passage quelques évidences : « Non, les universités ne sont pas des lieux où se construirait une “idéologie qui mène au pire”. Non, les universités ne sont pas des lieux d’expression ou d’encouragement du fanatisme. Non, les universités ne sauraient être tenues pour complices du terrorisme. »
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ne semble pas être d’un avis très différent, et contredit même ouvertement son collègue Blanquer en rappelant elle aussi que « l’université n’est pas un lieu d’encouragement ou d’expression du fanatisme ». Quelques mois plus tard, nous le verrons, elle changera radicalement d’avis, et demandera une « enquête sur l’islamo-gauchisme à l’université ».
Mais curieusement, personne, parmi les commentateurs qui ne ratent jamais une occasion de dénoncer des censures imaginaires et de prétendues atteintes à la liberté d’expres- sion, ne s’offusque de ce qu’un ministre d’État, et non des moindres, s’affranchisse de toute retenue pour déconsidérer publiquement des contradicteurs en les présentant comme des complices du terrorisme. Et cette intimidation n’est pas considérée comme représentative d’une « culture de l’annulation » visant à réduire des antagonistes au silence.
Volte-face
Au mois de février 2021, Frédérique Vidal, qui avait donc tenu à rappeler un an plus tôt que l’université française n’était « pas un lieu d’encouragement ou d’expression du fanatisme », fait une spectaculaire volte-face pour proclamer, sur CNews, qu’elle va demander « une enquête au CNRS sur l’islamo-gauchisme » qui, selon elle, « gangrène » l’université, et menace « la liberté académique ».
Cette annonce provoque la « stupeur » de la Conférence des présidents d’université, qui réclame « des clarifications urgentes » à la ministre et lui suggère sèchement de ne pas « raconter n’importe quoi ». Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), où personne n’a été prévenu de l’initiative de Frédérique Vidal, publie quant à lui un communiqué cinglant, qui rappelle que « l’“islamo-gauchisme”, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique » et déplore « la polémique actuelle » autour de cette expression, ainsi que « l’exploitation politique qui en est faite, [...] emblématique d’une regrettable instrumentalisation de la science ».
Quelques jours après son annonce, le 4 mars, Frédérique Vidal est invitée sur France Culture, où son hôte, Guillaume Erner, manifestement interloqué, lui aussi, par la légèreté du procédé, lui demande où et de quelle manière exactement la liberté académique serait menacée par l’islamo-gauchisme. La ministre répond : « Elle est menacée à partir du moment où on interdit des colloques ». Et comme son hôte lui demande de se montrer un peu moins vague, et de préciser de quels colloques elle parle, elle cite principalement « l’empêchement de madame Agacinski », dont nous avons dit que dans la réalité, sa conférence à l’université de Bordeaux Montaigne n’avait été définitivement annulée que parce qu’elle-même avait refusé qu’elle soit transformée en un débat au cours duquel des contradicteurs auraient pu s’exprimer.
Plusieurs mois plus tard, en octobre 2021, un journaliste de France Info, constatant qu’il n’a plus jamais été question, pendant un long semestre, de l’enquête que la ministre prétendait demander au CNRS, lui pose cette question à brûle-pourpoint : « Vous avez des nouvelles, Frédérique Vidal, des islamo-gauchistes qui gangrènent les universités françaises ? » Manifestement prise de court, l’intéressée, reconnaissant qu’aucune enquête n’a en réalité été effectuée, balbutie : « Écoutez, ce qui est très important pour moi, c’est de rappeler que la liberté académique et la liberté scientifique sont les deux piliers de la recherche, et les deux piliers de l’université. Et donc, il y a, finalement, beaucoup de débats qui ont eu lieu, j’en suis ravie, parce que ça a permis à des gens qui avaient l’impression qu’ils ne pouvaient plus exprimer leur opinion de pouvoir le faire. »
C’est inexact, aucun débat public n’a eu lieu. Deux ministres ont lancé des accusations gravissimes contre l’université, dont ils ont prétendu sans jamais le documenter qu’elle était « gangrenée » par une idéologie funeste, et cela a soulevé d’indignation les universitaires ainsi cloués au pilori. Mais jamais ces enseignants et chercheurs, même s’ils n’ont pas manqué de réagir publiquement, n’ont eu accès aux tribunes depuis lesquelles ces anathèmes avaient été lancés. Et le soupçon dont leurs travaux ont été sciemment entachés par des propagandistes d’État n’a jamais été levé.
Une fois de plus, l’« islamo-gauchisme » n’a jamais été précisément défini par ceux qui, depuis le sommet de l’État, usent de ce vocable comme d’un épouvantail, pour mieux insinuer, contre toute vérité, que des érudits dévoyés – dont les travaux, en réalité, portent au contraire sur les manières d’en finir avec les discriminations – pratiqueraient la censure et l’excommunication.
Mais plutôt que de s’étonner de ce refus de débattre réellement, ou du fait qu’une ministre a pris quelques libertés avec la vérité en promettant une enquête qui n’a jamais eu lieu, la presse et les médias continuent à se gargariser, à l’unisson de Jean-Michel Blanquer et de Frédérique Vidal, de leurs dénonciations de la « cancel culture », et présentent dorénavant cette prétendue nouvelle censure comme un « sous-produit du “wokisme” » – un mot dont l’usage va lui aussi devenir courant.
« Woke »
Aux États-Unis, le mot woke correspond, comme le souligne la journaliste Rokhaya Diallo dans une chronique publiée par le Washington Post, à une « réalité politique » : celle de la nécessité de dénoncer, parmi d’autres, les discriminations visant notamment les Africains-Américains. La persistance de ce racisme a été précisément documentée dans le champ universitaire par les recherches effectuées dans le cadre de la théorie critique de la race (TCR), selon laquelle les discriminations raciales, mais aussi, et par extension, celles liées au genre, sont consubstantielles à la société étasunienne, telle qu’elle est encore structurée aujourd’hui.
Exemple : au printemps 2021, des lycéens de Traverse City, au Michigan – une cité blanche à plus de 90 % –, créent un groupe Snapchat qu’ils baptisent Slave Trade – « commerce des esclaves ». Ils y échangent d’infâmes proféra- tions racistes, estimant que « tous les Noirs doivent mourir » et suggérant d’« initier », à cette fin, « un nouvel holocauste ». Ce n’est qu’après qu’ils ont franchi un nouveau pas dans l’infamie pour organiser une vente aux enchères de leurs camarades de classe noirs que leurs agissements sont publiquement dénoncés. Devant l’ampleur du scandale, la direction du lycée adopte précipitamment une résolution annonçant la constitution d’un groupe de travail chargé de rappeler que « les mesures destinées à combattre les discriminations et le racisme passent nécessairement par l’acquisition de nouveaux savoirs, et par plus de progrès social au sein de la communauté noire ». Mais cette initiative provoque une levée de boucliers. Certains parents, qui considèrent que cette résolution « anti-blanche et anti-chrétienne » est entièrement inspirée par la théorie critique de la race, exigent – et obtiennent – qu’elle soit expurgée de ses passages condamnant les discours de haine, l’intolérance, le racisme et la violence raciale. De la même façon, l’affirmation selon laquelle « la haine et le racisme n’ont leur place ni dans les écoles ni dans la société » est elle aussi supprimée. Ou, si l’on préfère, censurée. Et le cas n’a rien d’exceptionnel, puisqu’à l’automne 2021, explique la juriste Patricia J. Williams dans un article publié par le magazine new-yorkais The Nation, huit États ont déjà adopté des lois contre l’enseignement de la théorie critique de la race, que la droite trumpiste présente comme un danger mortel, et que l’Alabama se propose même d’interdire complètement – ce qui constituerait, de fait, cela vaut d’être souligné – une censure étatique en bonne et due forme.
Être « woke » – éveillé, puisque telle est donc la traduction de ce mot – c’est en somme être conscient de ces discriminations persistantes, et du refus obstiné de les regarder pour ce qu’elles sont. C’est se montrer, plus généralement, attentif et sensible aux injustices liées à la classe, au genre, ou à la race, qui ne sont pas exclusives les unes des autres, et s’additionnent le plus souvent. Pour qui n’éprouve aucun penchant raciste ou sexiste et ne prise guère l’exploitation d’autrui, cette sensibilité relève a priori de l’évidence. Mais pour la droite trumpiste, cette délicatesse élémentaire est inacceptable. C’est pourquoi elle s’est lancée dans une croisade délirante contre la théorie critique de la race et soutient désormais que cette mise en évidence des inégalités relève d’une dangereuse propagande antiaméricaine.
En France, en revanche, personne ou presque, au sein de la gauche, n’emploie le mot « woke » – si ce n’est désormais pour railler les droites hexagonales qui en ont fait, comme d’une arme idéologique et langagière de dissuasion massive, leur nouvel épouvantail. De ce côté-ci de l’Atlantique, le « wokisme » ne correspond, comme le souligne également Rokhaya Diallo, à aucune réalité identifiable.
Un « système de croyances »
De fait, selon un sondage commandé par L’Express au mois de février 2021, 6 % seule- ment des Français pensent savoir ce qu’est la pensée « woke », et ils sont 86 % à n’en avoir strictement jamais entendu parler. Quant aux commentateurs qui, depuis le début des années 2020, dénoncent en boucle le danger de l’idéologie « woke » : ils peuvent parfois se trouver à la peine, lorsque vient le moment de documenter leurs cris d’alarme, et de produire des faits probants à l’appui de leurs divagations.
En juillet 2021, la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), un think tank dirigé depuis 2008 par un ancien candidat sarkozyste, publie un rapport en deux volumes précisément consacré à l’idéologie « woke », et au danger auquel ce « système de croyances » expose, selon son auteur (qui assimile donc la sensibilité aux discriminations et aux injustices à une foi irrationnelle), « nos sociétés occidentales ».
Problème, cet expert échoue complètement à démontrer que ce qu’il appelle « le wokisme en France » serait autre chose qu’un fantasme réactionnaire. En effet, la quarantaine de lignes qu’il consacre au phénomène « woke » dans ce pays se résument, en tout et pour tout, à un commentaire superficiel du sondage commandé en février par L’Express, d’où ressort, comme il le remarque avec beaucoup de perspicacité, que « seuls [...] 14 % des personnes interro- gées [ont] déjà entendu parler de la notion ». Sa dangerosité semble donc être légèrement moins évidente que ne le suggère la Fondapol. Mais cette réalité ne dissuade nullement la presse et les médias de continuer à s’inquiéter.
En novembre 2021, un nouvel hebdomadaire, Franc-Tireur, publie ainsi, dans son tout premier numéro, un article soutenant que « les wokes s’attaquent à réinventer la langue, qu’ils considèrent comme nuisible pour les minorités » [1]. Mais là encore, l’auteur, s’il produit quelques exemples, tous étatsuniens, de ce qu’il présente comme des abus, se révèle incapable d’en trouver en France pour illustrer son propos.
Pourtant, l’extrême légèreté, dans le meilleur des cas, de ces allégations n’empêche nullement que certaines accusations soient encore et toujours relayées jusqu’au plus haut sommet de l’État – le temps semble déjà loin où elles étaient circonscrites aux quelques personnages évoqués au début de ce livre.
Idéologie
Le 13 octobre 2021, le ministre Jean-Michel Blanquer tient à faire, dans une interview au Monde, une annonce importante. Elle ne porte pas sur la pandémie de Covid-19 qui ravage alors la planète, et contre laquelle le gouvernement n’a pas, de l’avis de plusieurs spécialistes, suffisamment sécurisé les écoles. Le ministre souhaite plutôt parler, loin de l’étroite matérialité des contingences sanitaires, du lancement de son « cercle de réflexion » : le Laboratoire de la République. Cette structure a notamment pour objectif d’aider « la France et sa jeunesse à échapper à l’idéologie woke », que Jean-Michel Blanquer présente comme une « doctrine qui fragmente et divise, et qui a conquis certains milieux politiques, médiatiques et académiques en proposant un logiciel victimaire au détri- ment des fondements démocratiques de notre société ».
Le ministre ne produit évidemment – et pour cause – aucun élément susceptible d’étayer cette dernière assertion, à celui-ci près : il soutient avec gravité qu’« aux États- Unis cette idéologie a pu amener, par réaction, Donald Trump au pouvoir, et que la France et sa jeunesse doivent échapper à ça ».
C’est donc, il convient de le souligner, un ministre d’État, et non des moindres, qui, agitant comme un épouvantail un mot qui ne correspond à aucune réalité concrète, le suggère très distinctement : il se pourrait bien que ce soit à cause de la gauche antiraciste et antisexiste qu’un président raciste et sexiste ait été élu en 2016 aux États-Unis. Encore une fois, des victimes de discriminations se voient imputer la pleine et entière charge de leurs propres afflictions, en même temps que leurs tourmenteurs se trouvent dégagés d’une bonne part de leur responsabilité, puisqu’on les a tout de même un peu provoqués.
Dans une tribune publiée par Le Monde le 30 décembre 2021, le sociologue Alain Policar constate que « le mot woke est finalement devenu, dans le discours dominant, un instrument d’occultation des discriminations raciales ». Ce vocable, résume-t-il, sert désormais à « désigne[r] péjorativement ceux qui sont engagés dans les luttes antiracistes, féministes, LGBT ou même écologistes ».
Ce dénigrement vise lui-même à disqualifier la parole de ces militants qui ont trouvé de nouveaux espaces d’expression, et qui par conséquent peuvent désormais dire leurs afflictions et leurs souffrances. Il a pour fonction d’étouffer leurs voix, et de rendre leurs propos et leurs propositions inaudibles. De les empêcher, en somme, d’exiger d’être enfin entendus et considérés comme des interlocuteurs légitimes et respectables, puisqu’ils savent, eux, lorsqu’il est question de racisme et de discriminations ou de violences liées au genre, de quoi ils parlent pour l’avoir vécu dans leur âme et leur chair.
Pour le dire autrement, la réduction de toute contestation, de toute contradiction, de toute réfutation et de toute réprobation à un « wokisme » considéré comme oppressif ressemble d’assez près à ce que ceux qui la pratiquent présentent ordinairement comme de la censure.
Elle témoigne aussi de ce qu’en l’espace de quelques années, la fustigation de courants de pensée et de mouvements critiques et de leurs porte-parole, précisément ciblés, est venue s’ajouter à la stigmatisation de groupes entiers et indifférenciés – comme « les musulmans ».


