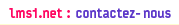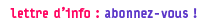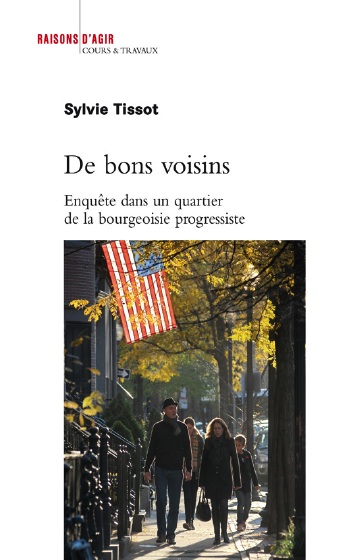
Le XVIe arrondissement de Paris, l’Upper East Side de New York, Belgravia et South Kensington à Londres, et bien d’autres quartiers encore, évoquent, par leur nom même, les espaces homogènes et protégés où se regroupent les plus fortunés. Ces quartiers anciens accueillent effectivement, depuis plus d’un siècle pour certains, les élites du pays. D’autres espaces se sont développés depuis l’après Seconde Guerre mondiale, qui semblent témoigner d’une même recherche d’entre soi.
C’est bien sûr une large partie des banlieues résidentielles américaines, où se succèdent grandes maisons et longues voitures. Mais on pense aussi aux communautés dites fermées qui s’étendent depuis quelques décennies aux États-Unis, également en Amérique du Sud et plus récemment en Europe : les murs qui encerclent les complexes d’habitations, les gardiens postés dans une guérite à l’entrée, ainsi que les règlements extrêmement détaillés, y empêchent encore plus explicitement l’intrusion des « autres ».
Bien que beaucoup moins étudiés par les sociologues que les quartiers pauvres, ces territoires sont la manifestation d’une ségrégation socio-spatiale caractéristique des grandes métropoles internationales.
Pour autant, l’agrégation dans l’espace ne résume pas l’attitude des plus riches. Une fraction non négligeable de ces derniers est venue habiter récemment dans des quartiers non pas exclusifs, mais caractérisés par une certaine mixité sociale. C’est le cas par exemple à Paris. Tandis que les quartiers bourgeois continuent à rassembler une élite cumulant tous les capitaux [1], l’installation dans les quartiers mixtes n’est plus l’apanage des classes moyennes des secteurs culturels que l’on désigne habituellement sous le sobriquet de « bobos ».
Le pourcentage de cadres et professions intellectuelles supérieures a ainsi dépassé, entre 1999 et 2008, la barre des 25 % dans les Xe, XIe et XIIe arrondissements, situés dans l’Est traditionnellement populaire de Paris. Si cette catégorie recherche le plus souvent la proximité avec les espaces bourgeois, notamment en banlieue [2], leur afflux qui accompagne le déclin des catégories populaires s’est particulièrement fait ressentir dans les quartiers centraux mixtes de la capitale.
Le phénomène prend aux États-Unis une dimension plus frappante encore qu’en France, où les catégories supérieures n’ont jamais fui les centres-villes. Outre-Atlantique, le mouvement dit de « retour en ville » contraste avec le tropisme vers la périphérie qui était la règle chez les plus dotés jusqu’aux années 1960. Il a ainsi rendu plus visible encore l’embourgeoisement parfois extrêmement rapide de quartiers anciens [3].
L’arrivée dans ces espaces mixtes n’est pas seulement subie. Ou plutôt, si de fortes contraintes économiques expliquent cette migration, un nouveau discours l’accompagne, qui relève bien sûr d’une rationalisation des contraintes générées par l’explosion des prix immobiliers, mais qui se traduit aussi par l’exaltation de nouvelles valeurs. La mixité sociale n’apparaît pas seulement dans la composition sociodémographique de quartiers où habitent les classes supérieures ; elle fait aussi partie de leurs discours.
Loin d’être un repoussoir, le terme de « mixité sociale », et plus récemment celui de « diversité », directement issu du monde anglo-américain, est brandi comme un étendard. La hiérarchie des espaces désirables semble ainsi se réorganiser à partir de critères recomposés : non plus seulement l’exclusivité et la respectabilité bourgeoise, mais aussi la coexistence de populations « différentes », de par leurs revenus, leurs origines ethniques ou encore leur orientation sexuelle.
Cette valorisation de la diversité chez les couches supérieures estelle l’indice d’une recomposition de la stratification sociale et des relations entre les groupes sociaux ? C’est à cette question que ce livre entend répondre, en évitant les deux écueils du « toujours pareil » et du « jamais vu » [4].
Depuis les années 1990, les succès remportés par la thèse hautement idéologique de la disparition des classes sociales (et notamment de la classe ouvrière) ont conduit les sociologues à réaffirmer l’existence non seulement des inégalités mais aussi des rapports de domination. Cette réaction, bienvenue, serait toutefois dommageable si elle empêchait tout examen des recompositions qui travaillent les groupes sociaux et nous limitait au rappel d’une reconduction immuable de la domination bourgeoise. Les classes populaires, sans échapper à l’exploitation économique, se sont profondément transformées depuis trente ans. C’est le cas aussi des classes supérieures.
Prenant acte d’une certaine atténuation de l’autonomie culturelle qui caractérise les classes populaires, Olivier Schwartz a tenté d’analyser le brouillage des frontières qui séparent celles-ci du reste de la société [5]. De la même façon, ce livre se propose de partir de la manière dont les couches supérieures se définissent par rapport aux « autres ».
La proximité spatiale dont se revendique une fraction d’entre elles ne traduit certainement pas une disparition des barrières sociales ; le creusement des inégalités socioéconomiques depuis les années 1980 est là pour le rappeler [6].
Il reste que le séisme provoqué par les mouvements de protestation des années 1960 n’a pas été sans effets sur la reproduction sociale telle qu’elle fonctionne dans les sociétés occidentales. Le pouvoir a été profondément ébranlé par la révolte des ouvriers, des étudiants, des peuples colonisés, des femmes, des gays, et des Noirs aux États-Unis.
La scène urbaine permet justement d’observer comment les rapports de domination se reconduisent différemment. Tout en perdurant, ceux-ci s’accompagnent désormais de l’intégration relative, à certaines conditions et à certaines places, de groupes sociaux naguère méprisés et invisibilisés, habituellement renvoyés dans l’indignité culturelle et l’éloignement géographique. Le regard sociologique, souvent enclin à se porter vers les plus démunis, se tourne ici en direction du sommet de la hiérarchie sociale, pour comprendre les transformations qui la travaillent.
La littérature sur la gentrification, c’est-à-dire l’arrivée de ménages des classes moyennes dans des quartiers anciens pauvres, en a fourni de nombreuses preuves : la proximité spatiale ne réduit pas magiquement les distances sociales [7].
Ceux qu’on appelle les gentrifieurs, et qui disent goûter le mélange, organisent souvent avec parcimonie leurs interactions avec les populations déjà présentes. Les conflits liés aux normes propres à chaque groupe social ne disparaissent pas magiquement tant ces groupes impriment dans l’espace leurs aspirations et leurs styles de vie. Il serait étonnant qu’il en soit autrement pour ceux qui sont étudiés dans ce livre, c’est-à-dire des agents plus dotés en différents capitaux et qui, désignés par la littérature américaine sous le terme de « classes moyennes supérieures », appartiennent de fait aux classes supérieures [8].
Pour autant, si la proximité spatiale n’annule pas les distances sociales, on peut faire l’hypothèse que la coexistence produit des formes de distinction singulières de la part de ceux qui y sont confrontés [9]. C’est précisément l’objet de la recherche exposée ici, et qui porte sur le South End de Boston, aux États-Unis, ancien quartier populaire où se pressent désormais des résidents aisés. À la faveur de leur installation depuis les années 1960, une gestion spécifique du rapport à l’autre s’est instituée, reposant sur un pouvoir local fort, que des habitants fortunés, vantant les bienfaits de la démocratie locale, ont su construire à partir du secteur associatif.
Ce pouvoir permet le contrôle serré d’une coexistence par ailleurs fortement valorisée. Les « nouveaux » habitants du South End à Boston sont ainsi capables de se battre pour le maintien sur place d’habitants pauvres ; ils se veulent gay friendly [10] dans un quartier où nombre d’homosexuels ont déménagé depuis les années 1960.
Tout cela n’est possible, toutefois, qu’à la condition que cette diversité existe dans une « proportion raisonnable », et que sa présence, notamment dans l’espace public, ne vienne pas contrecarrer les normes qu’ils sont parvenus à imposer.
Mais la défense de la mixité sociale n’est pas pour autant un pur habillage, un simple alibi masquant des pratiques excluantes : elle induit une attitude singulière exigeant une certaine ouverture, tout en l’organisant de façon prudente. Reste à savoir envers qui cette ouverture intervient, où et à quelles conditions.