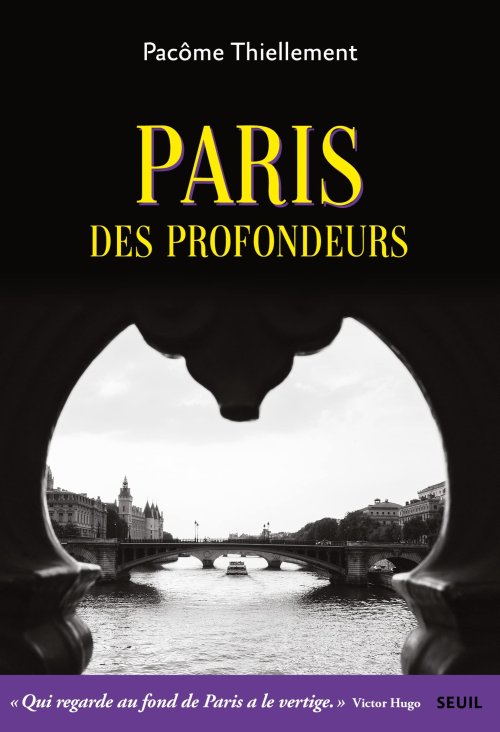C’est un cercle parfait. C’est un ouroboros vertical. Il va de nadir en zénith et de zénith en nadir. Et il s’enroule autour de l’ascension prise naguère par Saint Denis pour son exécution sous les ordres de l’Empereur Domitien, avec l’archiprêtre Rustique et l’archidiacre Eleuthère, depuis leur prison sur l’île de la Cité jusqu’en haut de la colline où le grand méchant Romain décapitera les trois petits chrétiens. Entre le quartier de Saint-Merri, la Nouvelle Athènes et la Butte Montmartre, le Paris de Gérard de Nerval se situe exclusivement sur la rive droite. Et il a lui aussi son archidiacre et son archiprêtre pour l’accompagner dans sa passion. Ils sont installés aux Halles, juste à côté de chez lui.
Nadir de Nerval
Pour commencer, Gérard Labrunie dit Nerval naît en 1808 dans l’axe majeur gallo-romain, sur la rue Saint-Martin, à l’emplacement de l’actuel n° 168. Son père Étienne Labrunie est médecin militaire et sa mère Marie-Antoinette est la fille d’un marchand linger de la rue Coquillière. Le café au rez-de-chaussée du n° 168, Jojo, contient une émouvante photo de Nerval à l’intérieur, flottant sur l’escalier qui mène à l’étage.

La dernière fois que j’y ai bu un verre, c’était en juin 2019 avec Olivier Mellano, quelques mois à peine après que « Jojo » soit devenu le surnom méprisant donné par le petit roi de la macronie au Gilet Jaune archétype qui lui faisait si peur parce qu’il aurait acquis « le même statut qu’un ministre ou un député ». Soit le révolutionnaire d’aujourd’hui et de demain qui pourra le destituer, lui comme ses semblables, de leur trône de monarque imaginaire. Si l’étoile de Nerval oriente Jojo le Gilet Jaune, alors la révolution sera mystique et la poésie visionnaire.
Ce coin de la rue Saint-Martin est situé à l’angle du Quartier de l’Horloge, quartier absolument moderne construit durant les années soixante-dix sur l’ancien passage de l’horloge aux automates du Moyen-Âge. Ce carré d’immeubles est assez laid mais il a en son cœur un étrange automate que j’allais visiter enfant avec mon père : Le Défenseur du Temps de Jacques Monestier. Un homme se battant, avec une épée, contre trois animaux : un oiseau représentant le ciel, un dragon représentant la terre et le feu et un crabe représentant la mer. Est-ce un chevalier de Haute Folie ou un évêque assommeur de dragon ? Toutes les heures, il combattait pendant la durée d’une minute l’un des animaux qui se mettait à s’animer sur des sons de vagues, de grondements de terre, des crépitements de feu ou des souffles de vent. L’automate est là depuis 1979, mais il est immobile. Il a arrêté de fonctionner en 2003 et la mairie n’a toujours pas pris la peine de le réparer. C’est un symbole incroyable pour le poète de « La treizième revient… c’est encore la première ». Le temps vécu par le Sans Roi, c’est celui d’une horloge arrêtée.

Un peu plus bas, alors que je me rends vers la deuxième habitation parisienne du poète des Chimères, je passe devant le Piazza Beaubourg, au 156 rue Saint-Martin, un ancien hôtel privatisé abritant désormais un cabinet d’avocats. L’immeuble est exceptionnellement ouvert pour travaux. Un détail m’intrigue. Je me faufile et me rapproche du trompe-l’œil qui se situe au fond du couloir, inaccessible derrière une fausse porte vitrée. Le trompe-l’œil représente un groupe de sept mecs en cravates derrière des rideaux.

Qui sont-ils ? Pourraient-ils être sept archontes envoyés par le Démiurge pour s’opposer au baptême de la ville effectué, selon l’observation d’André Breton, par Hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé et Jarry, soit les sept « poètes dont l’influence se montre aujourd’hui la plus vivace, dont l’action sur la sensibilité moderne se fait le plus sentir » ?
Quelques mois seulement après sa naissance, les parents du petit Gérard Labrunie partent en Silésie où le père est appelé, et sa mère meurt sans avoir revu son fils en 1810. En 1814, après avoir passé quelques années chez son grand-oncle à Mortefontaine, Gérard s’installe avec son père à quelques numéros de son lieu de naissance, au 72 rue Saint-Martin. C’est juste à côté de l’église Saint-Merri, où il a été baptisé avant le départ de ses parents pour l’Allemagne.
Je n’ai jamais pu entrer, sans un serrement d’horreur, dans cette église. Je ne parle pas du Baphomet qui remplace Jésus sur le tympan du portail et qui a été sculpté en 1842. Mais, en promenade en 2019, j’y ai eu une vision implacable d’atrocité : une icône représentant trois anges aux ailes noires communiant autour d’une tête de veau.

Sur le moment, par colère, j’ai pesté : « Ces saletés d’archontes mangent de la tête de veau ! » Je l’ai photographiée, puis je l’ai montrée à ma mère dans un moment d’énervement, et elle a eu un frémissement immédiat : « Mais ce n’est pas une icône chrétienne, enfin, Pacôme… C’est une image satanique, ça saute aux yeux. »
(...)
De Nadir en Zénith
Je passe devant la rue Jean-Jacques Rousseau, ancienne rue Plâtrière dans laquelle le poète des Confessions s’installe le 24 juin 1770 et où il restera jusqu’en 1778 et son départ pour Ermenonville. Jean-Jacques a eu plus de chance que Robespierre avec Paris. Il a sa rue. Et pourtant…
Et pourtant le danger qu’a représenté Rousseau pour tous les pouvoirs depuis bientôt trois siècles est un indicateur infaillible d’authenticité spirituelle. Ouvrir les yeux des hommes sur leur condition politique, leur expliquer que l’inégalité sociale n’est pas un fait « de nature » mais résulte d’une décision de certains hommes pour que d’autres hommes peinent et suent à leur place : pour cela, et pour ne pas s’être arrêté, comme les autres philosophes des Lumières, à la critique de l’intolérance religieuse, Rousseau sera haï.
Mais ce n’est pas le Soleil de Jean-Jacques que je cherche dans le ciel aujourd’hui. C’est l’Étoile de Nerval que je tente de rejoindre alors que je monte vers le neuvième arrondissement en gravissant la rue du Faubourg-Montmartre, comme à l’époque où je vivais rue de Maubeuge. C’était entre 2003 et 2009. Alors, je ne cessais d’arpenter le parcours qui marque l’arrivée de la « première crise » du poète, celle de 1841, si difficile à établir et à reconstituer, tant les lieux ont changé.
L’histoire se passe en janvier. Nerval revient juste de Bruxelles où se joue la comédie lyrique Piquillo, signée Alexandre Dumas mais écrite par lui, qu’interprète Jenny Colon, une actrice-chanteuse dont il est éperdument amoureux. Elle, cependant, ne l’aime pas. Elle s’est mariée en 1838 à un flutiste : pas le musicien de Saint-Merry, mais un certain Louis Marie Gabriel Leplus. Et ses non-baisers ont pour Gérard un goût d’apocalypse.
Pensant retourner rapidement à Bruxelles, Nerval s’installe au 18-20 rue de Navarin chez son ami Théophile Gautier. Au n°33 de cette même rue, un autre cœur brisé, François Truffaut, vivra un siècle plus tard les épisodes terribles de son enfance dépeints dans Les 400 coups. Il y sera d’ailleurs voisin du premier rôle de son deuxième long-métrage, Charles Aznavour, huit ans plus âgé, domicilié pendant la Seconde Guerre mondiale avec ses parents au n° 22. Truffaut a une plaque, Aznavour n’en a pas, et l’immeuble du 18-20 est aujourd’hui en travaux.
Un soir de février 1841, alors qu’il rentre rue de Navarin, Gérard voit une jeune femme à la figure blême apparaître sur le seuil d’un immeuble de la rue Notre-Dame-de-Lorette et sa vision le terrifie. Pour s’y rendre, on doit passer par la place Gustave-Toudouze. C’est sur cette place que, dans Le Pont du Nord, Baptiste, l’extraterrestre androgyne joué par Pascale Ogier, décapite un mannequin qui porte un casque sur les oreilles. Je ne sais pas si Pascale Ogier est la jeune femme à la figure blême dont la vision inquiéta Nerval, mais la tête de la statue Écoute de Henri de Miller, pourrait tout à fait être celle du mannequin décapité par l’androgyne extraterrestre et qui aurait dévalé la pente jusqu’à Saint-Eustache.
(…)
Dans mon voyage céleste et infernal sur la butte, je retrouve la trace de Saint Denis dans le square Suzanne-Buisson, où se tiennent sa statue et la fameuse fontaine sculptée à l’endroit où le céphalophore lumineux avait désaltéré sa tête coupée. À la différence de celui de la crypte de la rue Pierre-Nicole, le Saint Denis du square Suzanne-Buisson est barbu.

Je l’ai découvert bien plus tard mais c’est dans ce square que commence le film qui a inspiré Ngoc Duong et Béatrice Rabier : Céline et Julie vont en bateau. Ce film de 1974 où deux magiciennes jouées par Juliet Berto et Dominique Labourier se rencontrent un été à Paris, se racontent des histoires de maison maudite dans une improbable rue du Nadir-aux-Pommes, entrent dans cette maison et y empêchent le meurtre d’une petite fille qui se répète en boucle dans un espace-temps ensorcelé.
Ce film est aussi mon film préféré. Ma mère l’avait découvert au cinéma un an avant ma naissance. Elle m’en avait parlé lorsque j’étais enfant, et je l’ai vu pour la première fois l’année de mes dix-sept ans. Depuis, je n’ai pas cessé de le revoir, encore et encore, tout en étant longtemps incapable de reconnaître l’itinéraire des jeunes femmes dans Paris.
C’était simple, pourtant. Le film commence square Suzanne-Buisson. À ce détail près que la statue de Denis y est aussi discrète que celle du Centaure de César au début d’Histoire de Marie et Julien. On la voit de dos à l’arrière-plan lorsque Céline passe devant Julie, initialement plongée dans un traité de Papus, et qui se met à la suivre comme Alice suit le Lapin Blanc.
Puis Julie poursuit Céline sur l’allée des Brouillards, une allée qui plaisait tant au cœur de Nerval : « Ce qui me séduisait dans ce petit espace abrité par les grands arbres du château des Brouillards, c’était d’abord ce reste de vignoble lié au souvenir de Saint Denis. J’aurais fait dans cette vigne une construction si légère !... Une petite villa dans le goût de Pompéi. »
Alors qu’elles alternent les visites dans la maison du Nadir-aux-pommes, Julie joue à Céline et réciproquement. Et la dernière se fait passer pour la première lors d’un rendez-vous galant avec son prétendant improbable et ridicule, Guillou, dans le kiosque du square Carpeaux, ancienne dépendance du cimetière Montmartre.
(...)
Démontons les Champs-Élysées
Paris est partout chez Rivette. Mais il ne l’est nulle part autant que dans Out 1, le film ultime du labyrinthe parisien. L’un des deux personnages principaux, la petite voleuse Frédérique, jouée par Juliet Berto, erre autour de la place de la Bastille et se rend sempiternellement au Dupont, un bar qui était situé à l’emplacement actuel de l’Hippopotamus. Pendant ce temps, l’autre, le mendiant Colin, rencontre Pauline (Bulle Ogier) dans sa boutique 2 place Sainte-Opportune, L’Angle du Hasard, remplacée depuis par une boutique de fringues. Lorsque l’ex-faux sourd-muet lui demande si elle est une des Treize, Pauline lui répond en citant Nerval : « La treizième revient… C’est encore la première. » Enfin, le professeur balzacien joué par Éric Rohmer évoque à Colin les pages sur la rue Coquillière dans Ferragus après lui avoir dit : « Une association comme celle des Treize, ça me paraît assez étrange que cela puisse exister. Vous avez peut-être eu vent de quelque chose de ce genre ? »
Oui, nous avons eu vent de quelque chose de ce genre. Comme Lautréamont, Balzac a voyagé dans le Temps. La rue décrite dans Ferragus est celle des Cahiers du Cinéma, sise 39 rue Coquillière à partir de 1970. Et la Nouvelle Vague est bien cette « association comme celle des Treize » ayant réussi à l’époque où a été tourné Out 1. Éric Rohmer ne peut pas l’ignorer. Il l’ignore si peu, d’ailleurs, qu’il l’avouera dans sa préface de 1992 à La Rabouilleuse : « La génération à laquelle j’appartiens a été profondément marquée par Balzac que moi-même et mes amis – qui nous prenions un peu pour les Treize – connaissions presque tout entier par cœur… ».
Le vent souffle où il veut. Plus que le groupe velléitaire et malheureux d’Out 1, la Nouvelle Vague a été ce complot de jeunes gens ambitieux ayant réussi à « prendre » le cinéma, « ayant les pieds dans tous les salons, les mains dans tous les coffres-forts, les coudes dans la rue, leurs têtes sur tous les oreillers ». Comme Balzac lui-même avait rêvé de « prendre » le monde littéraire par l’intermédiaire d’une société secrète, Cheval Rouge. Théophile Gautier qui devait en être, se souvient : « On devait s’emparer des journaux, envahir les théâtres, s’asseoir dans les fauteuils de l’Académie, se former des brochettes de décorations, et finir modestement pair de France, ministre et millionnaire (…) » Mais après quatre ou cinq réunions, Balzac a lâché l’affaire et s’est remis à la Comédie Humaine. « Chacun se replongea donc seul dans la mêlée de la vie, combattant avec ses propres armes » conclut Théo.
À nous deux, Balzac. Je retourne dans le métro. Je prends la ligne 6, arrêt : Passy. Existe-t-il quelque part sur terre un lieu plus intensément chargé de la puissance mentale d’un seul homme luttant, par l’esprit, contre les forces de toute une ville, que la Maison de Balzac, au 47 rue Reynouard ? On dirait le camp retranché d’un conquérant de l’invisible. Un Rastignac métaphysique et spirituel.
(…)
Plus que l’Histoire des Treize, tous les mouvements artistiques depuis le romantisme ont répété l’événement de la Révolution. « J’avais cette réputation d’être le Saint-Just du groupe » dira Rivette à Serge Daney dans Jacques Rivette le Veilleur. « Et qui était Robespierre ? » lui demande Daney. « Ah, c’était François. »
Truffaut et Rivette faisaient partie de la « gauche » des Cahiers du Cinéma, opposée à la guerre d’Algérie. Rivette écrira même un article en faveur d’Octobre à Paris, le film de Jacques Panijel. Je le découvre alors que nous sommes en 2021, soixante ans après. On y voit des Français d’origine algérienne racontant leur sort pendant le couvre-feu discriminatoire, et puis leur vie dans les bidonvilles, rythmée par les arrestations arbitraires et les détentions de plusieurs jours dans le camp de Vincennes. Enfin, les témoignages concernant les massacres policiers perpétrés pendant la marche pacifique du 17 octobre 1961 : « On a été accueilli à coups de feu. Y avait des femmes qui pleuraient, des enfants égarés… » Une petite fille qui dit : « Y avait des messieurs qui étaient blessés, puis y en avait qui étaient morts… » Un enfant traumatisé qui raconte : « Y avait un policier. Il a assommé un petit bébé et il l’a jeté dans la Seine. » Rivette écrit qu’Octobre à Paris est un « document capital pour l’histoire de notre temps ». En effet.