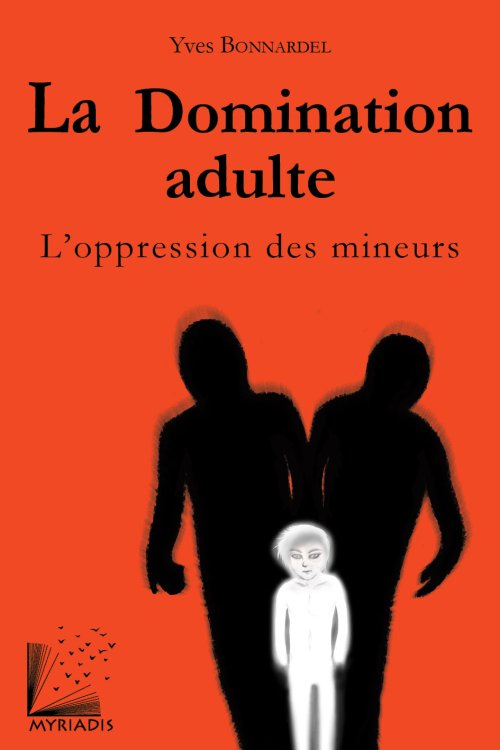Partie précédente : L’occultation de nos enfances
Dans la plupart des sociétés connues, les enfants jouissent très tôt des mêmes capacités que les adultes qui les entourent ; on fait d’ailleurs appel de la même façon, dès l’âge de quatre ou cinq ans, parfois plus tôt, à leurs capacités logiques, de concentration et d’analyse, à leur mémoire, à leurs engagements, à leur sens moral et social... L’école, pour ne prendre qu’un exemple banal, mobilise en permanence ces capacités des enfants. Dans la vie quotidienne aussi, on fait pleinement confiance en leur raison et leur capacité de discernement. On compte encore bien souvent sur eux pour tout ce qui est de la participation aux tâches familiales, ménagères ou de soins.
Certes, concernant ces « menus » travaux domestiques, on semble aujourd’hui toujours considérer pour des raisons obscures (elles ne sont plus guère explicitées) que les filles sont plus capables que les garçons. Ces petites filles à qui l’on demande très vite de garder leur fratrie en bas âge, constituent en tout cas une très bonne illustration du fait qui nous intéresse ici : on leur confie sans hésiter une responsabilité cruciale, délicate, qui demande une attention permanente – et un grand sens de l’organisation si elles veulent pouvoir faire autre chose en même temps.
La dévalorisation de l’enfance
« Si on ne le leur dit pas et si on ne le leur fait pas sentir par son comportement, les jeunes ne se considèrent pas, a priori, comme irresponsables, incompétents, ignorants, stupides et indignes d’avoir droit au chapitre. C’est là un élément important de la notion d’enfance et de ses conséquences pratiques. Dans une société où ces idées n’existeraient pas, les jeunes ne les partageraient pas non plus. » John Holt, S’Évader de l’enfance, 1976 [Réédition L’Instant présent, 2015] [1]
Pourtant, ces capacités réelles des jeunes auxquelles on fait volontiers appel lorsqu’on en a besoin n’empêchent en rien qu’on considère ensuite les mêmes enfants comme inaptes à pouvoir exercer tout pouvoir réel sur leur propre vie. Ils redeviennent automatiquement inaboutis (immatures) dès lors qu’il s’agirait d’accéder à un pouvoir social et politique.
On a vu dans le passé des rois ou des chefs de domaine impubères diriger leur monde à la baguette, mais cela fait longtemps déjà qu’on ne reconnaît plus à « nos » jeunes la capacité de diriger des individus plus âgés qu’eux ; on ne leur reconnaît pas même la capacité de posséder ni de décider en propre, d’ester en justice, etc. Encore faut-il très tôt distinguer entre garçons et filles, ces dernières n’ayant en outre guère de chances de jamais accéder à un rôle social prépondérant (les exceptions confirmant la règle par leur statut d’exemplarité) et étant encore moins préparées à être ces « individus souverains [2] » que sont censés être devenus les adultes.
Inversement, de nombreux garçons à qui l’on n’a jamais demandé de développer ce genre de capacités sont tout à fait incapables de « garder un œil » correctement sur un jeune enfant. On sait bien que beaucoup d’hommes, du fait qu’« on » gère leur vie pour eux, restent souvent « de grands enfants » irresponsables et incapables à bien des égards, qui ne savent ni s’occuper d’un intérieur ni prendre soin des autres ni d’eux-mêmes. Valérie Solanas [3] exceptée, personne à ma connaissance n’a jamais pour autant proposé de les placer sous tutelle ou sous statut de minorité.
Ce qui a été retranché
« Pour estimer à peu près ce qui a été retranché au niveau corporel il n’est que de comparer l’acuité des sens d’un enfant de 3 ans, sa vitalité permanente, l’intensité de ses désirs, son regard, son émerveillement, sa tendresse, sa souplesse de chat et jusqu’à son sommeil avec ceux d’un adulte moyen. C’est comme une lampe qui s’est éteinte. On voit à l’œil nu sur quels points cet adulte réussi modèle conforme, se rendant à son bureau par exemple, a été opéré : il n’utilise qu’une faible partie de son équipement sensoriel ; sa musculature est plus ou moins atrophiée, sa colonne vertébrale est soudée ou menacée d’effondrement, sa capacité respiratoire est réduite, son système nerveux autonome est bloqué, ses plexus sont noués, son énergie ne circule pas, il est dérythmé, son corps est au point qu’il doit le préparer dans un « club » avant d’aller en vacances (s’il peut lui payer ça) ; sa sexualité est misérable, il est plein de maladies psychosomatiques et de dépressions ainsi que de drogues diverses, son cerveau est un magnétophone, ses récepteurs sont saturés, il n’a pas de regard, il dort mal. [...] l’Autre lui fait peur ! Et tout ça, qu’il n’a pas, il redoute de le perdre. Les adultes ont fini par croire que c’est « naturel », de dégringoler à ce point-là. Sinon ils se flingueraient. Mais ça ne l’est pas : c’est une mutilation. Accomplie durant les cinq premières années de la vie. Et si profonde qu’ils aspirent encore à la transmettre. Le mort tire le vif. L’oppression des enfants est première, et fondamentale. Elle est le moule de toutes les autres. » Christiane Rochefort, Les Enfants d’abord, 1976 [4]
Aucun des critiques du statut de mineur n’a manqué de souligner que sa justification par les incapacités intellectuelles et physiques des enfants est invraisemblable, et qu’il faut toute la force des habitudes (et d’un système qui nous privilégie) pour qu’une telle irrationnelle rationalisation trouve crédit :
« Le statut de l’enfant […] s’applique à des populations ayant des niveaux d’autonomie très divers ; il s’applique notamment à toute une population d’adolescents qui sont non seulement en possession de tous leurs moyens, mais en possession de plus de moyens, physiques et intellectuels, que la population d’adultes qui les « garde » [5].
Nonobstant le cas très fréquent des petites filles responsables dont je viens de parler, et auquel on ne pense guère, on entend de loin en loin parler d’enfants qui exerç(ai)ent des responsabilités, un pouvoir d’adulte. Ainsi de Johnny et Luther Htoo, ces garçons dirigeants d’une guérilla Karen en Birmanie dans les années 1990 lorsqu’ils étaient âgés de 9 à 12 ans. Ainsi de tel général d’armée, sous la Révolution française, qui avait 14 ans. Ainsi de ces très jeunes zapatistes, filles et garçons, qui manient le fusil comme leurs ainé-e-s lors de l’insurrection indigène au Chiapas (Mexique) en janvier 1994 et qui participent depuis lors aux assemblées communautaires au même titre que les adultes. Nicole Maillard parle d’ailleurs, cette fois-ci en France, de « ces élèves de dix ans [qui dirigent] des Conseils avec une maîtrise de la conduite de réunions que leur envieraient bien des cadres sortis des meilleures écoles de communication [6] ». Encore faut-il pour ce faire que ces enfants en aient l’occasion. L’expérience de l’école mutuelle au XIXe siècle a trop bien montré que tout enfant est tout à fait capable d’enseigner aux autres – souvent bien mieux et plus efficacement qu’un adulte. C’est pour cela qu’elle a été éliminée, précisément. Shulamith Firestone rappelle aussi que :
« la précocité si répandue au Moyen Âge et dans les temps qui suivirent est tombée, à notre époque, à près de zéro. Aujourd’hui, par exemple, les exploits de Mozart enfant, dans le domaine de la composition, apparaissent difficilement croyables. Mais de son temps, ce n’était pas si exceptionnel. Beaucoup d’enfants alors jouaient et composaient de la musique, et participaient à de nombreuses autres activités d’adultes. » [7]
John Holt aussi donne de nombreuses illustrations de capacités dont font preuve des enfants qui sont pourtant jugées injustement être spécifiquement des capacités d’adultes. Et il note judicieusement qu’aujourd’hui :
« Les termes même « précoce » et « précocité » nous font penser à une maladie. Ce vocabulaire trahit notre sentiment que la plupart des enfants auraient été bien incapables d’en faire autant et qu’un enfant qui a pu le faire devait être anormal d’une façon ou d’une autre. Beaucoup de gens éprouvent à l’égard des enfants tant de condescendance sentimentale que lorsqu’on leur dit qu’un enfant de quatre ans parle le latin et le grec, ils en éprouvent une sorte d’horreur. Poutant, cela n’a rien d’extraordinaire, même de nos jours [8] …
Il ne s’agit bien sûr pas ici de vanter la « précocité » pour la précocité ni de faire l’éloge des « enfants surdoués », ces chevaux de course qu’on entraîne intensément pour des concours imbéciles. Autrement plus important, il s’agit de rappeler que nos sociétés produisent à grands frais et de façon extrêmement organisée des handicapés à tous niveaux : corporel, affectif, intellectuel, social, etc. Et qu’il pourrait en être autrement.
La vie de Louis XIII petit
« Ariès cite le Journal sur l’enfance et la jeunesse de Louis XIII, d’Héroard : il s’agit du compte-rendu détaillé [écrit par son médecin] des années d’enfance du dauphin […], né en 1601 – et doué seulement d’une intelligence moyenne – qui nous montre que nous sous-estimons les possibilités des enfants. Nous y apprenons qu’à l’âge [de dix-sept mois] où il jouait du violon, il jouait aussi au mail, qui était pour les adultes d’alors l’équivalent du golf, et à la paume ; il parlait ; il s’amusait également à des jeux de stratégie militaire. À trois et quatre ans respectivement, il commença à lire et à écrire. À quatre et cinq ans, bien qu’il jouât encore à la poupée (!), il tirait à l’arc, jouait aux cartes et aux échecs (à six ans) avec les adultes, et à beaucoup d’autres jeux de grande personne. À tout âge, dès qu’il fut capable de marcher, il participait à toutes les activités des adultes telles qu’elles étaient, dansant, jouant la comédie, et à toutes leurs distractions. À l’âge de sept ans, le dauphin commença à porter des vêtements masculins semblables à ceux des adultes, ses poupées lui furent retirées, et des précepteurs commencèrent à diriger son éducation ; il se mit à chasser, à faire de l’équitation, à tirer au fusil et à jouer à des jeux d’argent » [9].
Nombreux sont les observateurs contemporains qui jugent que les enfants des sociétés développées voient leurs possibilités phénoménalement limitées. Non seulement ils sont tenus en permanence de coller à des figures du masculin ou du féminin (être des petites filles ou des petits garçons), mais ils doivent continuellement « faire l’enfant » : s’abîmer dans une culture cucul, s’exprimer de façon infantile, quémander d’une voix plaintive, ne pouvoir oser la moindre initiative. La famille et l’éducation contemporaines réussissent ce tour de force d’infantiliser les enfants, de les encamisoler dans une identité qui restreint de toutes parts leur affirmation et, n’en déplaise à nos modernes pédagogues, leur épanouissement. Les enfants modernes sont laminés, ce sont des humains mutilés, maintenus infirmes par l’ensemble d’un dispositif social complexe : l’enfance.
Les institutions jouent un rôle crucial dans ce rognage généralisé de tout développement des capacités des enfants :
« Progressivement, les enfants se retrouvent de plus en plus enfermés dans leur école, mais aussi au sein de leur propre classe ; c’est la liberté même de circuler ou de disposer de son corps qui est aujourd’hui en péril ; on ne compte plus les écoles où les enfants n’ont plus le droit de sortir seuls pour aller aux toilettes ; les possibilités de circuler en classe ont également tendance à être réduites au minimum. Les écoles où on laisse les enfants monter et descendre par eux-mêmes en classe paraissent révolutionnaires (voire insoumises) à une époque où la tendance est plutôt à proscrire et à réglementer tout ce qui se passe dans la cour : ici, on interdit les ballons en cuir, là les ballons tout courts, ailleurs les images et les cordes à sauter, là encore les foulards, écharpes et sucettes ; nombre d’équipes d’enseignants et de directeurs limitent les zones autorisées dans les cours de récréation pour les rétrécir, voire limitent les possibilités de se rendre aux toilettes pendant les récréations elles-mêmes [10].
On aurait néanmoins tort de ne voir là que le fruit isolé du développement des normes légales de sécurité. De façon bien plus préoccupante, il s’agit du développement d’une idéologie sécuritaire du zéro risque « éducatif », qui revient à enserrer l’enfant dans un tel réseau de protections qu’il ne peut plus bouger ni pied ni patte. Cette idéologie a progressé à toute vitesse dans nos sociétés, sans qu’on s’en rende bien compte ni qu’on s’en alarme comme il faudrait. Dans le très précieux article qu’elles ont rédigé sur la question, Sue Scott et Stevi Jackson notent par exemple qu’en Angleterre, dans les années 1970, pratiquement tous les enfants de sept-huit ans se rendaient seuls à l’école : seuls 20% d’entre eux étaient accompagnés par leurs parents. Vingt ans plus tard, les enfants « laissés à eux-mêmes » sur leur trajet ont quasiment disparu : ils ne sont plus que 9% [11] ! C’est désormais dans tous les domaines qu’un sentiment de protection exacerbé vient cadenasser toute liberté des mineurs.
Quelles conséquences cela a-t-il ? Faute de possibilités de s’éprouver, faute d’expérience, chacun a peur de la vie, de l’avenir, et manque de confiance en ses possibilités de faire quoi que ce soit sans mode d’emploi ni modèle... On ne sort pas indemne de 18 ans d’infantilisation et d’inhibition de ses élans : un tel régime limite drastiquement la confiance qu’on peut développer en son propre jugement et en ses propres forces, puisqu’on n’a guère eu l’occasion de les mettre à l’épreuve. On tend dès lors à combler l’absence de confiance en soi par une assurance sociale, comparative, en tentant désespérément de se valoriser et de coller à une identité sociale. Formellement, nous vivons dans une société où, une fois majeurs, nous jouissons d’une liberté sociale inédite ; mais c’est une liberté que nous n’exerçons que d’une façon extrêmement réduite. Nous n’osons rien faire de notre vie. Nous sommes paralysés par la peur de l’avenir, par le respect des normes et par le regard des autres. Tout semble indiquer que nos sociétés garantissent une liberté d’autant plus large qu’elles s’efforcent d’en retirer le goût et l’initiative à leurs « citoyens ». Nous avons peur du jugement les uns des autres et peur de prendre des initiatives. Nous sommes même bien souvent sans nous en rendre compte dans un rapport panique au monde, paradoxalement bien plus sans doute que nos aïeux, censés pourtant avoir vécu dans des conditions bien plus dures.
L’évolution actuelle tend de fait à prolonger des rapports d’assistance : de plus en plus de majeurs restent longtemps sous la dépendance de leurs parents et restent marqués par le modèle familial (autoritaire ou « démocratique ») dans leurs relations aux autres et aux pouvoirs, quels qu’ils soient. Imprégné de sa propre insécurité identitaire, chacun craint d’échapper à la norme. Or, la peur est bien le ciment de tout ordre social inégalitaire.
L’art de la politique en démocratie représentative porte sur la loi des grands nombres. Du point de vue du maintien de l’ordre, peu importe quelques dissensus ; il importe par contre qu’ils restent bénins ou, s’ils prennent de l’ampleur, qu’ils restent suffisamment minoritaires pour apparaître comme émanant de sectes diverses et variées, identifiables et dès lors contenables. Produits par l’éducation familiale et scolaire, nous sommes doublement manipulables : parce que nous avons intégré la discipline, la résignation, la mésestime de soi et le renoncement à nos rêves. Mais aussi parce que, produits en série, nous réagissons en gros de façon similaire et prévisible. L’immense diversité humaine, qui pourrait proprement se révéler ingouvernable, est réduite à des plus petits communs dénominateurs qui rendent possible une gestion globale, où les potentialités d’écarts, de pas de côté, de sécessions, de soubresauts, de révoltes sont statistiquement maîtrisées. Des sociétés injustes ne peuvent proposer un (semblant de) fonctionnement démocratique qu’en ayant préalablement mutilé le champ des désirs des « citoyens », enrayé dès les premières années la soif de déploiement.
La croyance est aujourd’hui bien établie que les enfants, même passées leurs premières années, sont incapables de vivre leur vie, de décider par eux-mêmes « de façon éclairée », de savoir ce qu’ils veulent ni de s’en donner les moyens. Pourtant, il n’est que d’aller dans le « Tiers-monde » pour se détromper. Mon propos n’est pas d’avancer que la vie des enfants dans les pays pauvres est particulièrement enviable ; simplement, on peut y constater que les enfants se débrouillent fort bien, au besoin « seuls » (sans l’aide d’adultes) – alors que nous les tenons ici sous contrôle permanent et leur dénions toute autonomie.
Il n’est pas difficile d’imaginer que le caractère puéril, immature, narcissique, affectivement dépendant et manquant de confiance en soi de la grande majorité des enfants (et par conséquent de très nombreux adultes), ne résulte pas d’une « nature » infantile – qui serait soudainement apparue ces deux derniers siècles dans les classes aisées de nos sociétés avant de se généraliser –, mais bien plutôt des conditions systématiques de dépendance qui leur sont imposées. Dans leur article de sociologie déjà cité, intitulé Risk anxiety and the social construction of chilhood (« La crainte du risque et la construction sociale de l’enfance »), Stevi Jackson et Sue Scott détaillent combien le sentiment d’insécurité des adultes vis-à-vis des enfants structure entièrement leurs rapports. De peur que les enfants se brûlent, se coupent, glissent, tombent, perdent un œil, se fassent écraser, etc., il ne leur est plus rien permis de faire sans qu’on les prenne par la main et tende un filet de sécurité ; de peur qu’ils n’arrrivent pas à mener à bien quelque entreprise que ce soit, on les prend en charge et les assiste ; de peur qu’ils fassent mal les choses, qu’ils disent n’importe quoi ou fassent des « bêtises », on leur intime de rester tranquille et de se taire, etc.
Bien pire, ces restrictions toujours élargies se trouvent assorties de pronostics mutilants, évidemment autoprédictifs : « Fais attention ! », « Incapable ! tu vas tomber » ! », « Idiote, fais comme cela ! », « Tais-toi donc, tu dis des bêtises ! », etc. Bref, on réduit leurs possibilités comme peau de chagrin, et leur assurance ne risque pas de trouver à se fortifier. Cette absence totale de confiance en les capacités de l’enfant à « faire attention », en ses possibilités propres de se rendre compte des situations et d’en tirer les conclusions pratiques nécessaires, l’impossibilité qui en découle pour les enfants de faire des erreurs et d’en tirer profit, a un effet autoprophétique bien connu : elle construit des enfants qui méconnaissent leurs possibilités, qui n’ont plus même accès à leur propre réalité… et qui se mettent en danger ou se blessent facilement.
Christine Delphy parle fort justement d’« éducation à l’incompétence ». Stevi Jackson note pour sa part :
« On envoie à l’école des enfants incapables de s’habiller eux-mêmes à un âge où, dans d’autres sociétés et dans la nôtre auparavant, ils auraient commencé à contribuer de façon substantielle à la vie et au travail de leur communauté [12] ».
Parvenir à un tel résultat, d’une ampleur inconnue dans aucune civilisation du passé, nécessite un travail herculéen de tous les jours : en effet, comme on l’a vu, les enfants spontanément ont plutôt une bonne idée d’eux-mêmes et de leurs propres capacités. Pour détruire leur confiance en eux, il faut consacrer à cette entreprise une attention permanente, une énergie renouvelée pendant des années ; il faut que l’enfant reste en permanence au centre de l’attention des adultes, et que cette attention soit sans relâche effective, qu’elle se traduise sans cesse par des gestes et des commentaires explicites, restreignant et canalisant tout champ d’action. Nos sociétés ne se laissent pas décourager et ne reculent devant aucune tâche, aussi titanesque soit-elle ! À cette condition, et à cette condition seulement, les enfants peuvent être produits immatures, incapables et irresponsables.