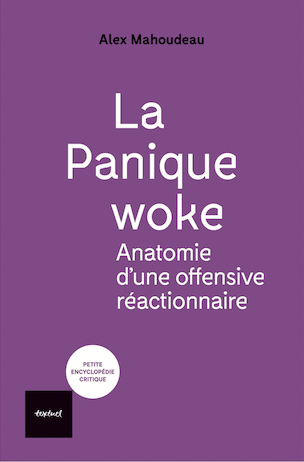
Extrait n° 1 : Aux sources obscures de la panique woke
Les présidences de George Bush Jr et de Barack Obama voient un maintien de l’importance des guerres culturelles : alors même que, sous le premier, la droite néoconservatrice atteint son apogée et entre officiellement à la Maison-Blanche, il ne lui faut pas très longtemps pour réactiver sa énième offensive sur les départements de Lettres et Sciences humaines, sur fond de victimisation.
C’est ainsi qu’en 2003, le député républicain Jack Kingston propose une résolution par laquelle le Congrès mettrait en place un « Academic Bill of Rights » (ABOR), initialement concocté par la fondation de l’éditorialiste néo- conservateur David Horowitz, qui prend à l’occasion une pause dans sa carrière de faiseur de listes pour se plaindre des pressions idéologiques sur les professeurs. Ancien militant de gauche reconverti dans le néoconservatisme [1], il peut ainsi développer, à partir des années 1980, une véritable machine à scandale sur les campus, y compris en embauchant de jeunes étudiants conservateurs pour raconter les pressions réelles ou imaginaires qu’ils auraient ressenties pendant leurs études (Stanley, 2018).
Malgré son titre flatteur, le principe de l’ABOR est double : imposer aux universités un devoir de « diversité idéologique » dans leurs politiques de recrutement, ainsi que des thèmes et lectures conservateurs dans le contenu des enseignements. En d’autres termes, imposer une forme de discrimination positive au profit des enseignants conservateurs puisque, pour ses défenseurs, le problème des universités est qu’elles seraient surchargées de gauchistes [2]
.
Autre proposition-phare : imposer aux enseignants discutant un sujet « controversé » de présenter les contre-arguments à la position qu’ils présentent. Pour certains critiques, cela signifie établir, dans les faits et sous une formulation vague, une obligation à enseigner la théorie créationniste aux côtés du darwinisme. Et puisqu’après tout, comme le précise le texte de l’ABOR, « les curriculums et syllabus en humanités et sciences sociales devraient refléter l’incertitude et le caractère incertain de toute connaissance humaine dans ces domaines », ces disciplines sont particulièrement ciblées.
Le curieux effet de manche conduisant à soutenir une restriction des libertés académiques au nom même de leur défense n’échappe pas aux défenseurs des libertés états-uniens : dans un avis sur le texte, la Coalition nationale contre la Censure (NCAC) explique ainsi que « ce qu’on trouve derrière la rhétorique de “l’équilibre” révèle non seulement une proposition qui ne peut en pratique pas fonctionner, mais représente également une intervention étatique excessive dans le domaine de la liberté académique » (National Coalition Against Censorship, s. d.).
Dans l’écosystème bien établi des fondations conservatrices émerge également une autre pratique, consistant à mettre en avant l’expérience d’étudiants conservateurs se sentant isolés dans des environ- nements trop « gauchistes ». Un des futurs conseillers de Donald Trump, Steven Miller, jeune protégé de David Horowitz alors âgé de 16 ans, trouve une oreille attentive auprès de grands talk-shows comme ceux de Larry Elder ou de Rush Limbaugh, pour se plaindre du manque de patriotisme des élèves de son lycée ou des excès du multiculturalisme (Guerrero, 2020).
Des approches similaires seront reprises une décennie plus tard avec la formation du groupe « Turning Point USA », se donnant pour mission de mener la guerre culturelle sur les campus en généralisant cette pratique du témoignage et de l’appel à la censure, sous couvert de défense de la liberté d’opinion. D’autres groupes, comme l’organisation « Campus Reform », recrutent également des étudiants pour dénoncer les « biais gauchistes sur les campus », traquant avec minutie les interventions média, les polémiques créées et surtout les « victoires », terme employé par l’organisation pour décrire « toute situation dans laquelle une université change une politique, renvoie quelqu’un ou répond d’une autre façon aux inquiétudes mises en avant par les informations rapportées sur son site » (Schmidt, 2015).
Ces organisations trouvent enfin un fort écho dans un écosystème médiatique développé à cet effet : Fox News crée ainsi, durant les années Obama, un segment dédié à « La folie des campus », à rajouter bien évidemment à la couverture déjà disproportionnée des guerres culturelles accordée par la chaîne à travers des émissions comme celles d’éditorialistes tels que Glenn Beck ou Bill O’Reilly.
À partir de 2004, et alors que son pays s’enferre dans vingt ans de guerre en Irak et en Afghanistan qui causeront un nombre gigantesque de victimes, O’Reilly s’active à alerter le monde sur une autre guerre : la « guerre contre Noël ». Extension d’après lui du « politiquement correct », elle viserait à bannir de l’espace public toute mention à Noël, et surtout à sa nature religieuse [3] . La « guerre à Noël » est désormais l’un des éléments classiques du très populaire talk-show « Tucker Carlson Today ». Mais la thématique n’est pas exclu- sive à la chaîne : des shows radio de Rush Limbaugh s’époumonant sur les « féminazies » à l’émergence du média Breitbart News en 2007, en passant par les best-sellers de Dinesh D’Souza sur les dangers de la « gauche culturelle » aux États-Unis, la thématique des guerres culturelles devient simplement un élément récurrent dans le camp conservateur, tout comme peut l’être la crainte du déficit public ou la dénonciation de « l’assistanat » – une partie du camp démocrate n’étant que trop contente de lui donner la réplique en promouvant un discours d’inclusivité vide de mesures systémiques ou concrètes.
[…]
C’est en partie par la congruence d’un espace médiatique et politique conservateur obnubilé par les « guerres culturelles » et d’une nouvelle-nouvelle-nouvelle droite au style flamboyant et à cette mentalité obsidionale que revient le discours de la victimisation autour du « politiquement correct ». En rupture avec les néoconservateurs sur de nombreux aspects (l’alt-right était, par exemple, censément favorable à un isolationnisme et opposée à l’attitude de « gendarme du monde » adoptée par les « néocons »), cette droite n’a pas de problèmes à reprendre ses inquiétudes concernant les universités et le monde culturel. On retrouve là le mode particulier de victimisation décrit par Corey Robin (2018).
Le milieu des années 2010 est également l’occasion d’un renouveau de l’obsession pour la politique des campus où les représentants autoproclamés de l’« alt-right » décident de s’engager, comme le montre Ridley : certaines célébrités se mettent à investir l’espace des campus en annonçant des cycles de conférences, ou sur invitation de groupes d’étudiants conservateurs locaux. Ces événements sont, pour ces activistes, l’occasion de se prêter à un jeu intéressant en mettant en scène leur capacité à « clouer le bec » d’étudiants progressistes dans des débats très contrôlés, tout en mettant en scène leur propre victimisation lorsque d’autres étudiants choisissent de protester contre leur venue et tentent de la faire annuler.
Alors même que la droite prend les rênes de la Maison-Blanche, ce cycle oriente le débat vers le fait que la gauche tiendrait encore (avec de plus en plus de difficultés) celles des départements de Lettres. Dans ce contexte, parvenir à se présenter en victime d’une censure de gauche sur un campus confère une aura conséquente. Maintenant la tradition établie par le passé, des organisations comme Turning Point sont en effet capables de crier aux pressions idéologiques d’une main, tout en concevant des sites web permettant d’afficher et de dénon cer son « prof radical » d’une autre.
2016 voit également la réémergence du profil de l’universitaire se revendiquant comme progressiste ou apolitique, et se présentant comme persécuté par un establishment radicalisé. La tête de gondole de ce produit particulier est peut-être le psychologue canadien Jordan Peterson, qui entre avec fracas dans le débat public en dénonçant l’application de la loi canadienne « C-16 » étendant les protections contre les discours de haine à la question de l’identité et de l’expression de genre. Peterson, jusqu’alors professeur spécialisé dans la psychologie des archétypes, se fait remarquer en défendant, contre l’avis des experts et du législateur, qu’une telle loi conduirait à identifier comme « discours de haine » toute situation dans laquelle une personne désigne un interlocuteur par un pronom inapproprié.
En dépit de la déconnexion totale entre cette accusation et la réalité, lui et sa chaîne YouTube « Le professeur contre le politiquement correct » deviennent rapidement très populaires, et son ouvrage de self-help 12 règles pour une vie, un best-seller international. Des figures similaires sont ainsi élevées au rang de martyrs, comme par exemple le biologiste Bret Weinstein, violemment pris à partie par des étudiants durant une manifestation antiraciste sur le campus de son université, abandonné par sa hiérarchie et très vite érigé en symbole d’un antiracisme modéré et réaliste, face à l’irrationalité collective.
Dans un article de 2018, Weinstein, Peterson et d’autres sont présentés comme le « Dark Web Intellectuel » ou IDW (Intellectual Dark Web) (Weiss, 2018). Le groupe était décrit comme participant à un mouvement de résistants à l’air du temps idéologique. Il regroupait d’ex-universitaires devenus personnages publics, des éditorialistes, un animateur de podcasts ainsi que plusieurs intellectuels généralistes ayant peu en commun, si ce n’est, d’après les auteurs de l’article, une volonté de discuter de thèmes « difficiles à aborder ».
Le point commun des membres se retrouvait également dans la dénonciation d’une université que ces auteurs trouvaient engoncée dans une pensée unique déterminée par son besoin d’adhérer à l’esprit progressiste – ceci, particulièrement dans les sciences sociales. Un autre « coup » média- tique enfonce le clou la même année, quand trois personnes révèlent avoir fait paraître, notamment dans des revues consacrées au genre, une série de sept canulars scientifiques censés discréditer la scientificité de ces champs. Nommé « affaire Sokal au carré », en référence à une précédente affaire de canular attaquant la théorie postmoderne dans les années 1990, ce coup bénéficie d’une médiatisation considérable (Mounk, 2018).
À y regarder de plus près, l’IDW et « Sokal Squared » ne sont pourtant pas si marquants que cela. D’abord, les idées « dangereuses » promues par l’IDW ressemblent davantage aux platitudes d’un certain sens commun conservateur : l’idée que les différences sociales entre classes, entre sexes et entre Blancs et minorités, et donc les inégalités qui en découlent, sont « naturelles » plutôt que socialement construites, que la politique étrangère des États-Unis est légitime, ou encore que c’est par son travail individuel plutôt que par des mobilisations sociales que l’on doit espérer améliorer sa situation [4].
Quant à « Sokal Squared », sur les sept canulars publiés, la plupart étaient constitués d’articles certes verbeux, mais dont la dimension de canular s’appuyait surtout sur le fait qu’ils étaient composés sur une base de données inventées. Du reste, si le canular scientifique (un exercice fréquent et répété dans de nombreuses disciplines) peut conduire à discréditer la pratique prédatrice d’une revue particulière acceptant tout et n’importe quoi, parfois en échange de frais de publication, l’exercice ne dit rien de la validité ou de l’invalidité des autres travaux publiés dans cette revue, et à plus forte raison dans la discipline tout entière. En réalité, ces deux affaires tournaient principalement autour des marottes conservatrices, revenant, comme l’explique Michael Brooks (2021) à « naturaliser ou mythologiser toutes les hiérarchies sociales » et à discréditer des acteurs se mettant en travers d’un tel agenda.
Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant de voir émerger, à la fin des années Trump, un président élu après une campagne mettant en scène son caractère « politiquement incorrect », une nouvelle manifestation de ces thèmes sous la forme de la crainte successive de la « cancel culture » et du phénomène « woke » – et ce, d’autant plus que le débat national se retrouve orienté, dans la dernière année du mandat, vers les questions d’antiracisme, à la suite du meurtre de George Floyd par un policier.
En juillet 2020, pendant que les manifestations antiracistes battent leur plein, une lettre ouverte col- lective « sur la justice et la liberté de débattre » est publiée par le journal Harper’s Magazine. Celle-ci opère un intéressant tour rhétorique en prenant le temps de dénoncer le rôle de la droite trumpiste dans les atteintes à la liberté d’expression, avant de concentrer ses efforts exclusivement sur ces atteintes quand elles viennent de la gauche. Alors même que les institutions sont dans les mains d’une coalition très conservatrice et très répressive, une partie du débat public se réoriente vers la question de la liberté d’expression d’éditorialistes de droite sur les campus des facs de Lettres et sur les appels, dans un certain nombre de villes, à retirer des statues ou changer des noms de lieux honorant des personnalités historiquement liées au racisme en général, et à l’esclavagisme en particulier.
En effet, après la défaite du camp esclavagiste lors de la guerre de Sécession états-unienne, une campagne d’érection de monuments à la gloire de ce camp a été engagée, notamment par l’association des. « Filles unies de la Confédération », pour défendre l’héritage du Sud esclavagiste. C’est cette vision mythifiée de la « cause perdue » qui est contestée par les manifestants aux côtés de nombreux autres sujets liés à l’inégalité économique, de santé et, sur- tout, face à la police. Des conflits similaires ont eu lieu de longue date en Afrique du Sud, en Angleterre mais aussi en France, où la statue de Joséphine de Beauharnais fait l’objet de conflits depuis les années 1990 au moins. Comme souvent, l’espace public sert ici de point de cristallisation de conflits sociaux plus larges. Aux États-Unis, c’est aussi une statue, celle du général confédéré Robert E. Lee à Charlottesville, dont la promesse de retrait, obtenue par des activistes locaux en 2017, avait conduit à un vaste rassemblement de l’alt-right.
Comme l’explique Ridley, focaliser l’attention sur la question de « l’effacement de l’histoire » permet aux militants d’alt-right de mobiliser une rhétorique victimaire face aux revendications liées à la justice, tout en se présentant faussement comme les défenseurs de la connaissance de l’histoire. À Charlottesville, l’alt-right a, en fin de compte, souffert de ses propres excès, conduisant à la mort d’une manifestante. Trois ans plus tard, ce ne sont plus des acharnés défilant aux cris de « Sang et sol » qui ont repris à leur compte la noble cause de la défense des statues face aux foules antiracistes, mais de paisibles éditorialistes détachés de toute appartenance à la droite radicale.
Il faut dire qu’entre-temps les flamboyances provocatrices de l’alt-right ont été remplacées par une forme plus feutrée d’influence, bien incarnée par le lobbyiste Christopher Rufo, auteur d’un « rapport » établissant que le gouvernement fédéral ambitionnerait d’inculquer « à tous les niveaux de l’administration » les enseignements de la « théorie critique de la race » (CRT) décrite plus haut. Rufo est surtout un communicant cherchant un moyen de remobiliser la base conservatrice états-unienne, alertant sur l’idée qu’une chape de plomb antiraciste serait sur le point de s’abattre sur le pays. Il reconnaît par ailleurs ouvertement que l’objectif de sa campagne est de « récupérer la marque » de cette théorie académique, pour en faire un signifiant négatif et un objet de panique : « Pour l’essentiel, j’ai pris ce corps de cri- tique, je l’ai associé avec des faits divers choquants et horrifiants, et je l’ai politisé. J’en ai fait un enjeu poli- tique remarquable, avec un méchant », explique-t-il ainsi (Meckler et Dawsey, 2021).
Les effets de cette dernière variation du backlash se retrouvent particulièrement dans le domaine de l’éducation : une multiplication de lois « anti-CRT » visant les écoles du pays, dont les plus grossières sont accompagnées de listes d’ouvrages à proscrire, incluant pour certaines les textes de Martin Luther King, de Toni Morrison ou d’Art Spiegelman (Marcotte, 2022). Le tout, bien entendu, au nom de la liberté d’expression.
L’environnement médiatique français a fait bon accueil aux polémiques marquant la naissance de la panique woke. Dans un pays constamment inquiet
de « l’importation d’idées anglo-saxonnes », les débats sur « la folie des campus » font ainsi l’objet d’un intérêt renouvelé à partir de 2019, notamment face à un féminisme et un antiracisme faussement décrits comme étrangers au corps national (Rey- Robert, 2020). À la publication en français d’ouvrages comme White, de Bret Easton Ellis, se lamentant de la pression du politiquement correct dans son pays, à des « coups » médiatiques comme la lettre ouverte de Harper’s Magazine, rapidement reprise dans les colonnes du Monde, s’ajoute un flux régulier de reportages sur les outrances du « politiquement cor-rect », de la « cancel culture » puis du « wokisme » sur divers campus et dans diverses industries, et, enfin, des ouvrages directement publiés en français dénonçant « l’américanisation » du débat tout en important l’essentiel de leurs exemples et analyses des États-Unis.
Cet environnement est par ailleurs renforcé par l’héritage des campagnes « anti-genre » qui marquent le débat public européen au début de la décennie, particulièrement au moment de la mobilisation contre l’ouverture du mariage aux couples de même sexe pour ce qui concerne la France, mais aussi, précédemment, face à l’idée que la « théorie du genre » serait infiltrée dans les écoles (Kuhar et Paternotte, 2020). Plus tard, ce sujet s’étend à la dénonciation des « ABCD de l’égalité », censés servir à appréhender la question dans les écoles. En s’appuyant sur un réseau solide de think tanks – et, de plus en plus, de médias –, la cause anti-genre permet de réorienter les énergies conservatrices après la défaite de 2013 vers une cause commune, tout en s’adaptant à une opinion publique moins ouverte à des discours franchement sexistes ou homophobes.
Comme l’explique Gaël Brustier, qui revient sur le rôle de l’hégémonie culturelle dans la stratégie conservatrice après la Manif Pour Tous, la panique morale autour du genre n’a peut-être pas donné au mouvement conservateur français une victoire, mais elle leur a donné un étendard et des représentants, à la fois politiques et dans le monde intellectuel et du journalisme : « On pourrait les qualifier de “fachos Spontex” : ce sont les “néo-réacs”, adversaires com- modes de tous les bien-pensants et contradicteurs non moins commodes d’un débat public faussé. […] Ces individus s’insinuent dans le sens commun et s’y lovent, car ils s’y trouvent bien : celui-ci leur permet de disposer d’une niche, rentable médiatiquement » (Brustier, 2014, p. 96-97).
C’est dans le contexte de cet environnement médiatique que la brutale apparition de la thématique du « wokisme » a lieu dans le débat public français.
Il semble donc compliqué de dire que quelque chose de « nouveau » se passe au début des années 2020 pour expliquer la soudaine apparition du
« wokisme » comme thème d’inquiétude politique et médiatique d’importance. Après avoir restitué historiquement les polémiques conservatrices sur l’Université, il paraît plus exact de dire que l’on a affaire à la réémergence d’un débat ancien qui a connu des mutations multiples, et dans lequel les positions, les accusations comme les arguments sont, en réalité, très stables à travers le temps. « Mes Universités », la chanson de Clay se plaignant de la médiocrité d’une jeune génération d’étudiants en Lettres, ne cesse d’être réécrite sous forme d’articles et d’ouvrages. Seul le casting semble changer. La différence se situe davantage dans le traitement de ces débats par le monde médiatique.


