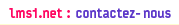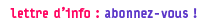Les lignes qui suivent proposent un aperçu de la violence policière sous sa forme la plus radicale : l’homicide. Elles rappellent également l’impunité quasi-complète dont bénéficie cett violence.
Les réfugiés, comme les sans-papiers, vivent une profonde insécurité. Eux aussi subissent des violences sans s’attirer la compassion de nos dirigeants. Eux aussi voient ces dirigeants chercher des excuses aux coupables, quand ils ne les félicitent pas. Il faut en effet le rappeler : à la frontière franco-italienne, en 1995, un enfant yougoslave de neuf ans est abattu d’une balle dans le dos par un douanier. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux, déclare que les gendarmes ont « fait leur travail normalement », et le juge d’instruction accorde un non-lieu. Après appel, le policier est finalement jugé, mais il plaide la légitime défense et est acquitté [1].
Cette conception dévoyée de la légitime défense ne s’applique d’ailleurs pas qu’aux réfugiés : selon un décret datant de 1903, jamais abrogé, un gendarme peut tuer s’il n’a pas d’autre moyen d’immobiliser un véhicule. Les policiers quant à eux ne bénéficient pas de ce permis de tuer, mais le moins qu’on puisse dire est que la jurisprudence leur est extrêmement favorable, et qu’elle leur accorde, de fait, une quasi-impunité.
Nous ne dresserons pas ici la liste de toutes les personnes, pour la plupart jeunes, de sexe masculin et « issues de l’immigration », qui sont mortes dans des conditions suspectes sous les balles de la police, à la suite d’étouffements ou de coups et blessures, ou dans un accident de la route causé par une course-poursuite. Ce travail de mémoire, Maurice Rajsfus l’a réalisé avec courage et ténacité – aboutissant à un chiffre de 196 homicides entre 1977 et 2001, et à une moyenne en constante augmentation : 6 morts par an entre 1977 et 1987, 8 morts par an entre 1987 et 1997, 10 morts par an entre 1997 et 2001 [2]. Mais il faut bien en parler, car les « bavures policières » sont sans doute le principal et le plus redoutable non-dit de tous les discours sur « la violence des jeunes ».
En effet, les grandes émeutes qui défraient la chronique ne viennent pas de nulle part : loin d’exprimer une quelconque « sauvagerie » ou une « « culture de la haine », elles éclatent souvent en réaction à une « bavure » mortelle. C’est le cas pour les émeutes de Vaulx-en-Velin en 1990, de Mantes-la-Jolie en 1991, de Paris en 1993, de Dammarie-les-Lys et de Lyon en 1997, de Tourcoing et de Toulouse en 1998, de Clichy-sous-Bois en 2005 ou de Villier-le-Bel en 2007 [3].
L’émeute : une demande sécuritaire
Ces émeutes doivent donc être comprises comme des demandes sécuritaires, ou comme des protestations contre le laxisme des institutions : des jeunes sont tués dans des conditions parfois sans équivoque (à bout portant, dans un commissariat, d’une balle dans le dos), et les policiers mis en cause sont dans le meilleur des cas suspendus, sans faire la moindre journée de détention – alors que c’est le sort habituel de n’importe quel voleur de voiture, casseur de vitrine ou revendeur de cannabis [4].
L’attente du procès est particulièrement longue : par exemple, le policier Pascal Hiblot, qui a abattu Youssef Khaïf d’une balle dans la nuque en 1991, n’est passé devant les Assises qu’en septembre 2001, après appel (d’un non-lieu prononcé lui-même plusieurs années après les faits) [5]. La « réponse rapide, ferme et énergique » n’est manifestement pas pour tout le monde : pas de « temps réel » ni de « comparution immédiate » pour les policiers meurtriers.
Quant aux jugements, ils ont rarement la rigueur qui est réservée aux voleurs ou aux « casseurs » : la jurisprudence fluctue, au gré du "climat politique" et de la personnalité des juges, entre, au mieux, deux ou trois ans de prison avec sursis (comme pour l’assassin du jeune Habib en 1997, ou celui de Riad, à Lille), et au pire un non-lieu (comme pour l’assassin d’Abdelkader Bouziane) ou un acquittement (comme pour Pascal Hiblot, l’assassin de Youssef Khaïf) [6].
Bref : pour les « bavures » mortelles, « il est rare que des peines de prison soient effectivement purgées » – c’est ce que signalent les rapports annuels d’Amnesty International, qui dénoncent régulièrement l’inertie du ministère public et les délais déraisonnables des enquêtes et des poursuites. Un récent rapport de l’association parle d’une « impunité de fait ».
On est même tenté de dire que, comme dans le cas des contrôles au faciès, on risque plus d’être poursuivi lorsqu’on dénonce les bavures ou les crimes policiers que lorsqu’on les commet : par exemple, après le décès de Mohammed Berrichi, mort des suites d’une chute de mobylette sans casque, à l’issue d’une longue course-poursuite, les autorités n’ont engagé aucune enquête sur la responsabilité des policiers (ne serait-ce que dans le choix de s’acharner à poursuivre un motocycliste sans casque), mais elles ont en revanche multiplié les propos injurieux, voire diffamatoires à l’égard des proches de la victime et de l’association Bouge qui bouge, qui avait organisé un comité de soutien à la famille. La justice a même condamné le frère de la victime, Kader Berrichi, à 700 euros d’amende pour « outrage à agent », parce qu’il avait affiché sur sa voiture un tract intitulé :
« La police tue, la justice couvre » [7].
De la même manière, le groupe de rap La Rumeur a été poursuivi pendant près de dix ans pour diffamation par le ministère de l’Intérieur pour un texte mettant en cause les violences policières et l’impunité dont elles bénéficient. Les extraits jugés diffamatoires sont les constats suivants :
– « Les rapports du ministère de l’intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété. »
– « La réalité est que vivre aujourd’hui dans nos quartiers, c’est avoir plus de chances de vivre des situations d’abandon économique, de fragilisation psychologique, d’humiliations policières régulières... »
– « Au travers d’organisations comme SOS Racisme, créé de toutes pièces par le pouvoir PS de l’époque pour contribuer à désamorcer le radicalisme des revendications de la Marche des Beurs, l’égalité des droits devient l’égalité devant l’entrée des boîtes de nuit. La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le slogan "Touche pas à mon pote" » [8]
Que fait la police ?
Amnesty International et le Comité européen pour la prévention la torture dénoncent également les brutalités et les sévices qui ont lieu lors des interpellations ou des gardes à vue dans les commissariats : coups de poing, coups de pied, personnes violemment projetées à terre, menottes trop serrées au moment de l’interpellation... [9] D’après le Comité européen pour la prévention la torture, 5% des personnes examinées après une garde à vue présentent des lésions traumatiques.
La France a d’ailleurs été condamnée pour torture par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ahmed Selmouni, gardé à vue pour trafic de drogue en 1991, avait subi des violences qualifiées par la Cour de " particulièrement graves et cruelles " : coups, blessures ayant nécessité une hospitalisation, menaces avec un chalumeau et une seringue, et viol à la matraque (attesté par le diagnostic médical).
La France est en fait condamnée pour ne pas avoir assuré au plaignant le « droit à un procès dans un délai raisonnable », imposé par la Convention européenne des droits de l’homme : les policiers incriminés n’ont été déférés devant le tribunal correctionnel de Versailles que cinq ans et demi après le dépôt de la plainte.
La suite de l’affaire est tout aussi honteuse : le 25 mars 1999, le tribunal correctionnel de Versailles condamne enfin les policiers mis en cause, à des peines de deux à quatre ans de prison ferme. Une manifestation de protestation est alors organisée par des policiers, dont Jean-Pierre Chevènement déclare « comprendre l’inquiétude ». La Cour d’Appel de Versailles est saisie et réduit finalement la peine du coupable à 18 mois de prison dont 15 avec sursis ! [10] Bilan : trois mois fermes pour un viol, avec en prime la « compréhension » du ministre. Qui parle de laxisme, d’impunité et de culture de l’excuse ?
Il faut se rendre à l’évidence : loin d’œuvrer à l’émergence de cette police mieux formée, encadrée et contrôlée, le gouvernement de gauche plurielle n’a fait que prendre la relève de Charles Pasqua, en couvrant les pires exactions : le lendemain de l’assassinat d’Abdelkader Bouziane à Dammarie-les-Lys, le ministre de l’intérieur Jean-Pierre Chevènement s’empressait par exemple de déclarer qu’il s’agissait de légitime défense, au lieu d’attendre l’expertise balistique, qui réfutait cette version : Abdelkader Bouziane a été tué d’une balle dans la nuque [11].

Dernière partie : « La prison, ou le non-droit au coeur du droit »