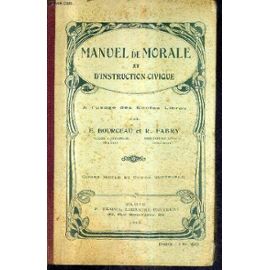
En effet, le président de la République l’a affirmé très clairement le 21 octobre dans la cour de la Sorbonne, lors de l’hommage à ce professeur assassiné : « Faire des républicains, c’était le combat de Samuel Paty. Et c’est cette tâche, aujourd’hui, qui peut paraître titanesque, notamment là où la violence, l’intimidation, parfois la résignation, prennent le dessus. Elle est plus essentielle, plus actuelle que jamais. Ici, en France, nous aimons notre nation, sa géographie, ses paysages et son histoire. (…) Alors oui, dans chaque école, chaque collège, dans chaque lycée, nous redonnerons aux professeurs le pouvoir de faire des républicains ».
C’est ce discours sur le sens de l’école que l’on se propose d’interroger, du point de vue de l’histoire des politiques éducatives, et en assumant les controverses que peut provoquer la prise de position proposée ici, née d’un enseignement universitaire et de divers engagements militants.
Le système éducatif en 2020 va très mal, ses personnels témoignent depuis des décennies des difficultés graves qu’ils rencontrent dans leur quotidien, en particulier en collèges et lycées.
Retracer rapidement les grandes évolutions de notre système éducatif depuis Jules Ferry, en prenant comme fil rouge l’éducation civique, peut contribuer à mieux comprendre pourquoi cette explosion de violence a eu lieu dans le cadre scolaire.
Rappelons que le système éducatif français s’est constitué historiquement pendant la IIIe République, par les lois Ferry de 1882, sous la forme d’un système « paisible et injuste » selon l’expression du sociologue de l’éducation François Dubet.
Injuste car constitué d’une part de l’école primaire , gratuite, laïque et obligatoire, l’« École du peuple » ; et d’autre part du système secondaire , collèges et lycées intégrant les petites classes de 8e, 7e etc. payant, et de ce fait réservé aux familles les plus aisées. Le primaire offrait la possibilité d’obtenir le certificat d’études et d’entrer rapidement dans la vie active, mais aussi d’aller au-delà et de devenir à son tour instituteur, fonctionnaire, de bénéficier d’une ascension sociale et professionnelle. Le secondaire aboutissait au baccalauréat, obtenu pendant longtemps par moins de 5% d’une classe d’âge, sur la base de l’aisance financière et du milieu familial. Les passages entre les deux systèmes, primaire et secondaire, étaient rendus impossibles en particulier par le type d’enseignement reçu : orienté vers la vie pratique pour le primaire, élitiste et préparant aux hautes fonctions pour le secondaire.
Système injuste mais aussi paisible : le fait que l’organisation de l’école reproduise dès le départ les inégalités sociales était largement accepté et atténué par la possibilité de progresser socialement au sein de l’école du peuple. Paisible aussi car l’ordre du primaire instaurée par Jules Ferry ne faisait pas mystère de ses missions. Il s’agissait d’abord de soustraire les enfants à l’influence de l’Église catholique, de faire aimer la République, et ainsi d’asseoir la stabilité sociale sur l’assimilation, par les enfants du peuple, d’une sorte de catéchisme républicain. Et elle n’y allait pas par quatre chemins : manuels d’instruction morale et civique, leçon de morale chaque matin avec inscription d’un précepte morale sur le tableau noir, et même « bataillons républicains » pour faire naître par la pratique les vertus patriotiques dans le cœur des élèves.
Les élèves de l’enseignement secondaire, enfants de l’élite bourgeoise, n’étaient quant à eux pas soumis à cette éducation civique et morale de l’école de la IIIe République... Au programme des collèges et lycées, on trouvait les Lettres Antiques, la philosophie, les principes élémentaires des sciences destinés à être approfondies de classe en classe, jusqu’au baccalauréat. Les valeurs morales, l’éducation au sens large, restaient le pré-carré de la famille, et des autorités religieuses étaient bien volontiers invitées à s’y promener.
Ce système socialement conservateur a dû être profondément réformé au début des Trente Glorieuses. En effet, il ne permettait pas aux meilleurs éléments du primaire d’en sortir pour rejoindre la filière secondaire, accéder ainsi aux formations d’excellence, et à terme aux fonctions et missions d’avenir. On a pu longtemps s’accommoder de l’injustice du système... Mais il était en revanche inenvisageable, dans le contexte naissant de compétition internationale de l’après IIe Guerre mondiale, de se passer des éléments les plus prometteurs et les plus doués pour gagner la guerre de l’innovation technologique, industrielle, militaire et commerciale.
Ces considérations d’intérêt national ont conduit le Président de Gaulle, et ses successeurs à unifier progressivement l’ensemble du système éducatif. Ainsi naquit, en 1975, le « collège unique », voulu par Valéry Giscard d’Estaing. Cette unification a été décidée en faisant un choix décisif : celui de conserver le modèle d’enseignement élitiste du secondaire. Démocratiser, massifier le système éducatif en conservant un modèle d’enseignement réservé à une élite : l’équation s’annonçait compliquée. Et les problèmes se sont succédés, accumulés.
Le « collège unique » affichait des ambitions légitimes. Sa création était devenue nécessaire dans le cadre d’une démocratie moderne, visant l’égalité des chances des futurs citoyens et la mixité sociale. Et il y a en partie réussi.... Mais de la même manière que les inégalités sociales, économiques, territoriales n’ont cessé de s’aggraver depuis le milieu des années 70, des disparités importantes entre établissements du secondaire sont apparues et se sont enkystées. Au point d’engendrer des phénomènes de ségrégation, avec des établissements concentrant les difficultés scolaires, sociales.
Ségrégation renforcée par la concentration d’élèves issus de l’immigration, victimes des mêmes processus de ségrégations en particulier territoriales à l’œuvre en France, notamment dans les banlieues. Les phénomènes d’incivilités et de violences scolaires ont fini par se généraliser, se banaliser dans des établissements ghettos, et les maigres efforts des pouvoirs publics dans les zones d’éducation prioritaire se sont avérés être très insuffisants, malgré de vraies réussites obtenues par des professeurs et des personnels de direction souvent héroïques.
Au-delà de ces maigres moyens supplémentaires, les décideurs politiques et les têtes-pensantes de l’Éducation nationale ont cherché et trouvé des recettes plus ou mois nouvelles, et surtout peu coûteuses, pour répondre à cette crise de l’enseignement secondaire. C’est ainsi qu’au milieu des années 90, on a assisté à un retour en force de l’ « éducation civique » (quasiment abandonnée depuis 1968) souvent rebaptisée et repeinte en « éducation à la citoyenneté » dans les instructions officielles de l’Éducation nationale.
Il fallait civiliser les « sauvageons », qui osaient faire preuve de mauvaise humeur au prétexte que la « République » brisait toutes leurs perspectives d’avenir dès l’entrée dans le secondaire. La IIIe République avait bien su mater les populations insolentes dans ses colonies... Resservir la morale de Jules Ferry pour imposer l’ « ordre républicain » à une nouvelle espèce d’opprimés, cela montre finalement une certaine cohérence chez ses promoteurs d’hier et d’aujourd’hui.
Et les professeurs, dans tout cela ? Nouveaux hussards de la Ve République, ils semblent ne pas avoir été préparés à ce rude combat. Ils estiment en particulier être peu voire pas formés à aborder avec les élèves des notions politiques, sociales, sociétales déjà controversées dans l’ensemble de la société (par exemple le droit au mariage pour les couples de même sexe), voire qui la déchirent, comme la laïcité. Ils sont chargés d’aborder avec des adolescents, et dans la sérénité d’une salle de classe, des enjeux qui feraient aujourd’hui exploser n’importe quel repas de famille.
Pire : au sein même d’un système éducatif dont ils mesurent chaque jour un peu plus le caractère inégalitaire, on leur demande d’assumer devant les élèves le gouffre entre les valeurs républicaines d’égalité, de fraternité, de solidarité, de respect, de vivre-ensemble, de la supériorité de la loi sur le droit du plus fort, et la réalité des inégalités, des discriminations, des exclusions, des violences sociales. Et le tout dans un contexte social marqué par l’émergence de phénomènes nouveaux ou résurgents, comme l’essor des réseaux sociaux, les chaînes d’information en continu et la banalisation des opinions d’extrême-droite, ou le retour en force du phénomène religieux en France et dans le monde.
Ces réalités d’une société française toujours plus inégalitaire et morcelée, les professeurs et les élèves les connaissent, et une bonne partie d’entre eux les vivent au quotidien dans un pays qui compte 8 millions de pauvres, dont 2 millions d’enfants. Chômeurs exclus du monde du travail ; habitants des cités exclus des centres-villes, exclus géographiquement et financièrement des équipements culturels, sportifs, des moyens de transport ; familles défavorisées exclues des vacances, des loisirs, de la pratique sportive, artistique ; jeunes confrontés au racisme, aux contrôles au faciès, aux discriminations d’ordre social, culturel, professionnel ; et même quelquefois impossibilité de pratiquer dignement un culte... droit pourtant garanti par la Constitution de la Ve République.
Toutes ces contradictions de notre État de droit républicain, les professeurs doivent en porter le poids devant les élèves au quotidien, en tant qu’ « agents de l’État », dans une société et un monde politique en pleine crise... Bref, ils doivent donner une « leçon de morale » qui sonne creux, qui sonne faux. Qui en 2020 n’est en mesure ni de réguler les rapports au sein de l’établissement scolaire, ni de permettre à la future citoyenne et le futur citoyen de se construire. Car comme l’écrit le philosophe Éric Blondel, « C’est le bon fonctionnement des institutions, la mise en œuvre de la justice et de l’égalité qui font les bons citoyens et qui ’’enseignent’’ la morale civique en la rendant superflue comme leçon de morale ».
Bien entendu, il faut rendre hommage à tous les professeurs qui ont œuvré et œuvrent chaque jour, et dans des conditions dégradées, à l’émancipation des élèves dont ils ont la charge, que ce soit par l’instruction de leur discipline, par leur exemplarité (souvent citée par leurs anciens élèves), par leurs capacités à rappeler la supériorité de la règle sur l’arbitraire, de la connaissance sur l’opinion.
Il faut reconnaître, entre autres dispositifs, l’intérêt pédagogique des heures d’Éducation civique, juridique et sociale (ECJS), l’importance des apprentissages, par la pratique, des règles du débat argumenté et contradictoire, quand les conditions d’enseignement (matérielles ou relationnelles) les rendent possibles.
Mais attendre des professeurs et de l’ensemble des personnels d’éducation qu’ils règlent les maux de la société est irresponsable. Prétendre que l’« éducation morale et civique » peut permettre le rétablissement de l’ordre républicain, notamment au point de discrédit où l’ont conduit les présidents et gouvernements qui se sont succédés ces dernières décennies, est une erreur . Leurs politiques néolibérales ont provoqué trop des ravages dans notre société, gangrenée par les inégalités, les exclusions, les replis, l’obscurantisme.
Ce n’était pas à Samuel Paty d’en payer le prix. En sa mémoire, soyons vigilants et exigeants sur le rôle « politique » que d’aucuns souhaiteraient aujourd’hui et demain faire jouer à l’école, rôle qui doit être redéfini à la lumière de l’histoire du système éducatif, et en prenant vraiment en compte la parole et les besoins exprimés par les professeurs.


