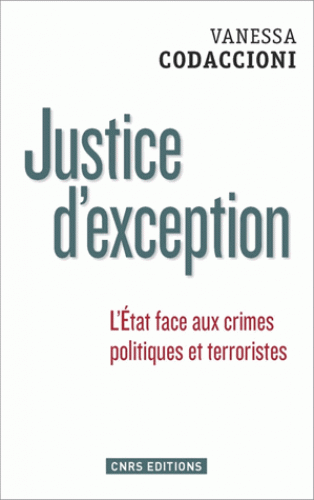
Il en va ainsi de la liberté de circulation, du droit au respect de la vie privée, de ceux de se réunir, de manifester ou de s’associer, mais aussi du droit à la liberté. Le communiqué du Conseil de l’Europe, informant que les autorités françaises n’allaient pas respecter certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, ne doit pas surprendre outre mesure.
Prévu par les textes, cette déclaration gouvernementale vise à éviter les procès. Elle confirme ainsi que les états d’exception conduisent toujours à de multiples atteintes aux libertés publiques et aux garanties fondamentales et, surtout, que leurs dérives sont juridiquement anticipées et, dans des circonstances exceptionnelles, tolérées.
Ces dérives sont d’ailleurs en constantes évolutions. L’état d’urgence est en effet vieux de plus de soixante ans, et demeure un héritage colonial de la gestion guerrière des revendications d’indépendance en Algérie. Mais, tout en s’inscrivant dans la continuité de ses usages passés, son application actuelle se situe au croisement de deux logiques répressives qui en aggrave les effets : la logique préventive de l’antiterrorisme, qui, pour prévenir les attentats, conduit à criminaliser les possibilités de passage à l’acte, avec tout ce que cela peut impliquer en termes de menaces pour les libertés individuelles et collectives ; et la radicalisation du maintien de l’ordre, notamment dans le cas des rencontres internationales.
Depuis les années 2000 au moins, le dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de ces sommets multiplie les atteintes aux droit fondamentaux : fermetures des frontières, expulsions de manifestants en situation régulière, fichages en dehors de tout cadre légal etc. L’état d’urgence rajoute à cette palette de techniques disponibles les perquisitions de jour et de nuit et, surtout, les assignations à résidence qui, alliées à l’interdiction de manifester, annihile toute contestation politique.
Les pratiques administratives et policières permises par l’état d’urgence sont ainsi le miroir grossissant d’un phénomène inquiétant : l’assimilation progressive de l’activisme de gauche (anarchiste, libertaire, autonome, écologiste etc.) au terrorisme. Une assimilation là encore historique et traditionnelle, mais qui permet aujourd’hui d’appliquer à des militants une répression plus dure et radicale officiellement destinée à prévenir des attentats.
Aussi, au-delà d’éclairer la manière dont s’opère toujours un élargissement du champ d’application des mesures d’exception, celles-ci visant des cibles de plus en plus élargies, les récentes perquisitions et assignations à résidence d’individus sans aucun lien avec les événements du 13 novembre montrent comment l’état d’urgence insécurise, divise et discrimine. Forme de justice d’exception, il sépare et distingue deux catégories de la population : celle qu’il faut protéger et au nom de laquelle des dispositions sécuritaires sont déployées, et celle qui subit les dispositions d’exception et dont les membres sont placés en état d’infériorité juridique et discriminés.
Le véritable clivage ne se situe donc pas aujourd’hui entre les personnes favorables au recours à l’exception et celles qui ne le sont pas, mais entre celles qui n’en subiront jamais les effets et celles qui sont placées, selon l’expression de Michel Foucault, dans un état de « moindre droit ».


