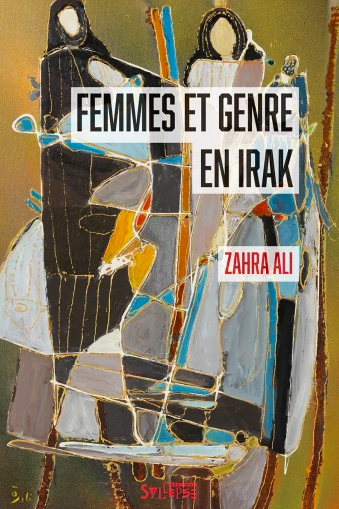
Les nombreuses questions sociologiques de cette recherche sur les femmes, le genre et le féminisme en Irak ont trouvé des réponses à travers mon expérience quotidienne dans le pays après l’invasion américaine. Pour une journée de travail de terrain à Bagdad, il fallait passer une douzaine de checkpoints au moins, alors que notre voiture, conduite par Amu Abu Manal [1], se dirigeait de la maison familiale à al-Kaza- miyya vers le centre-ville. Ces checkpoints se situaient entre les différents quartiers de la capitale que nous traversions ; certains étaient plus impressionnants que d’autres. Entouré de murs en béton, un poste de contrôle pouvait signifier stationner dans un genre de corridor où la voiture était garée, le moteur éteint. Un soldat faisait alors passer un miroir sous les roues, un autre marchait autour du véhicule muni d’un détecteur d’explosifs. Il fallait parfois sortir de la voiture ; le coffre était alors inspecté. Dans ces cas-là, Amu Abu Manal était fouillé de la tête aux pieds par les soldats, debout devant son véhicule. J’étais pour ma part conduite derrière une fenêtre, où mon sac était inspecté et où des gardiennes de la sécurité passaient les mains sur mon corps en tapotant à certains endroits.
De tels points de contrôle étaient rares ; ils se trouvaient principalement dans des quartiers comme al-Kazimiyya, où les visiteurs affluent pour voir le sanctuaire d’al-Kazimayn ou entre les zones sunnites et chiites. À la plupart des autres checkpoints, Amu Abu Manal n’était pas obligé d’éteindre le moteur et de garer la voiture ; il baissait simplement la vitre pour saluer les soldats qui le saluaient en retour, puis l’un d’eux faisait circuler un détecteur d’explosifs le long de la voiture tandis qu’elle passait entre les murs en béton. Traverser les postes de contrôle pouvait s’avérer plus ou moins difficile et long, selon le climat sécuritaire dans le pays. Si durant la semaine, l’explosion d’une voiture, l’assassinat d’un chef politique ou tout autre événement sécuritaire avait eu lieu, la circulation se trouvait ralentie à Bagdad, du fait de l’augmentation des postes d’inspection. Il fallait alors quitter la maison plus tôt, et si une explosion se produisait dans une région proche de Bagdad pendant que nous étions en voiture, il fallait attendre des heures avant que les soldats nous autorisent à passer, surtout si nous tentions de traverser les quartiers de confessions différentes.
Chaque jour portait son lot d’incertitudes, de surprises, de frustrations, souvent de tensions. Bagdad est semée de checkpoints et de murs de béton qui divisent les quartiers suivant l’appartenance ethnique, religieuse ou confessionnelle. Aujourd’hui, les murs de béton et les checkpoints sont moins fréquents qu’ils ne l’étaient durant la période ou j’ai effectué la plupart du travail de terrain au cœur de ce livre (2010-2014). J’ai observé l’évolution de ces barricades de bétons et de fer qui structurent l’espace urbain en Irak dans mes travaux de terrain plus récents (2016-2019). De telles barrières subsistent néanmoins autour des bâtiments gouvernementaux et de la Zone verte, où se trouvent un certain nombre d’institutions importantes dans le pays (le Parlement, le Conseil des ministres, etc.), mais aussi l’ambassade des États-Unis, les Nations unies et d’autres organisations internationales. Bien que les murs soient fréquemment couverts de peintures du drapeau irakien ou de scènes mettant en avant l’unité du pays, ainsi que divers symboles de l’Irak ancien et moderne [2], ces œuvres d’art n’affectent en rien l’atmosphère de dégradation et d’appauvrissement. En route vers le centre de Bagdad, entre les immeubles marqués par les traces de balles et d’explosions, les câbles électriques pendus un peu partout et la saleté, je suis témoin de scènes déchirantes de femmes qui mendient. Portant souvent un bébé dans les bras, elles sont assises dans la poussière vêtues d’une abaya [3] noire ou debout en train de vendre des petits paquets de mouchoirs aux conducteurs des voitures. À côté d’elles, des enfants au visage brûlé par le soleil vendent toutes sortes de biscuits, sucreries, petites bouteilles d’eau. Le soir, les mendiantes s’approchent des familles assises aux terrasses des restaurants, chez les glaciers ou à l’intérieur des boutiques de cocktail pour vendre des petits paquets de chewing-gum. Se présentant toujours comme des veuves, elles implorent de l’aide pour nourrir leurs enfants. Elles sont les seules à traîner dans les rues ; la plupart des autres ne font que passer, entrer ou sortir d’un magasin ou sont assises dans les espaces réservés aux familles. Le reste des espaces extérieurs de la capitale est occupé par les hommes ; et les soldats armés ou les agents de police sont postés à chaque coin de rue.
Alors que nous approchions du centre de Bagdad, Amu Abu Manal m’a dit : « Amu Zahra, al-Rashid n’est pas un endroit sûr pour marcher, surtout pour une jeune femme comme toi. C’est plein de muhache- chin et de personnes errantes. Laisse-moi te conduire directement rue al-Mutannabi. » J’ai répondu : « J’aimerais me promener là, à Bab al- Muazem, al-Midan, dans le vieux Bagdad, rue al-Rashid et al-Nahar avant d’aller à al-Mutannabi. » Amu Abu Manal avait raison : ce n’est pas agréable de marcher dans ce quartier par les temps qui courent, mais j’étais tout de même contente d’y aller en raison du lien avec ma famille, car ma mère travaillait autrefois rue al-Rashid comme comp- table pour une société commerciale. C’est là qu’elle a rencontré mon père, et, dans les années 1970, elle allait rue al-Nahar pour acheter des vêtements à la mode ou passer du temps avec ses amis. Aujourd’hui, ces rues ont été converties en dépôts et commerces de gros pour toutes sortes de produits. Cette partie de Bagdad était autrefois le cœur culturel et social de la ville ; lorsque mes parents se sont rencontrés pour la première fois au milieu de la vingtaine, le quartier était rempli de théâtres, de cinémas, de boutiques, de cafés, de restaurants et d’endroits où les jeunes Bagdadis allaient se détendre, socialiser ou flâner. De nos jours, les balcons et les colonnades jadis magnifiquement blancs et fleuris sont couverts de saleté. Les théâtres, cinémas et cafés ont disparu. La zone est devenue un terrain pour les pauvres gens qui rôdent, et a la réputation d’accueillir toutes sortes de trafics illégaux. Malgré les regards et le harcèlement des hommes en haillons traînant sans but, j’allais souvent me promener là-bas, seule ou accompagnée, avant de me diriger vers al-Mutannabi.
À Bagdad, je me rendais au quartier al-Mutannabi presque une fois par semaine. Le vendredi est le jour où la rue, spécialisée dans les livres et la papeterie, dévoile ses merveilleux trésors : les libraires étalent leur marchandise le long des trottoirs, et les intellectuels ou étudiants de tous bords, poètes, musiciens, écrivains, peintres, activistes politiques, idéalistes jeunes ou âgés déambulent. Un événement culturel a généralement lieu à la librairie Dar al-Mada ou au centre culturel récemment rénové au bout de la rue. Les gens s’installent ensuite au salon de thé al- Shabendar pour parler de choses et d’autres, devant un thé noir ou un thé au citron. Al-Mutannabi est la seule rue du centre de Bagdad à avoir été rénovée. Elle a été quasiment détruite en 2007, après la dramatique explosion à la bombe d’une voiture ayant fait 30 morts et une centaine de blessés. Tous les vendredis après-midi, j’avais l’impression d’être sur une île, loin de la réalité de la ville. Dans le petit jardin au bout de la rue, vers le beffroi al-Qishla [4] sur les bords du Tigre, un groupe de jeunes musiciens était assis là, sous un kiosque en bois. Certains chantaient des vieilles chansons irakiennes et jouaient des maqams au oud [5], d’autres improvisaient des vers de poésie. On pouvait rencontrer des intellectuels, des artistes connus, des activistes, des hommes politiques libéraux ou de gauche.
Il n’y a pas beaucoup de femmes, de quelque génération que ce soit, qui se promènent dans ce quartier par les temps qui courent. Ce sont pour la plupart des hommes, universitaires ou hautement diplômés, d’âge moyen ou avancé. À part les militantes et les intellectuelles avec qui j’avais spécifiquement rendez-vous, les femmes rencontrées étaient en général des mères venues là pour acheter des livres d’école à leurs enfants.
Hormis quelques îlots comme al-Mutannabi et les campus universitaires, la plupart des espaces publics extérieurs à Bagdad sont dominés par les hommes, en grande partie des soldats ou des agents de police jeunes ou d’âge mûr. Les misérables veuves mendiant dans leurs abayas noires, sales et abîmées sont les principales silhouettes dans les rues. Même la splendide promenade Abu Nawas, bordée de jardins et d’arbres en fleurs sur les bords du Tigre, n’est plus un lieu pour les amoureux. Les restaurants, où mes grands-parents maternels amenaient leurs enfants manger le fameux samach mesguf, « poisson fumé », sur les rives du Tigre, sont aujourd’hui à l’abandon. Le Centre culturel français, où j’allais parfois travailler, se situe également à Abu Nuwas. J’étais souvent l’unique femme à marcher seule là-bas, et il m’a fallu à maintes reprises faire face au harcèlement des soldats postés aux checkpoints ou des hommes qui rôdaient. Plus tard, j’ai entendu dire par des proches que ce quartier était devenu un repère pour la prostitution.
À ce moment-là, j’ai compris pourquoi on me sommait constamment d’éviter cette zone sans jamais dire la raison. Lorsque je demandais aux cousines de mon âge de me raconter leurs expériences de promenade dans le centre-ville, elles assuraient que ce n’était vraiment pas un endroit pour marcher, surtout pas pour les femmes. Quelques semaines après m’être installée à Bagdad, j’ai compris que « sortir » avec mes cousines et mes proches signifiait aller dans les « lieux réservés aux familles » : restaurants, zones de commerces et maisons. Mes cousins quittaient généralement les réunions de famille après un certain temps, pour prolonger la soirée ensemble dans un café ou un lieu à shisha. Beaucoup de cafés de la capitale sont ouverts exclusivement aux hommes après 19 heures, et la plupart des restaurants sont séparés en deux espaces : un réservé aux shabab, les « jeunes hommes », l’autre aux awaeel, « familles », où s’installent les femmes.
La militarisation de l’espace public à Bagdad rend difficile de prendre des photos dans les rues. Je recevais des avertissements des soldats lorsque je tentais l’expérience. Il était interdit de prendre des photos, surtout dans les quartiers connectés à la Zone verte – dont une partie est visible d’Abu Nuwas et du centre-ville – de même que des bâtiments officiels, des bureaux de partis politiques et des checkpoints. Pour échapper à ces mises en garde, j’ai acheté un petit appareil photo rose qui ressemblait à un téléphone de fillette. Je voulais ainsi brouiller l’esprit des soldats et des policiers postés à chaque coin de rue, pensant qu’ils n’interdiraient pas à une jeune fille de prendre des photos au hasard. La plupart du temps, ma performance d’innocence et de naïveté réussissait à les convaincre que je prenais des photos innocentes. Être une jeune femme maîtrisant les codes vestimentaires et comportementaux de genre de la classe moyenne urbaine m’a réellement aidée à accéder à de nombreux endroits sans être systématiquement arrêtée ou traquée. Un homme à ma place, en train d’observer et de prendre des photos seul dans la ville aurait suscité la méfiance, car la plus grande partie des enlèvements, assassinats et explosions sont commis par des individus de sexe masculin. En tenue décontractée, j’étais considérée comme inoffensive pendant que j’observais et prenais des photos. J’éveillais plutôt des sourires que de la méfiance chez les officiers. J’étais la plupart du temps tellement exténuée par mes tentatives de me déplacer dans la ville que je ne trouvais plus l’énergie de jouer à la photographe un peu idiote. Je prenais donc la majorité des photos à l’intérieur des bureaux ou assise avec d’autres gens au café, afin de ne pas attirer l’attention des services de sécurité.
Ces brèves observations ethnographiques m’amène à poser cette question de départ : comment un des pays les plus avancés de la région aux niveaux de l’éducation, de la santé, de l’emploi et des droits juridiques des femmes jusque dans les années 1990, a-t-il pu devenir ce territoire militarisé, contrôlé par des hommes armés, fragmenté, si difficilement vivable pour ses habitant·es et encore plus pour les femmes ?
Cet ouvrage traite des femmes, du genre et du féminisme en Irak. Mon étude sociologique approfondie mêle ethnographie et histoire sociale, politique et orale. Je souhaite ainsi offrir une meilleure compréhension des expériences sociales, économiques et politiques des femmes irakiennes, permettant d’analyser le contenu, les réalités et la portée politique de leur activisme sous toutes ses formes et de leur féminisme. Je défends ici que les femmes, les questions de genre et les luttes féministes en Irak doivent être analysées au moyen d’un prisme complexe, relationnel et historique, sans avoir recours à l’argument d’une « culture » ou d’un « islam » indifférencié afin d’expliquer des réalités sociales, économiques et politiques. Considérer les histoires sociales de l’Irak en partant – au moins – de la formation de l’État postcolonial me semble essentiel, mais aussi éviter l’approche structurée par la « rupture post-2003 » ou encore le prisme réducteur d’une violence millénaire indifférenciée. Cet ouvrage traite autant des femmes, du genre et du féminisme en Irak qu’il est un ouvrage féministe sur l’Irak. Il tend à contribuer à des débats féministes critiques et proposer une analyse féministe de l’histoire sociopolitique contemporaine de l’Irak.


