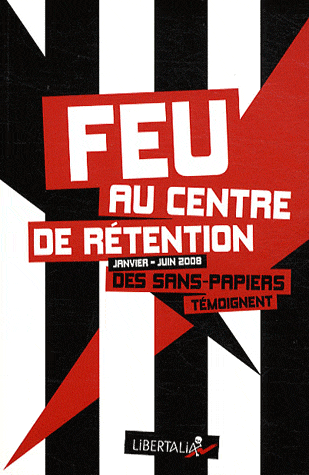
Nous les avons appelés quotidiennement. Ils nous ont raconté leurs luttes et la répression subie chaque jour. Nous les avons renseignés sur les manifestations et les rassemblements à venir. Ils nous ont dicté leurs tracts et leurs revendications. Nous les avons mis en contact avec des journalistes. Nous leur avons lu les articles parus dans la presse. Nous avons échangé sur les manières d’échapper à une expulsion.
Durant les moments de calme relatif, ils nous ont parlé du quotidien du centre, de son organisation, des conditions d’enfermement, du comportement de la police, etc. Pendant plusieurs mois, une dizaine d’entre nous s’est relayée pour téléphoner à une quarantaine de retenus. Au départ, les témoignages étaient uniquement publiés sur des listes et des sites militants. Mais très vite, ils ont été repris par de nombreux journaux.
Par ces appels, nous n’avons pas seulement voulu dénoncer les conditions d’enfermement ni accompagner les retenus dans leurs démarches individuelles. Nous avons soutenu le mouvement de résistance collectif qui se développait alors. Il faut relayer les actions et les revendications, faire connaître une lutte quand elle commence, témoigner lors d’une répression, donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais. Téléphoner dans les centres de rétention s’inscrit pour nous dans d’autres pratiques de luttes : s’opposer aux rafles, visiter les retenus, être présents lors des convocations devant les tribunaux, intervenir dans les aéroports, etc. Ces actions reposent sur la volonté commune de s’organiser et d’agir directement à chaque étape du processus d’expulsion.
Nous refusons l’idée que seuls les experts, les associations, les médecins, la police ou les médias auraient une parole légitime. Notre point de vue, au contraire, est de comprendre la réalité des centres de rétention à partir de la parole et des luttes de ceux qui y sont enfermés. Ces témoignages, issus de longues conversations, traduisent le regard des retenus sur ce qu’ils vivent et ressentent alors qu’ils sont pris dans les rouages de la machine à expulser.
Mi-décembre 2007
Une lutte débute dans le centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, près de Roissy : inscriptions sur les T-shirts, cahiers de doléances, refus de rentrer dans les chambres, grève de la faim.
Le 27 décembre, pour casser la lutte, un retenu considéré par la police comme un des meneurs du mouvement est transféré au CRA de Vincennes. Le même jour, les détenus de Vincennes entament à leur tour une grève de la faim et refusent de rentrer dans leurs chambres.
Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 décembre, 150 CRS font irruption dans le centre pour forcer manu militari les détenus à rejoindre leurs chambres. La répression est sans précédent. Certains sont grièvement blessés. Trois nuits de suite, les CRS interviendront pour mater la révolte. Lundi 31 décembre, peu avant minuit, un feu d’artifice est tiré devant le centre de rétention. Quatre personnes sont arrêtées.
Jeudi 3 janvier 2008, une manifestation rassemble 200 personnes devant le centre de rétention de Vincennes. La mobilisation prend de l’ampleur. Chaque jour, des rassemblements ont lieu. Les médias parlent quotidiennement de la lutte des grévistes de Vincennes et du Mesnil-Amelot.
Le vendredi 4 janvier, la préfecture organise une visite guidée pour les journalistes afin de prouver que rien ne se passe à l’intérieur et que les conditions de détention n’y sont pas inhumaines.
Le samedi 5 janvier, une manifestation rassemble un millier de personnes devant le CRA de Vincennes : parloir sauvage, chants et échanges de slogans avec les détenus, feu d’artifice depuis le parking. Les flics chargent et matraquent, une personne est arrêtée, elle sera relâchée le lendemain. Nous décidons d’appeler quotidiennement les détenus de Vincennes pour rendre compte de la situation à l’intérieur.
Dimanche 13 janvier
« Tous les matins, on nous fouille. On descend au réfectoire vers 9 heures. Souvent, le café est froid. Lorsqu’on le signale, les policiers répondent qu’ils sont uniquement là pour nous surveiller. Ce midi, on nous a servi des haricots blancs périmés depuis le 5 janvier. Quand on l’a signalé, ils ont à nouveau répondu qu’ils ne voulaient rien savoir. Nous sommes partis voir la Cimade avec les barquettes périmées pour leur demander de témoigner. Quand on se repose, les policiers viennent fouiller les chambres. La nuit, ils sont dans le couloir. Si on doit aller aux toilettes, ils nous suivent et laissent la porte ouverte. Pour déranger notre sommeil, ils mettent l’alarme entre minuit et 1 heure. Il ne faut pas qu’on lâche. Il faut que l’on soit tous d’accord pour relancer la lutte. »
Jeudi 24 janvier
« Aujourd’hui, nous avons refusé de manger. Nous avons jeté la nourriture par terre dans le réfectoire. La police filme ceux qui se révoltent. Elle les sépare et les place dans l’autre bâtiment. Ils sont venus chercher deux personnes. Parmi eux, il y a un Tunisien qui n’a pas mangé depuis plus de dix jours. Il a perdu neuf kilos. Ils ont expulsé un Algérien.
Demain, ils expulseront des Chinois. Le soir, ils inscrivent sur un tableau le nom, la destination, l’horaire de départ et l’aéroport de ceux qu’ils expulseront le lendemain. Il arrive que des gens soient expulsés sans que leur nom soit inscrit sur le tableau. C’est souvent le cas pour ceux qui foutent le bordel. Le matin, les flics viennent les chercher et les emmènent à l’aéroport. Hier soir, ils ont fermé les cabines téléphoniques à minuit, juste après l’agitation. Ils ne les ont rouvertes que ce matin. »
Nous parvenons à joindre la personne en grève de la faim qui a été transférée dans l’autre centre.
« Hier, quatre policiers m’ont sauté dessus. Ils ont déchiré ma veste. Ils m’ont dit que je ne serais pas soigné tant que je ne mangerai pas. Ils m’ont changé de bâtiment. Ça fait dix-huit jours que je ne mange pas. J’ai perdu 10 kilos. Je ne mange pas parce que la nourriture n’est pas hallal. De toute façon, je ne veux pas m’alimenter. Je ne bois que de l’eau et du café. Aujourd’hui encore, le médecin a refusé de me donner des médicaments. Je veux sortir du centre. Je veux être libre. La Cimade a refusé de présenter mon recours. Ils ont dit que les vingt-quatre heures étaient passées, alors que c’est faux. »
Mardi 5 février
« Il n’y a toujours pas de chauffage. Le soir, il fait froid dans les chambres. C’est une prison, ça rend les gens dépressifs. Hier soir, les flics ont éteint la télé. Un jeune leur a demandé de la rallumer. La policière lui a répondu : “Va te faire enculer !” Le jeune lui a sauté dessus. Ils se sont battus. Ils l’ont placé en isolement. On a manifesté pendant vingt minutes pour qu’il sorte. Aujourd’hui, il a été libéré. Ils m’ont retiré mon portable parce qu’il a une caméra.
On n’a pas le droit d’avoir des stylos et du papier. Je suis passé hier devant le juge des libertés et de la détention. On était sept. C’était décidé d’avance. On a tous pris quinze jours de plus. Un jeune a été mis en isolement. Il vient d’avoir 18 ans, il est arrivé en France à l’âge de 6 ans. Il a fait toute sa scolarité en France. Il est diplômé. Je me suis bougé pour qu’il sorte. Je l’ai mis en contact avec un journaliste, qui est venu le voir. La Cimade a finalement téléphoné à la préfecture. Il a été libéré. »
« On écrivait une lettre au commandant. Un Égyptien accompagné d’un policier est venu me voir pour me demander s’il pouvait dormir avec des gens parlant la même langue que lui. Le policier était pressé de le ramener dans sa chambre. Je lui ai répondu de nous laisser. Cinq policiers sont venus pour m’emmener. Les retenus s’y sont opposés. Ils sont alors revenus à 20. Les retenus s’y sont encore opposés. Les policiers ont cassé le doigt d’un retenu et ils ont gardé deux personnes. On s’est mobilisés pour qu’ils les libèrent. Ils ont finalement été relâchés.
Tout à l’heure, le commandant m’a reçu dans le couloir. Je lui ai parlé de nos préoccupations. Ils ramènent des jeunes policiers qui nous insultent. Nous avons des problèmes pour accéder aux soins. Des personnes sont expulsées sans être averties. Les gens du guichet ne nous respectent pas. La nourriture est périmée. Les briquets sont interdits. Si nous voulons fumer, il faut demander du feu aux policiers qui prétendent ne pas en avoir. Les policiers se moquent de nous. Ils nous disent qu’ici, on est nourris et logés. Ils nous demandent ce que l’on veut de plus. Ils nous manquent de respect. Parmi les policiers, certains sont racistes. Ils disent qu’ils sont chez eux, pas nous. Ils veulent créer des problèmes entre ethnies. Lorsqu’on refuse de manger, ils nous disent de laisser manger les Chinois, les Congolais… Mais nous sommes tous d’accord pour ne pas manger et personne n’est forcé. Nous, on veut notre liberté. On n’est pas venus en France pour aller en prison. On a dit au commandant qu’aujourd’hui, nous attendions des réponses à notre lettre. »
Le samedi 2 février 2008, à la suite d’une manifestation à Paris appelée par le Réseau éducation sans frontières (RESF) et Unis contre une immigration jetable (Ucij) contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation, plusieurs centaines de personnes se retrouvent sur le parking jouxtant le centre de rétention. Elles font exploser des pétards, des feux d’artifice. On entend les cris des retenus. Ils scandent en chœur « liberté, liberté ».
Dimanche 10 février
« Ce midi, nous avons refusé de manger. La date de péremption de la nourriture était atteinte. Nos proches ne peuvent pas nous apporter à manger. Les policiers disent que c’est interdit. C’est écrit dans le règlement. Nous devons acheter nos cigarettes dans le centre. Il y a aussi un distributeur de café, de sodas et d’autres bricoles à grignoter. On dépense beaucoup d’argent ici. »
Mardi 12 février
En pleine nuit, à 1 heure 30, nous recevons un coup de téléphone d’un retenu.
« Tout a commencé vers 23 heures 30. Nous étions dans la salle télé. La police a éteint la télévision sans explication. On a demandé qu’ils la rallument. Ils n’ont pas voulu. Le ton est monté très vite. Ils ont voulu mettre une personne en isolement. On a empêché la police de la prendre. Ils nous ont demandé de monter dans les chambres pour le comptage, on a refusé. Ils sont alors revenus en nombre. Ils étaient plus de 50. Il y avait des CRS et des policiers. Ils nous ont séparés en deux groupes, puis ils nous ont tabassés dans l’escalier, dans le couloir et dans les chambres. Il y a cinq personnes blessées, dont deux assez gravement. L’un semble avoir le bras cassé, l’autre le nez. Celui qui a le nez cassé a été tabassé dans sa chambre. L’infirmier est venu, il a dit qu’il ne pouvait rien faire et qu’il fallait appeler les pompiers. Ils sont venus. Ils ont emporté cinq ou six personnes. Certains sont à l’hôpital, d’autres sont en isolement, on ne sait pas trop. »
Nouveau coup de fil à 11 heures :
« Entre 3 heures 30 et 4 heures du matin, les flics sont venus. Ils nous ont tous sortis dans la cour. Certains n’ont pas eu le temps de s’habiller. On a attendu une demi-heure dans le froid. Pendant ce temps-là, ils ont fouillé les chambres. Puis ils nous ont fouillés 10 par 10. Quand nous sommes revenus dans les chambres, on a trouvé un Coran déchiré et piétiné, des fils de chargeurs de portables coupés. Des téléphones avaient disparu. »
On apprendra par les retenus puis de source officielle que cette nuit-là, la police a fait usage d’un Taser. Le mardi 12 février, 400 policiers accompagnés de chiens raflent 115 personnes dans le foyer de travailleurs immigrés de la rue des Terres-au-Curé. La majorité d’entre elles sont sans papiers ; 30 sont placées au centre de rétention de Vincennes. Le mercredi 13 février, une manifestation réunit 1 000 personnes en réaction à la rafle. Le soir, un rassemblement a lieu devant le CRA de Vincennes pour protester contre les violences intervenues dans la nuit de lundi à mardi.
Samedi 23 février
« On s’est mobilisés parce qu’un homme était là depuis plus de trente-deux jours et qu’ils ne le libéraient pas. Nous sommes passés dans toutes les chambres pour expliquer la situation. Nous sommes tous descendus à l’accueil. On a tapé sur les tables, on a crié “liberté”. Le chef du centre a demandé pourquoi on faisait cela. On a expliqué le cas. Il a dit qu’il allait téléphoner à la préfecture. Une heure après, il est redescendu et il a dit au gars : “Tu peux aller chercher tes affaires, tu es libre.” »



