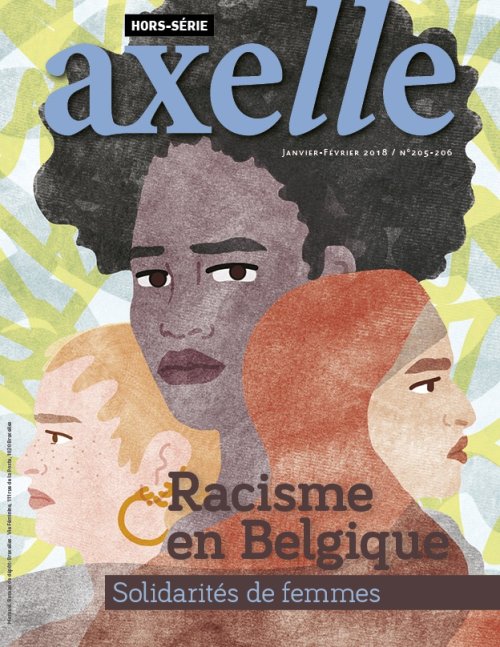« Ilyas, mon fils, était en maternelle. Un jour, son institutrice vient me trouver et me dit qu’il a un "problème avec l’autorité féminine" et qu’il faudrait peut-être voir du côté de la famille d’où ça vient... C’était clairement une allusion aux stigmates qu’on applique aux Arabo-musulmans ».
Ada est maman d’un petit garçon de quatre ans qui, parfois, fait des bêtises, comme un enfant de quatre ans. Mais lorsque son institutrice enfile les lunettes du racisme, ce n’est plus un petit garçon qu’elle voit face à elle, c’est d’abord un « musulman », qu’elle étiquette et dont elle analyse le comportement à travers ses représentations stéréotypées.
Cela ressemble à l’histoire de Noémie :
« Je devais avoir 13 ans, raconte-t-elle. Je jouais au basket avec les filles avec qui j’ai grandi. Il y avait leurs parents. J’ai raté un panier et un papa a crié : "Eh, on n’est pas ici pour lancer des noix de coco !" Cette personne-là, je la voyais tous les jours, elle me connaissait. Qu’est-ce qui lui est passé par la tête pour dire ça ? »
À cet instant, ce papa ne voit pas la petite fille qui joue au basket. Il voit une « Noire », et son regard draine un imaginaire raciste, solidement ancré dans les mentalités.
Cet imaginaire, les enfants y sont confronté·es dès le plus jeune âge. Ce ne sont pas toujours des remarques ou des insultes, mais un conditionnement lié à leur environnement. C’est notamment ce que rapportent des accueillantes d’enfants de la FSMI (Fédération des Services Maternels et Infantiles [1]), qui sont confrontées dans leur travail aux limites que le racisme impose à la société : un parent qui refuse que son enfant soit accueilli·e avec des enfants d’origine étrangère ou, à l’inverse, une mère ravie de voir son enfant accueilli·e dans un groupe de « petits bien blancs ».
Cela se produit dans les milieux d’accueil de la petite enfance, à l’école, avec les professeur·es, dans la cour de récréation, avec des ami·es, avec des inconnu·es, mais aussi parfois dans la famille. C’est ce que Noémie – qui est métisse – raconte également :
« Je sais qu’avant ma naissance, mon grand-père s’est inquiété de savoir s’il parviendrait à aimer ses petits-enfants à moitié noirs et si nous, nous arriverions à l’aimer. Après, c’était le meilleur grand-père du monde. Mais il s’est quand même posé la question. »
Cette question, elle est posée souvent aux personnes qui ont témoigné pour cet article :
« Mais, en vrai, tu viens d’où ? »
« En vrai », comme s’il y avait une vérité à révéler, comme si dire « Je viens de Mons » ne pouvait être qu’un mensonge quand on a la peau brune. Abdelmalek Sayad, sociologue algérien, parle de « double absence » [2] – le fait, pour les immigré·es, de ne jamais se sentir chez elles/eux, ni dans leur pays de naissance, ni dans leur pays d’adoption. Les enfants ont hérité de ce double exil. Aïchatou raconte :
« Petite, quand je subissais du racisme, je me disais : c’est pas grave, de toute façon, ici je ne suis pas chez moi. Un jour, je rentrerai dans mon pays. Ça a été un choc quand j’ai rencontré des étudiants africains. Pour eux, je n’étais pas africaine, j’étais blanche ! Les gens avec qui je vis tous les jours me disent que je ne suis pas comme eux, et les gens auxquels je m’identifie me disent que je ne suis pas comme eux. Donc je suis quoi ? »
Noémie, quand elle était petite fille, avait construit dans sa tête une solution pour combler ces deux absences :
« J’avais imaginé un pays métis où je pouvais aller, sans me sentir différente des autres. »
Un pays où les identités ne sont pas binaires, où l’on n’est pas « blanche » ou « noire », où l’on peut être les deux à la fois, où ol’n peut être soi-même.
Andjou raconte :
« En 4e primaire, nous étions en train de jouer, les garçons contre les filles. Mon amie Nadège et moi, nous parlions stratégie pour savoir de quel côté nous allions courir pour fuir les garçons. Elle a suggéré une certaine trajectoire et m’a expliqué que les garçons la suivraient, parce que tout le monde sait que les Noirs sont moches et puent. Le pire, c’est qu’il n’y avait aucune méchanceté dans son explication, qui semblait être d’une logique implacable. C’était juste la réalité. C’est la première fois que j’ai accepté et intériorisé le fait que, très logiquement, je dois forcément mériter moins. Moins d’attention, moins de tact, moins de rétributions, moins d’amour, moins de chances dans la vie. »
Le racisme tue, le racisme blesse. Il laisse aussi des marques invisibles. Très peu de recherches scientifiques sont disponibles à ce sujet, mais les témoignages que nous avons recueillis sont édifiants sur l’impact psychologique du racisme – celui par exemple d’Aïchatou :
« Bien sûr que le racisme a un impact sur ta santé mentale, sur ton bien-être, sur l’image que tu as de toi, sur ton rapport aux autres, à cause de cette violence que tu subis au quotidien ».
Comment fait-on pour grandir dans ces conditions ? Pour Andjou,
« soit on accepte et on intériorise cette haine et ce mépris envers nous, soit on est constamment en colère. C’est quelque chose de très difficile, et de contraire au développement de soi. C’est comme grandir dans un aquarium trop petit. »
Parmi ces blessures invisibles, il y a aussi celles dont on hérite. Comme des cicatrices secrètes que l’histoire a laissées sur les générations. Comment se développe-t-on quand nos parents ont échappé à la mort, une mort intentionnelle et programmée ? Quel·le adulte devient-on quand on est fille ou fils d’Arménien·nes, de Roms, de Juifs/ves, de Congolais·es, de Burundais·es, de Rwandais·es – survivant·es d’un génocide, déplacé·es, déporté·es, réduit·es en esclavage ? Caroline raconte :
« Mon papa est très pudique. Il ne parle pas du tout de son histoire. Je ne parviens pas à remettre exactement tout bout à bout. Le pourquoi il est ici, le comment… J’ai quelques éléments de réponse. Il a fui son pays et il a attendu quarante-deux ans d’exil avant d’oser y retourner. Comprendre son passé, c’est comprendre certains de ses actes, certaines de ses paroles qui m’ont influencée. Son passé doit détenir certaines réponses aux questions que j’ai. J’ai l’impression que ça m’apporterait des éléments pour savoir qui il est, lui. Et comment ça a marqué nos vies à nous aussi. Mais ça, je ne peux pas le forcer. Un jour, ça sortira peut-être. »
Pour écrire cet article, nous avons lancé un appel à témoignages dans nos réseaux, et nous avons reçu en retour de nombreux récits, et beaucoup d’enthousiasme. Les personnes interrogées rapportaient qu’il existe peu de place pour parler de ces sujets. Et il y aurait encore tellement à dire : sur le rapport aux parents, à l’école, à la police, aux médias… Comment faire confiance à la société quand on a été victime de racisme ? Et comment devient-on maman quand on sait intimement ce que ses futur·es enfants risquent de subir ?
Ouvrir ces espaces de parole et d’échange semble pourtant être un enjeu de taille, d’abord pour les enfants, mais aussi parce que la société aurait beaucoup à apprendre… si elle écoutait. Sarah conclut :
« Je crois qu’on a pris l’habitude de ne jamais être tout à fait à notre place. Et ce n’est pas confortable. Mais ça permet de s’adapter à tout type de situation, d’être ouvert à tout type de personne. Quand tu vis ça, tu apprends à reconnaître les mécanismes de discrimination et de rejet, quelle que soit la minorité visée. Moi, je veux en faire une force pour lutter contre le racisme et contre les injustices, contre qui que ce soit. »