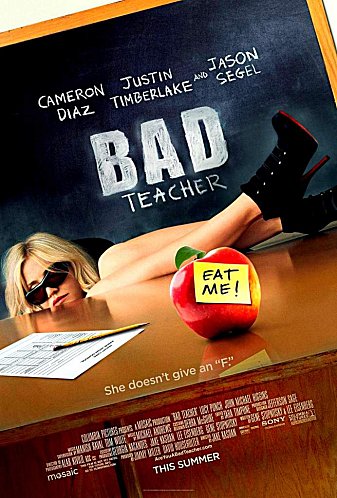Nous étions alors intéressées et nous voulions y croire. Mais, les conclusions réelles de cette étude, publiée et préfacée par Jack Lang, postfacée par Daniel Welzer Lang directeur de thèse de l’auteure, et l’usage qui ne manquera pas d’en être fait, vu la présentation qui en a été faite, nous a vite fait déchanter.
Mise en confiance
L’entrée en matière est plutôt séduisante, on nous parle de « stéréotypes de genre », « de construction sociale des normes de la masculinité », de lutte contre le « sexisme et l’homophobie », des difficultés que peuvent éprouver ceux qui ne correspondent pas aux « injonctions à la virilité ». Les exemples recueillis au cours de l’enquête, les explications « naturalisantes » et « essentialisantes » données par ceux et celles qui sanctionnent, en réduisant les comportants aux « hormones » ; les explications « culturalistes » ou « ethnicisantes » qui les lient à un ethos spécifique propre à une classe ou à des cultures sont effectivement affligeantes.
L’auteure déconstruit la norme dominante de la famille hétérosexuelle qui imprègne les représentations des personnels interrogés et qui veut encore que « l’Autorité soit incarnée par le Père ». Pour justifier les sanctions données, ceux-ci invoquent la nécessité pour l’institution scolaire de pallier à cette absence « d’autorité paternelle ». L’auteure moque ceux et celles qui entretiennent ces explications pseudo-freudiennes, alors qu’il existe des familles « monoparentales » et « homoparentales » et « beau-parentales ». Elle explique et insiste sur le fait que la « transgression » et « les incivilités et bavardages » des jeunes garçons se retrouvent dans tous les établissements, qu’ils soient en centre-ville ou en périphérie, et donc composés de populations variées du point de vue de la classe et de l’ « origine ». Les comportements sanctionnés ne sont pas, insiste l’auteure, l’apanage d’une classe ou d’une culture . Et, l’on est soulagé parce qu’on se dit qu’on va enfin échapper aux discours autour de la figure du « garçon arabe » [2]
On est en confiance parce qu’on a l’impression qu’elle semble être vraiment à contre-courant de clichés rétrogrades, très loin de l’essentialisation de la division sexuée fondée sur le biologique etc... et qu’on va de l’avant, vers du mieux, quoi.
Et puis, on a le sentiment qu’il s’agira pour l’auteure de remettre en question la sanction que les professionnels de l’éducation prennent peu le temps de réfléchir, qui fait parfois marcher les élèves à la peur, à la baguette, crée un climat anxiogène chez les élèves et des pratiques à la limite de la légalité - ce que dénoncent d’autres sociologues [3]. Les profs, eux, se sentant parfois investis (parce que certains les y exhortent) à (re)dresser des « sauvageons » [4] que l’Ecole Républicaine devrait « intégrer », « mater ». Car ce que l’on punit n’est pas détaché de contextes historiques, nationaux, sociétaux, locaux. D’ailleurs, Surveiller et Punir de Michel Foucault est très vite cité comme référence par Sylvie Ayral.
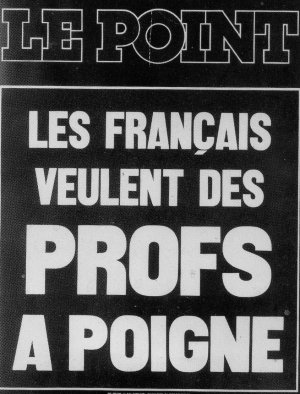
Alors, on espère qu’on va revenir à des réflexions pédagogiques bienveillantes, où l’on réfléchira les pratiques enseignantes pour qu’elles soient réellement éducatives et non plus répressives.
Bref, le pied !
Un développement douteux
Pourtant, l’exposé commence assez vite à inspirer doutes et méfiance, la rigueur sociologique semble par moment de degré variable : les chiffres énoncés en passant, d’autres qui ne sont jamais évoqués, le simplisme de certaines conclusions, surprennent pour le moins. Surtout lorsque l’auteure dit par exemple, que les garçons sont presque tout aussi victimes de « viols et d’attouchements » que les filles, respectivement : « 1/5 et 1/6 », sans préciser que dans la très grande majorité des cas les auteurs de ces violences sont des (jeunes) hommes. Or, une étude de 1996 du CNRS a montré que parmi les 15 à 18 ans 15,4% des filles contre 2,3% des garçons déclarent avoir subi des rapports sexuels forcés. Et que dans 85% de ces rapports ont été commis par des hommes connus, jeunes ou adultes. [5]
Il est également clair qu’une seule expérience de la sanction est retenue et mise en avant. Cette expérience est celle d’un « rite de passage » pour les garçons qui participerait à leur « affirmation virile » à leur sortie de l’enfance. Ce ressenti est montré comme contre-productif puisque trop positif par rapport au but recherché par ceux, et surtout celles qui sanctionnent. Les enseignants qui prétendent vouloir « contrôler » le comportement des garçons « trop agités », leur donnerait en fait l’occasion de « performer leur genre » en validant par la sanction même leur adéquation au comportement attendu d’eux en tant que garçons.
Et ce sont surtout les femmes qui valident ces rôles puisque ce sont majoritairement des femmes qui sanctionnent : les femmes donnent 74,3% des sanctions et 87,9% de celles-ci à des garçons... Or, par là, dit l’auteure, elles entérinent l’idée qu’elles compensent leur « déficit d’autorité » face à des garçons « turbulents » qu’il faut « tenir ». La sanction serait en somme une injonction contradictoire.
Ce sont donc encore les femmes qui font des garçons des « garçons ». Damned, encore elles !
Car la sanction « consacre ». C’est le coeur de l’analyse. Les sanctions sont perçues par les élèves comme autant de « médailles », de « trophées ». Elles inspirent le respect des autres garçons et l’admiration des filles. Celui qui « transgresse » et se fait punir « en a », et ceux et celles qui sanctionnent alimentent d’autant le « virilisme » et la distinction de genre. La chercheuse l’explique elle-même dans son entretien à Libération :
« (La sanction) permet un passage symbolique, l’entrée dans le groupe des garçons dominants. Il y a un peu de souffrance : des admonestations du CPE [conseiller principal d’éducation, ndlr], des parents, mais cela fait partie du rite. Et finalement, c’est une consécration. Les garçons avouent d’ailleurs en tirer un immense plaisir, ils parlent « d’adrénaline », « d’excitation ». Tout cela leur sert à se démarquer du féminin, et à l’intérieur du groupe des garçons, à se démarquer des « faibles ». Cela leur sert à montrer qu’ils sont dominants et hétérosexuels. Ce rite leur permet d’être en conformité avec les normes ; d’être un « vrai » garçon. Il y a d’ailleurs des concours de celui qui aura le plus d’heures de colle. Quand un garçon se fait exclure du collège, le lendemain, il est devant l’établissement avec ses copains agglutinés tout autour de lui. Comme un héros. Comme un petit caïd auréolé de sa gloire. Tout cela grâce à la sanction. » [6](Nous soulignons)
Il existe pourtant d’autres expériences bien moins « bénéfiques » et « positives » du contrôle scolaire et social. Celui-ci est opéré par les sanctions et le traitement par l’institution scolaire des élèves réputés « difficiles ». Il génère chez eux un sentiment d’exclusion et participe à une socialisation anti-scolaire [7]. Car être exclu plusieurs fois, quand on est un garçon issu d’une famille de classe populaire, qu’on est vu comme « d’origine », et que ses résultats scolaires sont jugés « insuffisants » et qu’on « ne se donne pas la peine », tout cela n’a pas les mêmes conséquences que lorsqu’on est un élève « blanc », de famille de classe moyenne ou supérieure, exclu pour un ou deux jours une fois pour « bavardages et incivilités ». Pour ce dernier, le parcours scolaire n’en sera pas forcément durablement affecté, l’orientation future est moins susceptible d’être remis en cause, et les parents s’engagent généralement à être garants de son « retour dans le droit chemin ».
Le fait d’insister sur le fait qu’à l’école, les garçons sont défavorisés en tant que garçons parce qu’ils sont victimes de pratiques qui les aident, voire même les contraignent, à adopter des postures virilistes, le fait de mettre en avant la sanction des garçons comme une discrimination, sans jamais aborder d’autres formes de contrôle genré des filles à l’école et hors de l’école ne semble pas aller dans le sens d’une étude qui aurait pour but de prôner une réelle égalité.
Mais surtout, le fait qu’au final, l’auteure n’aura jamais abordé les bénéfices et privilèges dont jouit pourtant clairement la catégorie « garçons / hommes » dans le système scolaire, semble finalement orienter l’exposé : puisqu’il minimise le fait que l’école n’est, en effet, pas un lieu d’égalité et que les filles, alors qu’elles sont plus performantes scolairement et « épargnées par la sanction », étrangement, n’en sortent pas avantagées par rapport à leurs pairs masculins.
Les usages du propos
La présentation de l’intervenante est introduite et modérée par Jean-Louis Auduc, ancien directeur d’IUFM et auteur d’un ouvrage au titre explicite : Sauvons les garçons. En 4ème de couverture on peut lire ceci : « Pourquoi sauver les garçons ? On a rarement l’occasion de penser le genre masculin comme une catégorie disqualifiante. Et pourtant, à l’école, être un garçon se révèle un handicap. ». L’ouvrage liste en effet les prétendue « faiblesses du sexe « fort » ».
En tant que modérateur, il prendra particulièrement à coeur qu’on n’interroge pas trop le propos de l’intervenante. Lorsqu’une personne dans le public demande pourquoi les chiffres et statistiques sur la situation des femmes ne sont pas donnés en regard, car si le fait d’être un garçon à l’école est un handicap les effets de ce handicap et de ces injustices devraient se retrouver, assez logiquement, à plus long terme dans les études supérieures, sur le marché de l’emploi, dans la sphère politique... Jean Louis Auduc interrompt brusquement et affirme que les chiffres récents montrent « qu’il n’y a presque plus d’écart entre les salaires des hommes et des femmes et que les hommes sont plus victimes du chômage que les femmes ». On appréciera le propos au regard des derniers chiffres de l’INSEE datant de novembre 2011 [8]. D’ailleurs, un murmure de protestations se fait entendre dans la salle - où se trouve un public majoritairement féminin - mais il est aussitôt interrompu par une autre salve de Jean Louis Auduc, qui rappelle que « sur 110 000 élèves en décrochage scolaire sur 100 000 sont des garçons ! »
Pourtant, il existe des sanctions spécifiquement genrées pour les filles comme c’est pourtant le cas de la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l’école et les entrées dans le règlement concernant « les tenues correctes » : des points de règlements qui dépendent de la libre appréciation de ceux qui les invoquent, et peuvent donc s’avérer très arbitraires. Et, ce sont massivement aux filles qu’on reproche « une jupe trop longue et sombre » [9] qui contreviendrait à la loi de 2004 sur le port de signes religieux, ou un décolleté ou un short ou une jupe trop courte qu’on jugera « indécents ». Le contrôle social des rôles sexués s’exercent aussi sur les corps et les comportement des filles.
Là encore le modérateur, Jean Louis Auduc coupe sèchement et dit que : « ça n’a rien à voir. Et puis seulement 13 filles ont été exclues pour port du foulard. Et ce sont essentiellement des garçons sikhs qui refusaient d’enlever leur turban, qui ont été exclus. » Une grossière distorsion de la réalité [10], puisqu’en janvier 2005, François Fillon lui-même confirmait que 48 jeunes filles la plupart musulmanes et 3 garçons (jeunes sikhs pour le port du turban) avaient été définitivement exclus de leur établissement.
Et là on voit bien dans quel cadre et quel usage sera fait de l’étude de Sylvie Ayral. Il ne s’agit que de parler des garçons et du sort de certains pour minimiser, ou ne surtout pas aborder ce dont bénéficient une majorité en tant que garçons par rapport aux filles.
Car si la proportion des jeunes hommes qui sortent du système scolaire sans qualification est en effet supérieure à celle des jeunes femmes sans qualification, celles-ci connaîtront en revanche un chômage plus important et la proportion de temps partiels pour elles sera trois fois plus nombreux que pour eux (38% contre 12%).
Par ailleurs, s’il faut se soucier des échecs des garçons et s’en alarmer, pourquoi ne pas rappeler également les inégalités structurelles qui touchent les filles, car si on le sait depuis longtemps maintenant : si elles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons, ceux-ci :
• investissent massivement les filières scientifiques,
• sont sur-représentés dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles
• sont plus nombreux à obtenir un doctorat,
• sont plus facilement orientés vers les filières dites « nobles »
• se détournent des filières littéraires et de celles qui mènent aux métiers de l’éducation-santé-action sociale,
• quand ils les intègrent, ils y sont beaucoup mieux traités que leurs collègues femmes
• seront globalement mieux payés
• sont plus souvent embauchés à temps complet
• ne subiront pas le phénomène du plafond de verre [11]
Par conséquent, si les garçons sont sur-représentés dans l’échec scolaire (et s’il faut bien sûr s’en soucier) ceci n’a pas pour corollaire que les filles sont sur-représentées dans la réussite scolaire et avantagées plus tard sur le marché du travail – bien au contraire. Etrangement, si l’on s’alarme pour les uns, cela fait bien longtemps qu’on s’est habitué au sort des autres, quand on ne leur attribue pas carrément la faute de leur sort : elles se conformeraient plus aux rôles sociaux de sexes attendus, seraient peu ambitieuses, ne sauraient pas se battre pour être promues, se sous-considèreraient sur le marché de l’emploi, choisiraient de s’investir dans leur rôle attendu de mères au détriment de leur carrières ...
Masculinité = vulnérabilité
Pour terminer la démonstration, après avoir tout de même dressé les effets contre-productifs de l’inflation punitive à l’égard des garçons, on sort soudain du strict cadre scolaire pour passer aux effets pervers à long terme de l’injonction à la virilité.
Elle nous montre une liste qui énumère une série de situations où les hommes représentent entre 80 et 90% ….
• des prisonniers.
• des SDF dans la rue.
• des conducteurs morts dans des accidents de la route
• des suicides réussis
• des affaires de violences conjugales (!!!)
Voilà, la conséquence de l’injonction à la masculinité : la vulnérabilité ! C’est dit, tel quel ! « La plupart des transgressions ne relèvent pas de conduites déviantes, mais de conduites sociales de virilité. » (je cite)
Le propos ultime devient à ce stade explicite : les hommes sont une population « à risque » et il faut s’en alarmer. L’injonction à la virilité est présentée comme une « souffrance », comme une prison (puisque la société les « enferme dans ces rôles ») pour ceux qui la performent (ils n’ont pas le choix, on les y contraint) comme pour ceux qui n’y arrivent pas : les « hommes faibles » (c’est écrit au tableau, ou plutôt dans le powerpoint projeté pour illustrer la présentation), il s’agit, nous dit-on, des profs « faibles » qui n’arrivent pas à gérer leurs classes et les garçons qui se retrouvent en bute aux insultes homophobes parce qu’ils ne correspondent pas suffisamment aux normes de la masculinité. La catégorie « homme » n’est pas à considérer comme une catégorie dominante mais une catégorie « à risque ». Le virilisme fait souffrir, parce qu’il surexpose à des « conduites à risque » et tue, mène aux suicides et à la violence.
En fin de développement, l’auteure insiste sur le souci que nous devrions avoir de ce que produit le virilisme et opère un glissement du discours très révélateur lorsqu’elle dit que les conséquences de l’injonction à la virilité fait que les hommes « se retrouvent dans des violences conjugales ». « Se retrouver dans » laisse entendre qu’il s’agit d’une situation où ils sont pris « malgré eux », comme on se retrouve « les pieds dans l’eau » ou « dans la merde », et dont ils ne tirent aucun bénéfice.
La reformulation de l’intervenante est ici édifiante : elle n’euphémise pas, elle nie en ne disant pas que dans les affaires de violences conjugales, il y a des auteurs responsables de leurs actes et que, très majoritairement, ce sont les hommes qui frappent et tuent et que ce sont les femmes qui en sont les victimes. Elle ne dit pas que c’est une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Et ne pas le dire est la preuve flagrante de l’intention du propos. Puisqu’on sort totalement du cadre initial pour tomber dans un discours idéologique d’un tout autre ordre. Cette idée et cette manière de présenter les choses font écho aux pires discours masculinistes, qui militent pour la prise en charge des conjoints et hommes violents auxquels il faudrait venir en aide parce qu’ils sont aussi victimes du « mal qu’ils font subir aux autres », qu’ils sont aussi, sinon les premiers, « victimes » de la violence qu’ils exercent et font subir [12].
Il ne sera jamais évoqué, en regard, ce que les injonctions à la féminité ont pour conséquences néfastes et handicapantes, elles aussi, à plus ou moins long terme sur les filles, sur leur construction en tant qu’individus, dans leur rapport avec leurs pairs et dans leurs parcours futurs. [13]
Quant cet aspect là est évoqué par la salle, l’auteure dit bien comprendre la question, qu’elle « qualifierait de … féministe » et qu’elle « pourrait partager », mais que son approche est « autre ». (Surtout : Ciel, se démarquer du qualificatif de féministe !) Parce que dans « l’inégalité hommes/femmes, il y a les femmes et il y a les hommes et qu’on ne peut pas faire avancer les choses sans faire les deux en même temps ». Cette approche fait écho à celle adoptée par Daniel Welzer Lang et Chantal Zaouche-Gaudron dans Masculinités : état des lieux [14] - ouvrage auquel l’auteure Sylvie Ayral a participé.
Celui-ci a pour intention d’interroger : « celles et ceux qui confondent critiques sociales et ontologie du masculin, celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent imaginer les hommes que comme un groupe (ou une classe) incapable de s’adapter aux nouvelles donnes du genre créées par des mouvements sociaux très divers (auxquels ont d’ailleurs toujours participé des hommes), celles et ceux qui réduisent le masculin à ses fondements violents et sexistes ou encore à l’étiquette erronée de masculiniste (terme aujourd’hui utilisé pour décrire et dénoncer les analyses et les actions d’hommes s’opposant à l’égalité de genre, en particulier aux féministes). »
Si l’on traduisait ce propos dans un contexte anti-raciste, on imagine comment serait perçu un discours sur le fait que « les blancs » ne sont pas « une classe, une catégorie homogène » et que certain.e.s « blanc.he.s » vivent mal le racisme, qu’ils et elles ne sont pas toutes « comme ça », que la crise de la « blanchitude » leur a fait opérer une douloureuse mais intéressante évolution... Ce qui se dit, ça et là bien sûr, mais passe difficilement pour un discours « progressiste ».
Pour sa part, Sylvie Ayral prétend vouloir faire deux choses à la fois pour plus d’égalité, sauf que ce jour là, il n’a s’agit, du début à la fin, que d’une seule et même chose : sauver les garçons !
Et la fabrique des filles ?
Contrairement à ce que pourrait nous laisser penser le titre, La fabrique des garçons n’est en rien le pendant d’un livre publié en 2010, La fabrique des filles de Rebecca Rogers et Françoise Thébaud. un ouvrage d’histoire qui contribue à expliquer pourquoi aujourd’hui encore la mixité ne suffit pas à créer de l’égalité. Cette référence aurait pourtant pu éclairer en quoi l’école participe toujours à la perpétuation des rôles assignés aux filles et ce que l’école a apporté en terme de promotion aux garçons/hommes en tant que classe. Car la mixité scolaire est encore récente. L’instruction n’a pas été ouverte aux filles pour en faire les égales des garçons et n’a pas diluée les distinctions de genres.
Par ailleurs, à aucun moment, l’explication en termes de genre ne rappelle, en parallèle et dans le même mouvement, que les filles sont soumises à un contrôle permanent, et que celui-ci se met en place très tôt et leur dicte qu’elles doivent : se tenir bien, être sages, ne pas parler trop fort, ne pas être agitées, être efficaces, soignées... alors qu’un garçon est plus autorisé à être : dynamique, actif, à prendre de la place, à s’imposer, à bouger. D’ailleurs, des études montrent depuis longtemps, que contrairement aux garçons, quand elles prennent la parole en classe sans y être invitées, ou autorisées, le rappel à l’ordre est beaucoup plus prompt et systématique pour les filles qu’il ne l’est pour les garçons. [15]
Quels messages explicites ou implicites l’école participe-t-elle à transmettre en terme de genres et de constructions genrées aux filles ? Surtout quand ils émanent également de la famille, de leurs pairs hors et à l’école, et que ces injonctions faites aux filles à la discrétion, voire à l’invisibilité, se voient reflétées dans la place qui est donnée aux filles et aux femmes à tous les niveaux de la société, dans les médias et dans la classe politique. On ne peut donc pas dire que les filles sont « favorisées » vis-à-vis des garçons qui eux seraient « victimes ». Elles sont « épargnées » par les sanctions scolaires, parce que « dressées » déjà de manière multiple et systématique depuis longtemps.
Si la virilité est une « injonction » pénible pour certains, ne l’est-elle pas surtout pour celles qui feront les frais de ces manifestations ? On ne peut pas décemment dire qu’elle ne permet pas à une majorité d’individus, qui a aussi un intérêt bien compris à s’y conformer ou à ce que la classe des hommes se maintienne, de faire leur place dans le groupe de sexe dominant qui bénéficie à court et long terme de nombreux privilèges auxquels ils ne sont pas prêts à renoncer.