
Sylvie Tissot. Quand je t’ai rencontré en 2001, tu étais militant au MIB, un groupe qui était mobilisé pour défendre les étrangers victimes de la double peine [1] et pour dénoncer les bavures policières. Aujourd’hui tu es directeur de la régie de quartier de la Maladrerie, à Aubervilliers. Mais tu as grandi loin de Paris.
Abdelaziz Gharbi. J’ai grandi à Longwy, en Lorraine, une région sidérurgique à l’époque. Mon père est venu en 1958 en France avec deux missions entre guillemets : d’une part subvenir aux besoins de sa famille mais aussi en tant que militant FLN. Il jouait le rôle de logisticien au service de la révolution algérienne. Etant donné ses rapports avec l’Etat français, les premiers potes qu’il a eus, c’étaient des Italiens et il a d’abord appris l’italien. Et moi j’ai toujours eu de la sympathie pour les Italiens !
ST. Il venait d’un milieu rural ?
AG. D’une région rurale très engagée dans la révolution algérienne, et vraiment étranglée. Des embargos, des famines étaient orchestrés pendant la colonisation, et encore plus pendant la guerre où la région avait été gazée. C’était une région très dure. Mon père a vécu cet engagement là et puis ensuite ici en tant qu’ouvrier.
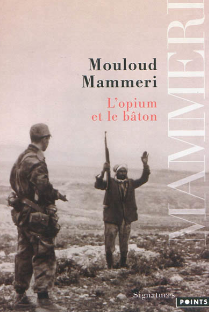
ST. Et ta mère ?
Ma mère venait d’un milieu un peu plus aisé que mon père. Son père était horticulteur et il avait une grande exploitation. Mais mon grand père maternel était attiré par la ferveur militante et indépendantiste de mon père et de sa famille. Ce décalage social a marqué les rapports entre mes parents car ma mère ressentait le déclassement en permanence. Mais c’était l’époque des mariages arrangés. Mon père l’aimait bien, mais elle, elle l’aimait moins. Elle aurait sans doute préféré un jeune homme qui se préparait à être médecin plutôt qu’un mec qui était berger, issu d’une famille rural et très rustre. Ensuite ma mère a été plongée dans la famille de mon père, sur les hauts plateaux. La famille vivait en tribu, et en plus c’était une famille qui luttait, et ça a été traumatisant. Ca a été d’autant plus traumatisant quand mon père a dû partir en France.
ST. Elle ne l’a pas accompagné ?
Non, lui est parti dans le cadre d’une lutte. Elle, là bas, a subi des violences de la part des militaires français. Elle a été sauvée in extremis par un officier de l’armée française mais des tantes à elle ont été torturées, mes oncles aussi. C’était une région où les combats étaient très intenses. La maison familiale a été détruite par les chars. Ma grande sœur était dedans, dans la maison.
ST. Quand est-ce que ta mère est partie en France ?
Mon père a connu un désenchantement par rapport à la thawra, la révolution. La révolution a débouché sur l’indépendance, mais en termes démocratiques les gens s’attendaient à autre chose. Très vite on est revenu à une société très policée où les ruraux notamment n’ont pas été reconnus. Tout ça a été des éléments de distanciation pour mon père par rapport au destin de l’Algérie, et par rapport à son militantisme. Ma mère l’a rejoint en 1966 et moi je suis né en octobre 66.
ST. Et ton père était ouvrier dans la sidérurgie ?
Mon père était ouvrier dans la sidérurgie et il y a travaillé jusqu’en 1979. 1979, c’est l’année du plan Barre à Longwy qui a mis fin à la sidérurgie. Ca été très, très, difficile pour nous. En 79 j’avais 13 ans, je m’en rappellerai toujours, il y avait déjà plein d’histoires de luttes dans ma tête. C’est le moment des premières manifs, avec mon père, contre les licenciements.

ST. Ton père était syndiqué ?
Il n’était pas syndiqué. Nous habitions près de Longwy dans un village tenu par une fortune locale issue de la famille des de Wendel. On habitait d’ailleurs un endroit spécial, l’endroit le plus pourri, avec les familles yougoslaves et italiennes. Un quartier ouvrier, mais à l’écart de tout. Quand j’étais môme pour aller au village, il fallait que je fasse deux bornes à pied. Mais j’en ai gardé un amour pour la marche ! C’était donc un contexte paternaliste dans lequel les syndicats n’étaient pas vraiment des contrepouvoirs mais plutôt un moyen d’avoir des avantages. Certains se retrouvaient copains copains avec les notables du village et mon père avait une certaine méfiance par rapport à cela. Et puis son combat c’était quelque chose de révolu. Il n’y avait plus de projet algérien pour lui et mon père nous disait : les gars vous allez faire votre vie ici.

Après 79, la crise s’accentue. Nos parents avaient été licenciés dans les premiers. Des situations de grande pauvreté ont commencé à apparaître. Avec aussi l’apparition de l’héroïne qui faisait pas mal de dégâts, on était tout près de la Hollande. Mais nous, ce qui nous a tenus, c’était le punk rock.
On s’identifiait totalement à ça, à la dégaine des ouvriers anglais, à une jeunesse vachement digne. C’était un modèle pour nous car ici on ne nous apprenait pas à être fiers d’être ouvrier. En France, il fallait rentrer dans le rang le plus vite possible et nous on n’arrivait pas à rentrer dans le rang. Ces Anglais nous ont filé la patate. On a créé un groupe de rock qui s’appelait Hystéropompé. Moi je chantais et je battais.

ST. Et durant cette période, quelle était ton expérience du racisme ?
Attends, moi dès la maternelle ça a été de la résistance à l’Education nationale. Le jour où je suis rentré en maternelle a été un jour très, très difficile. J’avais 5 ans. J’arrive en cours, bon tu es un peu content le jour de la rentrée. J’arrive bardé comme tous les élèves, avec nos habits du dimanche, nos petites fournitures. L’instit m’a retiré tous mes crayons de couleur, mes cahiers, elle m’a mis au fond de la classe, et elle m’a donné un crayon de papier et une feuille, et elle m’a dit : toi tu n’auras que ça, tu ne pourras pas utiliser les crayons de couleur. J’étais le seul qu’elle appelait par le nom de famille, tous les autres elle les appelait par leur prénom. Elle me frappait en plus. C’était 10 ans après la guerre d’Algérie. Tu le rencontres comme ça le racisme, très tôt. Il faut t’armer mais elle m’a plombé quand même.
Les premières années de primaire, j’ai eu des difficultés parce que je trimbalais ça et sincèrement ça marque. Ca m’a poursuivi, parce que j’étais un élève très indiscipliné. Au niveau cognitif pas de problème, mais j’étais toujours à droite, à gauche, je faisais l’école buissonnière. Quand j’étais en maternelle, je me faisais aussi casser la gueule. Des grands de primaire, qui étaient blancs bien-sûr et qui me tapaient tout le temps.

ST. Après tu es allé au collège puis au lycée ?
Ma mère voulait que je fasse des études. Mon père, il ne voulait qu’une chose : que je ne fasse pas l’usine. Mais j’étais très bagarreur, tu vois quand on m’a pris mes crayons, j’ai cherché à les récupérer. Je me battais et je répondais aussi aux profs. J’étais comme ça. J’aimais bien aller dans les bois, construire des cabanes. Des fois, je n’allais pas à l’école. Parce que je me suis tout le temps méfié des profs et de l’école en vérité. J’ai fait le collège mais pareil : on te dit que ce n’est pas toi qui a fait la rédaction alors que c’est toi. Après tu veux faire du théâtre et on te dit non, parce que t’as pas la tête de l’emploi, tu n’as pas le nom qui faut. Que des conneries comme ça qui te pourrissent la vie.
C’était la France des années 70, c’était raciste, éminemment raciste. On était considéré comme des dangereux alors qu’on n’était pas dangereux du tout, on voulait simplement vivre comme tout le monde. Et les profs n’avaient pas d’ambition par rapport à nous. Ils ne comprenaient pas qu’on était intelligents. Ils avaient déjà fait leur plan sur nous ; on était des loseurs oui, des gens à problèmes oui, la case prison mais pas des acteurs de cette société.
Au lycée, on avait monté la première radio indépendante en 84. On avait été soutenir la radio des ouvriers, et quand Mitterrand a décidé de la casser, on a pris l’émetteur et on l’a ramené au lycée. Moi j’avais une émission, c’était La soute à carnage, laisse tomber ! On envoyait le bois. Ca a duré le temps que… et puis ils ont dit : fini la radio ! Après j’ai eu une scolarité assez chaotique, je t’avoue. Je n’en pouvais plus alors j’ai fait plein d’aventures. Une première fois à 15 ans, j’ai fait le tour d’Italie en stop. Il fallait que je respire. Ca m’a permis de voir le monde. Et puis ce qui m’a sauvé, c’est les bouquins. Moi j’étais un rêveur impénitent. Et j’adorais les bouquins.
ST. Et les bouquins, c’était quoi, tu te souviens ?
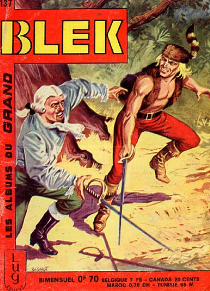
Quand j’étais gamin, j’ai commencé avec les contes de Grimm. Il y avait des ambiances inquiétantes qui n’existaient pas dans les contes de Perrault par exemple. C’est trop light Perrault. Et parce que je le vivais aussi en tant qu’enfant, je me reconnaissais dans ce qu’ils faisaient. Après ça a été Collodi pour Pinocchio, Stevenson, L’ile au trésor, les romans d’aventure, mais aussi la SF de Orwell à K. Dick en passant par les BD populaires format papier genre Zambla, Blek le Roc ou les BD genre Strange, Xmen, Les Titans, Les Quatre Fantastiques, ce qu’on appelle les comics.
Et puis les bouquins d’histoire, la question de l’histoire m’a tout le temps intéressé, et surtout pour accompagner la volonté de transformer les choses. Dès tout petit, je me suis dit : ça, il faut le changer.
ST. Où est-ce que tu as fait tes études ?
Je me fais jeter en fin de première. En terminale je ne foutais plus rien. J’étais tout le temps en train d’écouter de la musique avec les copains et puis à explorer des formes de voyages expérimentaux. J’ai arrêté l’école et il fallait bosser. C’était une époque assez dure, et j’ai fait des petits boulots qui étaient des sales boulots en fait, sur les chantiers. Mais je l’ai fait parce que j’étais mieux comme ça qu’à l’école. J’ai passé mon bac en candidat libre, et ça m’a aidé parce que je me suis aperçu que je n’avais pas besoin de prof. Que j’avais surtout besoin de soutien et mon frangin m’a soutenu.

J’ai commencé la fac à Nancy. Au début c’était très dur. Les étudiants ne m’intéressaient pas et on s’est retrouvé avec une bande de potes et on a fait des conneries : c’était un lieu d’apprentissage ! Incidemment à cette époque là, on a rencontré un bon pote qui nous a initié à la question du combat des homos. On ne savait pas ce que pouvait vivre un homosexuel et on a appris qu’il y avait d’autres gens qui se battaient et qui galéraient aussi. Ce qui était bien au moins avec eux, c’est qu’on avait de vrais échanges et que tu n’étais pas jugé. Ils nous regardaient tels qu’on était alors que les étudiants à l’époque, c’était : t’es pauvre, casse toi !
Nous on avait une vie un peu à la Velvet Underground. Ca m’a permis de rencontrer pas mal de monde hors de la fac. A la fac on était en guerre contre tous, contre les étudiants et contre les leaders syndicaux étudiants parce qu’on les soupçonnait de vouloir faire partie de l’appareil, ce qui est souvent le cas d’ailleurs. Le leader de l’UNEF, fils de je sais pas qui, coco bien stal à l’époque, avait dit dans un tract raciste qu’il s’était fait arrêter par les flics et qu’il s’était fait jeter avec les dealers, les arabes. Et on lui a dit : « ton sale tract, on ne le soutiendra jamais. Tu te prends pour qui ? Monsieur était donc avec la plèbe ! » Jamais il n’a évoqué la question de sa garde à vue, de la violence, la détresse des gens qui étaient à côté de lui. Non. Pour lui, c’était : « ils m’ont mis avec la piétaille, c’est un scandale ».
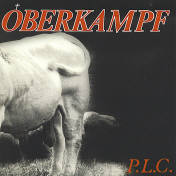
ST. Donc tu n’as pas adhéré à un syndicat étudiant, à un groupe militant ?
Si j’ai essayé. J’ai même adhéré au PC parce que la question ouvrière, ça me plaisait, en tant que solution peut-être possible de transformation. Après laisse tomber, la transformation, tu oublies ! Tu ne pouvais pas parler comme tu voulais parler, seuls certains avaient le droit à la parole. Toi, tu étais bien pour coller les affiches. J’ai dit, les gars, salut, au revoir ! Après on s’est lancé dans l’activisme, parce qu’on était quand même entourés de groupes fachos. On a eu une période cassage de gueule avec les skins et puis avec des colleurs d’affiche du Front national. Et on avait tout le temps les flics sur la gueule. J’ai aussi vaguement fricoté avec des mecs de l’OCI [2].
ST. Quand est-ce que tu es venu à Paris ?
En 88. A Paname au début je n’ai rien fait. Je me suis dit : tu as 22 ans, je voulais quelque part rattraper le temps perdu et j’avais envie d’étudier pour la première fois de ma vie. Je bossais, j’étais salarié et j’allais à la fac le soir à Paris 8 et je trouvais ça vachement bien. Là je n’ai eu que des profs généreux, et cette générosité a pas mal contribué à exorciser ce que j’avais vécu avant. Il n’y avait pas de préjugés, en plus j’arrivais à Paris 8, et Paris 8, c’est le 93, toute la planète était là, c’était génial !

Après je voulais être magistrat, ça m’intéressait pour plein de choses et notamment par rapport à la notion de justice. Et puis j’ai fait les démarches pour me présenter au concours de la magistrature, et ils n’ont pas voulu que je me présente. Il paraît qu’il y avait des enquêtes. Enfin, soit. J’avais travaillé en cabinet d’avocats, j’avais été chargé de cours au CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale). Je m’étais épanoui grâce à mes études, mais socialement ça n’allait pas. J’étais en train de devenir quelqu’un que je ne voulais pas être et je n’étais pas bien. Je n’étais pas heureux, tout simplement pas heureux, et je me demandais pourquoi. J’ai tout arrêté, j’ai commencé à un peu tourner et j’ai rencontré les gens de la double peine en 1997 avec Justice en banlieue.
Il y avait aussi votre bouquin à toi et à Pierre, qui m’a vachement plu [3]. Je ne sais pas comment il a été perçu par les intellos de l’époque, mais en tant que militant, il m’a donné vachement de force. A l’époque en France les politiciens pouvaient dire ce qu’ils voulaient et il n’y avait jamais de contrefeux. Ce con de Fabius qui disait que le Front national posait de bonnes questions…
ST. Et les gens du MIB étaient des mêmes milieux que toi ?
Oui, mais après il y avait des petites différences. Eux c’était des lascars, et avec l’Education nationale et la fac, ils avaient une défiance. Je comprenais parce que j’avais la même mais moi j’avais un parcours universitaire. Mais ce n’était pas très important. Ce qui importait, c’était au MIB d’incarner nos idées par des gestes et des actions. Depuis c’est resté une forme de règle chez moi. Mes idées, c’est des choses que j’incarne à travers mes gestes quotidiens et ma pratique quotidienne. Si on a un tant soit peu le désir de transformer les choses pour de meilleures conditions de vie, on doit s’affronter à l’âpreté du système, à sa cruauté la plus vache. S’attaquer au système c’est s’attaquer à des préjugés qui sont partagés par le corps social dans sa majorité. Ca m’intéressait.

Ce qui m’intéressait aussi au MIB, c’était que la double peine était un combat légitime et pas du tout moral. Et je trouvais cela très intéressant. Quand on défendait les double peine, on défendait une cause juste. Moralement ça pouvait prêter à discussion chez certains philanthropes qui disaient : c’est des délinquants, vous desservez la cause du racisme. Mais non au contraire, on pensait que c’était là où il fallait agir pour penser une société un peu moins raciste, des relations plus égalitaires et des conditions de vie humaines plus dignes. Et ça, ça m’a toujours intéressé.
ST. Et du coup vous n’aviez pas tellement de lien avec la gauche et l’extrême gauche même s’il y avait des exceptions - je me souviens d’Alexis Violet de la LCR qui était venu en 2001 à la manifestation pour le procès du policier qui avait tué Youssef Khaïf [4].

Oui, tu as raison. Et puis quelques personnes à l’OCI, quelques personnes qui militaient contre les prisons, la mouvance autonome. Mais c’est vrai qu’on avait très peu de rapports avec la gauche institutionnelle. Nous on était sur des combats de justice sociale et on avait raison. C’était la meilleure chose à faire par rapport à ce qu’on vivait et à ce qu’on vit dans les quartiers. Tous les combats que j’ai menés dans le cadre du MIB, la question de la discrimination ou de la justice sociale, je les retrouve aujourd’hui dans mon activité professionnelle. Dans le MIB il y avait une forme de modernité que je retrouve dans les propos de Sankara, d’Angela Davis, Huey P. Newton ou Cleaver. Mohammed Harbi aussi dans un certaine mesure.

ST. Tu pourrais décrire le quartier de la Maladrerie où tu travailles aujourd’hui ?
C’est un quartier pauvre, beaucoup de familles ne gagnent pas 10 000 euros par an. Tout ça crée des situations de nécessité et d’urgence. Les gens sont border line. Ils ne tiennent pas. On a des primo arrivants, et beaucoup d’exclusion scolaire. Quand tu as été exclu à partir de l’âge de 13 ans et que tu cherches à exister un tant soit peu socialement, c’est très, très difficile. Tu te replies, tu t’isoles. Ce sont des lieux qui sont pas mal sous contention administrative, notamment policière avec quand même, pour ma part, un traitement d’exception. Chacun peut se faire contrôler. Même dans ces cas là qu’est-ce que tu veux qu’on pense de la démocratie, quand, pour toi, ça veut dire un seul interlocuteur : le ministère de l’intérieur, que ce soit les parents au titre d’immigrés ou les enfants en tant que délinquant ou présumé délinquant habitant dans un quartier ?
ST. Il y une dimension nouvelle dans ton engagement aujourd’hui à la régie de quartier, c’est la dimension économique.
La régie de quartier permet d’embaucher des habitants de la Maladrerie, notamment sur des emplois de nettoyage de la cité. C’est un moyen alternatif pour créer de l’activité de service public, fédérer les habitants autour de problématiques sociales et travailler à l’égalité de traitement. Pour moi, c’est un moyen de lutter pour les droits, contre la discrimination, par le biais d’un projet économique fondé sur l’expertise sociale des habitants, et dans une structure associative dont ils sont les employeurs et qu’ils gouvernent. Aujourd’hui la sphère économique est un secteur où il n’y a aucun contrepouvoir citoyen et démocratique. Travailler pour la démocratisation de l’économie au niveau local est un enjeu de réappropriation collective du pouvoir économique donc politique. Personne ne le dit mais la souveraineté économique des citoyens est une bastille à prendre.
Si j’ai choisi d’opter pour un outil où l’économique est déterminant c’est parce que l’accès à certains droits aujourd’hui est déterminé par un salaire, une vie stable. Si tu omets ces choses là, tu peux faire des petits mouvements qui vont être ponctuels. Quand il y a une injustice qui est commise, il y a des mouvements aujourd’hui dans les quartiers et c’est bien. Mais si on veut donner au mouvement une pérennité, il faut bien que les gens puissent aussi être autonomes. Et cette autonomie, c’est une autonomie produite par l’exercice d’une activité à forte plus value sociale, c’est-à-dire capable de transformer le destin de la personne qui l’exerce et d’agir sur le destin collectif des habitants du quartier, c’est obligé. C’est pour ça que nous ici on offre à la fois aux habitants un travail et un projet collaboratif. Dans le même temps, il s’agit aussi de produire du droit. Cette dynamique ne peut s’instituer que si les pratiques dans la structure se départissent des objectifs des règles managériales exclusivement axées sur l’impératif de rentabilité pour privilégier celui de lien et de transmission.
ST. La question de l’insertion a été beaucoup récupérée, notamment pour créer des petits boulots mal payés.
Pour moi ce n’est pas la peine d’avoir une régie de quartier pour envoyer les gens au casse-pipe au niveau du salaire. Il faut envisager la question sociale dans le salaire. Moi ce que je trouve dommage dans l’économie solidaire, c’est qu’au niveau salarial il y a un tabou. Or au niveau salarial, il ne faut rien restreindre. Il faut payer les gens normalement, et même valoriser les salaires pourquoi pas ? La division du travail je ne la comprends pas. L’échelle des salaires, ça ne légitime qu’un ordre social de merde. C’est une construction idéologique parce que dans les faits ici par exemple c’est un travail d’équipe. Moi je suis rien sans eux, eux ils ne sont rien sans moi, cette solidarité est au cœur du projet. Certes, une régie tu peux en faire ce que tu veux. Mais si tu pars de la conception initiale, du postulat que ce sont des habitants qui sont tes employeurs, il y a vachement de choses à faire, et c’est subversif comme idée. Parce que dans le bureau de l’association il y a des locataires, et on discute de la manière de gouverner le projet économique de la manière la plus adéquate pour incarner un début de réponse aux besoins des habitants. Dans ce processus, il y a une forme de démocratisation de l’économie. Ils s’intéressent à une structure, un projet de quartier.
ST. La dernière chose dont je voulais te parler c’est les transformations à Aubervilliers, qui se situe tout près de Paris et suscite aujourd’hui l’intérêt des promoteurs sans que les élus ne s’en inquiètent vraiment…
Toute l’ancienne petite ceinture rouge, le rêve des maires, de gauche ou ce que tu veux, c’est de changer leur population. Et pour ça l’orientation des politiques, c’est le sécuritaire, qui sanctionne les plus démunis et les fait passer pour des bandits. Il y a des familles qui sont parfois expulsées, des jeunes qui se font incarcérer pour permettre au quartier de « respirer », aux gens qui veulent plus de sécurité de s’épanouir. La population d’Aubervilliers est en train de changer au centre-ville, et on sera concerné dans 5-6 ans. Mais déjà à la Maladrerie, qui est un ensemble de logements collectifs construit par l’architecte Renaudie, il y a maintenant des habitants qui sont devenus propriétaires.

Dans le même temps, beaucoup de familles ont accédé à des logements dans le cadre du dispositif DALO (Droit au logement opposable), tout ça dans un mouvement de retrait de l’Office public HLM qui agit et se comporte comme un bailleur privé, c’est-à-dire qui privilégie sa clientèle de prédilection : les ménages solvables bi actifs avec un ou deux enfants. A côté de cela les associations de locataires sont instrumentalisées dans cette guerre sociale de basse tension, comme pourrait le qualifier Mike Davis, au nom de la lutte pour la tranquillité et le vivre ensemble. De la sorte ces associations de locataires adoptent des positions de rupture avec les locataires les plus démunis. Mais c’est une rupture stigmatisante qui induit des tensions. Les tensions qui alimentent et accompagnent la déliquescence du lien social sont largement nourries par la lutte contre la délinquance qui est un fourre tout aujourd’hui pour répondre à la question sociale et faire semblant de résoudre les problèmes dans les quartiers pauvres. La réponse policière demeurera pourtant toujours insuffisante, inconsistante tout le monde le sait. La spéculation immobilière est donc là, accompagnée de ces équipes de policiers qui naviguent tout le temps à la recherche du moindre présumé délinquant pour le fouiller. C’est les lois du marché qui priment. Et plus le marché primera, moins il y a aura de politique. Et on pourra se trouver bientôt, comme dit Chomsky, dans des régimes fascistes mais souriants.
Le plus dur à accepter c’est que la transformation elle se fait, mais c’est pas la transformation qu’on recherchait : un esprit égalitariste, un service public de logement, un service de sécurité sociale, la redistribution. Ces valeurs là aujourd’hui sont complètement reniées. Avec le nouveau gouvernement socialiste, on pensait changer et encore une fois, on est complètement dans une continuité. Notre président, c’est un VRP comme l’ancien. Ils sont élus au nom de l’intérêt général, mais ils fonctionnent pour l’intérêt privé. La politique étrangère, maintenant, c’est la guerre et la promotion de l’industrie de l’armement. Là j’entends ce matin à la radio que M. Hollande va en Inde, vendre du Rafale, après le Mali. Je trouve ça inquiétant. On va encore assister à une extrême droitisation, tout ça parce que la gauche a honte de ses idées et n’ose même plus les proférer. Quand je vois ce qui se passe avec la loi pour le mariage pour tous, soit disant il faut discuter avec les forces les plus obscurantistes. Non, il faut l’imposer et c’est tout, comme le droit de vote des immigrés. Et puis voir Hollande partir avec des patrons à New Delhi, ça me sidère. C’est ça un président socialiste ?


