La chasse est à nouveau ouverte. Le président de la république a donné le signal, les grands médias ont obtempéré : le débat de la rentrée 2019, et des longs mois qui vont suivre jusqu’à la prochaine présidentielle, ce sera l’immigration. La déferlante médiatique a commencé, Samuel Gontier en a donné sur son blog un terrifiant florilège. Comme souvent depuis quelques décennies, on retrouve partout une rhétorique guerrière : le président Macron « passe à l’offensive », il part « à la conquête » des classes populaires, ou encore, nous dit Le Monde, il « monte au front » et fait de l’immigration « son nouveau Cheval de bataille ». Ruth Elkrief, sur LCI, développe le concept : « Il nous manque un Chevènement, voilà ce qu’on dit à l’Elysée. Il n’y a pas dans le gouvernement assez de personnalités martiales ». C’est ce virilisme bête et méchant, profondément ridicule mais aussi et surtout politiquement lourd de très coupables conséquences, que nous aimerions déconstruire ici, en revenant plus précisément sur la clef de voute de cette rhétorique : le mot courage. Une rhétorique et un mot repris à son compte désormais par le président de la République, et autant le dire tout de suite : pas pour partir en Méditerrannée porter secours aux émigrants qui se noient, naufragent ou sont empêchés d’accoster.
Dans notre monde politique, il suffit pour être courageux, et l’on peut s’en étonner, de parler. Il suffit plus précisément, pour être courageux, de prononcer quatre paroles magiques :
« Oser »
« Affronter »
« Ne pas avoir peur de »
« Regarder la réalité en face »
On l’aura compris : il n’est pas question, loin s’en faut, du courage de faire quelque chose, de poser un acte politique fort, de travailler dur, de prendre des risques, moins encore de se battre pour une cause difficile – ce que pourtant sous-entendent les sens premiers du mot courage. Il s’agit, tout au contraire, d’observer un état de fait, de l’accepter, et de s’y soumettre. Ce qui n’est pas très loin, on en conviendra, des définitions usuelles de la démission et de la lâcheté.
Cela peut sembler incongru mais c’est en fait banal : il est dans la nature de l’idéologie dominante de produire des discours qui, pour parler comme Marx, mettent le monde sens dessus dessous [1]. C’est ainsi par exemple qu’au lendemain du 11 septembre 2001, Colin Powell qualifia de « lâches » les dirigeants qui ne se soumettaient pas à George Bush et ne le suivaient pas dans sa croisade irakienne – sous-entendant ainsi, comme le releva l’humoriste Terry Jones, que « le courage consiste à pouvoir décréter la mort de 100000 Irakiens sans broncher ni vomir sa Caesar Salad ».
Ce type de retournements sémantiques est fréquent aussi en France. Il y a quelques décennies par exemple, lorsqu’en 1983 la gauche de gouvernement abdiqua toute velléité de transformation sociale, lorsqu’elle opta pour une soumission complète à l’ordre capitaliste et à ses dogmes libéraux ou néo-libéraux, elle justifia ce grand renoncement en nous expliquant qu’il fallait avoir le courage de voir en face la réalité de la guerre économique mondiale. Ce qui se traduisit, sur le terrain, dans les entreprises, par un virilisme managérial bien analysé par Christophe Dejours [2], professant le courage de maltraiter les salariés, et de savoir prendre ces décisions difficiles que sont les licenciements.
Peu de temps après, lorsque la même gauche française renonça définitivement à faire vivre le principe d’égalité, à promouvoir ou simplement défendre les droits des étrangers, à tenir tête à la droite et à un patronat ne tolérant l’immigration que désarmée, sans papiers, sans droits, corvéable à merci, elle nous expliqua qu’il fallait avoir le courage de reconnaître et affronter un très réel « problème de l’immigration ». Et quand en 1991 Jacques Chirac, alors chef de l’opposition de droite, céda sur le principe constitutionnel d’égalité des droits sociaux entre français et étrangers, pour se ranger derrière la bannière lepéniste de la « préférence nationale », il déclara qu’il fallait avoir « le courage » de poser ce « grand débat moral ». Le courage, en somme, de dresser plus de 50 millions de Français, des plus pauvres aux plus riches, contre moins de 4 millions de résidents étrangers, cantonnés pour l’essentiel dans les classes les plus pauvres.

A droite toujours, le ministre de l’intérieur Jean-Louis Debré nous expliqua en 1996 que céder aux demandes (plutôt basiques pourtant, voire minimales) des sans-papiers serait « une lâcheté », à laquelle il opposa donc son très grand courage : celui d’envoyer des légions de CRS fracasser les portes de l’Eglise Saint Bernard, rafler hommes, femmes et enfants, les enfermer en attendant de les expulser. Quelques mois plus tard, le même ministre courageux fustigeait d’ailleurs les « couilles molles » (ce furent ses mots) qui ne soutenaient pas son projet de loi « généreux mais ferme » durcissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
Cette rhétorique viriliste a très tôt séduit, bien entendu, la frange du monde intellectuel et médiatique dite souverainiste ou national-républicaine, qui se constituait à la même époque autour de Régis Debray, Max Gallo et Jacques Julliard. Ces derniers lancèrent avec quelques autres, dans Le Monde du 4 septembre 1998, un bruyant appel au titre éloquent : « Républicains, n’ayons plus peur ! » – dans lequel ils avançaient des propositions aussi courageuses que la suspension des allocations familiales pour les parents de « délinquants », ou l’envoi systématique desdits délinquants, même mineurs, en prison – sans oublier une attribution plus « exigeante » de la nationalité française...
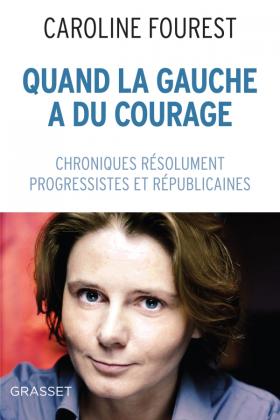
Puis il y eut des attentats meurtriers, à New York, en Europe, à Paris, et face à cette horreur le courage fut encore au rendez-vous. Certes pas celui de résister à la facilité, aux préjugés, à la tentation de la vengeance aveugle et à la logique du bouc émissaire. Le courage qui fut célébré en haut lieu et en grande presse fut surtout celui de « critiquer l’Islam » – entendez : le courage d’incriminer des centaines de milliers d’innocents sans ressources, sans tribune, sans rond de serviette chez LCI ou BFM, le courage d’essentialiser et stigmatiser quotidiennement, du haut de plusieurs siècles d’ethnocentrisme triomphant (et, répétons-le, sans grands espaces pour les droits de la défense), une religion minoritaire, répandue surtout dans les franges les plus pauvres et précaires de la société française [3].
Ce fut alors Nicolas Sarkozy qui usa et abusa de cette rhétorique belliqueuse, en qualifiant de courageuse lucidité chacune de ses sorties racistes, chacun de ses manquements et de ses égarements, chacune de ses abdications, chacune de ses démissions face aux thématiques, aux thèses et au programme de l’extrême droite. Roulant des mécaniques sur la dalle d’Argenteuil, bien protégé, il est vrai, par une abondante escorte policière, il s’aventura même à jouer les Tony Montana, le 25 octobre 2005, avec son célèbre :
« Vous en avez assez ? Vous en avez assez de cette bande de racailles ? Bah je vais vous en débarrasser ! ».
La vérité de tous ces discours virilistes et belliqueux ne fut sans doute exposée nulle part mieux que sur la chaîne Direct 8 par Manuel Valls, qui fut le digne successeur de Sarkozy dans le rôle du Capitaine Courageux. Interrogé en juin 2009 sur des déclarations qui manifestaient, une fois de plus, une lâcheté, une veulerie, et une complète démission intellectuelle et morale (des propos, rappelez-vous, qui pointaient du doigt le trop grand nombre de Noirs dans « sa » ville d’Evry, et le manque « de White et de Blancos »), le socialiste s’en tira par des considérations absconses sur la mixité sociale et les ghettos, une réalité qu’il faut regarder en face nous disait-il, avant de se vanter d’être un des rares hommes politiques à oser, tenez vous bien :
« aller sur les plateaux de télé pour affronter ces problèmes ».
Tout était dit : c’est sur les plateaux que ça se passe. C’est dans la bulle capitonnée des studios de télévision, en plutôt bonne compagnie, claire de peau et plutôt CSP+++, que se mènent ces viriles guerres de tranchée. C’est dans l’entre-soi d’une caste ultra-privilégiée (et ultra-protégée par des rangées de vigiles) que se joue la tragi-comédie de l’écoute-des-plus-modestes-de-nos-compatriotes-qui-n’en-peuvent-plus-de-cette-immigration-incontrôlée-et-de-cette-intégration-en-panne. C’est bien au chaud Avenue Montaigne, chez Ruth Elkrief, chez David Pujadas, qu’on se dresse contre la « bien-pensance » antiraciste des « bobos », « intellos parisiens » et autres « élites radicales-chic ». C’est tout en haut qu’on parle de, pour et à la place de ceux d’en bas. C’est en papotant avec Christophe Barbier, Ivan Rioufol et Raphael Enthoven, le cul sur un coussin, en sirotant éventuellement un Perrier rondelle ou en grignotant quelques cahouètes, qu’on déclare la guerre au « laxisme », au « communautarisme », au « fondamentalisme » (et nettement moins au simplisme, au racisme ou au fascisme).
C’est « sur les plateaux », donc, quand ce n’est pas dans un cabinet ministériel ou dans le bureau présidentiel, qu’on joue à la guerre politique, à la guerre sociale et à la guerre ethnique. C’est de très très haut, doté d’une force de frappe médiatique écrasante, donc à armes très inégales, et sans courir aucun risque autre que l’échec et la non-réélection, que courageusement on joue avec la vie des autres, ceux qui sont tout en bas, en construisant un clivage, un antagonisme, et donc les conditions de la violence raciste au sein des classes populaires (entre Français autochtones blancs et « issus de l’immigration » et/ou « de la diversité »). C’est de très très haut, surarmé et loin de tout risque qu’au final on fragilise, on brutalise, on surexpose les étrangers et les perçus-comme-tels, et qu’on s’amuse à remettre en cause un droit universel comme le droit à l’aide médicale.
C’est donc dans cette vieille, triste et détestable histoire que le président Macron vient, avec force, de s’inscrire. On apprend en effet, dans Le Monde du 18 septembre 2019, que le président appelle sa majorité à « regarder en face » ce « sujet » trop longtemps « délaissé » (dit-il) par la gauche. Une posture qui fut déjà celle de son premier ministre, Edouard Philippe, lorsqu’il invoquait au printemps dernier « le courage d’affronter sans fausse pudeur certaines réalités ». « Si on n’a pas le courage de traiter ces questions, c’est la porte ouverte au Rassemblement National ! » surenchérit courageusement, bien qu’anonymement [4], un député LREM qui a bien appris sa leçon.
Il n’y aurait d’ailleurs pas grand chose à redire si lesdites « réalités » et lesdites « questions » étaient problématisées en de tout autres termes que ceux de l’extrême droite : si le courage invoqué consistait par exemple à enfin « regarder en face » le mur meurtrier de la Méditerrannée, et plus largement les effets criminels de la fermeture des frontières, les manquements actuels au droit d’asile, les manquements persistants au droit à la santé et à la scolarisation pour les enfants rom ou les mineurs étrangers isolés, et enfin la masse de discriminations impunies dont sont victimes les étrangers et les Français « issus de l’immigration ». Mais tel n’est pas le cas, c’est le moins qu’on puisse dire : dans l’esprit et la parole du président, c’est à « la délinquance », aux « agressions » et aux « cambriolages » que ledit problème de l’immigration est associé, en un pur, simple et brutal amalgame. Avec une consigne claire adressée aux députés de sa majorité : « se défier des bons sentiments ». Et quelques priorités qui interrogent, toujours si l’on en croit les confidences recueillies par Le Monde : verrouillage accru de l’asile politique et du regroupement familial, baisse de l’allocation d’aide aux demandeurs d’asile, et enfin une « réforme » restrictive de l’aide médicale ouverte aux étrangers, quelle que soit leur situation :
« Réduction du panier de soin, par exemple en excluant de la prise en charge l’hépatite C ou le cancer ; mise en place d’un reste à charge pour le patient, ou de centres de santé dédiés. » [5]
On apprend aussi, toujours en lisant Le Monde, que « le chef de l’Etat aurait émis, en des termes parfois crus, le souhait d’augmenter les expulsions d’Albanais sans papiers. »
Le ton est donné enfin par Sibeth Ndiaye, chargée de la communication du gouvernement, lorsqu’elle évoque « l’afflux » futur « de millions de personnes venues du Maghreb », et la nécessité de « s’armer » pour y « résister ».
Ce singulier « courage », notons-le pour finir, n’est pas tout à fait nouveau chez ce président et dans sa clique : dès janvier 2019, le contrefeu à la contestation sociale des gilets jaunes avait été cette même question empoisonnée, posée dans des termes rigoureusement identiques à ceux de Buisson et Sarkozy (immigration et identité nationale), avec la même rhétorique viriliste :
« Je veux que nous mettions la nation d’accord avec elle même sur ce qu’est son identité profonde, que nous abordions la question de l’immigration. Il nous faut l’affronter. »
Non content, donc, de n’avoir aucun courage, à commencer par celui d’assumer ses responsabilités de chef de la quatrième ou cinquième puissance économique mondiale, signataire des conventions internationales garantissant le droit d’asile, non content de n’avoir pas ce courage d’accueillir les migrants plus qu’ils ne le sont actuellement, d’assurer leurs droits mieux qu’ils ne le sont actuellement, de lutter contre les discriminations, non content donc de se dispenser de ce travail, de cet effort, de ce risque politique sans doute, et non content également de n’avoir pas même le courage de le reconnaître, d’assumer sa lâcheté, et par exemple de « regarder en face l’immigration » pour de vrai, c’est-à-dire de regarder en face non pas un « problème » abstrait (et factice) mais un migrant de chair et d’os, fuyant la mort, la misère, la dictature, la guerre, et de lui dire, en face donc, les yeux dans les yeux : « Non, on ne fera rien pour vous », notre président ajoute à cette double lâcheté une petite couche supplémentaire de veulerie, de pleutrerie, de tricherie : il jacte, il pérore, il se prévaut du courage alors qu’il cible les plus fragilisés – et qu’il fait d’eux non pas un cheval de bataille, mais un bouc émissaire. Honte à ce minable, détestable, criminel individu, et à tous ceux qui le servent ou le défendent.





