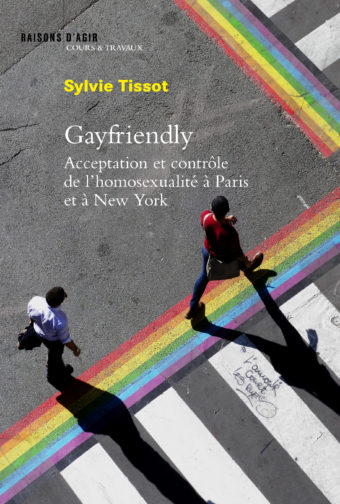
Partie 1. L’homophobie comme faute de goût.
Construite dans les années 1980 et 1990 en grille d’analyse de la question sociale en France, la « banlieue » a aujourd’hui pour fonction de désigner une série très extensive de « problèmes ». L’évacuation de la question des discriminations a accompagné cette construction politique, en reléguant dans l’invisibilité le racisme qui pèse pourtant fortement sur le quotidien d’une partie importante de la population qui y vit. Dans le même temps, dès le début des années 1990, le ciblage des « quartiers sensibles » repose sur une identification ethnique : le pourcentage de populations immigrées a été érigé en indicateur permettant d’identifier et de mesurer ce caractère « sensible ».
De sorte que la référence aux populations habitant en « banlieue » ou dans les « quartiers » permet aujourd’hui de désigner des populations racisées sans utiliser le langage racial : soit que le propos est tenu dans des univers où il est prohibé en théorie, soit que l’idéologie républicaine, et parfois certains sentiments antiracistes, contraignent les locuteurs à des catégories dites « color blind », ou aveugles à la race.
Les discussions sur la gayfriendliness donnent à voir la manière dont le langage spatial sert en réalité à dire la race, et ce à des fins de mise à distance. Loin de l’opposition fantasmatique entre une France « républicaine » et des États-Unis foncièrement « racistes », le langage de la race est, dans sa forme particulière, présent dans les pratiques et les catégories de pensée des classes supérieures françaises. Comment se fait-il qu’il apparaisse à l’occasion de discussions sur l’homosexualité ?
Les propos des enquêtés parisiens font écho à des discours largement repris dans les médias, notamment sur la base d’ouvrages et de statistiques produites dans le milieu associatif. Des rapports de SOS Homophobie parus en 2005 et 2006 mobilisent des chiffres biaisés mais qui viennent conforter l’idée, diffusée dans des livres à succès, d’une homophobie plus forte et spécifique à la « banlieue ». Comme cela a été le cas quelques années plus tôt quand la question des violences contre les femmes a été circonscrite à certains territoires et certaines populations racisées, l’homophobie figure désormais dans la longue liste des « problèmes des quartiers ».
Pointer du doigt cette construction politique et médiatique ne veut pas dire qu’aucune homophobie n’existe dans ces milieux : des enquêtes seraient nécessaires pour en dégager les formes spécifiques. Mon propos ici est de mettre en évidence le rôle que joue l’homosexualité dans des processus de stigmatisation (tout particulièrement des Arabes), qui s’inscrivent dans une histoire ancienne. Comme l’a étudié l’historien Todd Shepard, l’extrême droite française a façonné après l’indépendance algérienne une figure de « l’arabe » comme source de dévirilisation de la nation. L’orientalisme sexuel prend désormais une forme inversée : les populations racisées, notamment arabes, forment toujours une menace mais pour une valeur désormais associée à la République, l’acceptation de l’homosexualité.
Ainsi Patrick, habitant du Marais et agent immobilier, explique : « Chez les gamins des cités, je le vois quand je vais dans certains quartiers. “Pédé”, c’est une insulte. » Ici « cités » connote la race (surtout quand il s’agit de « jeunes », terme devenu synonyme de jeunes racisés), mais aussi la classe (par l’évocation d’un type de logements associé aux classes populaires). Son propos mêle en réalité espace, race et religion, et ce par l’intermédiaire du terme repoussoir de « communautarisme » :
« Moi, j’ai quand même vendu un loft à un couple de femmes, 45-50 ans, bonne situation et tout. Elles avaient un loft à côté du métro Couronnes [à la frontière des 11e et 20e arrondissements de Paris]. Elles sont parties, c’était pas possible. C’est l’atmosphère générale qui est devenue intolérante, c’est devenu ultra communautariste.
— Moins tolérante qu’avant ?
— Dans ces quartiers, oui, oui, bien sûr. Je pense qu’il y a des quartiers où il fait encore pas bon du tout être gai. Il faut pas s’afficher sinon vous vous faites casser la gueule, ou insulter. Ça, c’est sûr. Ouais, ouais. Et ça participe de ce communautarisme qui s’affirme autour des religions. Mais, c’est la même chose dans le 16e à la rigueur. C’est pas une religion en particulier. C’est un phénomène. »
Il y a bien chez Patrick une proclamation d’universalisme (toutes les religions sont source d’intolérance), sans doute liée au contexte de la Manif pour tous à laquelle il fait allusion peu après. Les termes « islam » ou « musulmans » ne sont pas prononcés, même si le quartier qu’il évoque correspond à la section de la rue Jean-Pierre Timbaud où commerces et lieux de culte rendent visible l’islam dans l’espace public. Pourtant le « à la rigueur » marque une certaine différence entre le catholicisme de la bourgeoisie du 16e arrondissement et l’islam des quartiers populaires.
Surtout, comme chez beaucoup d’enquêtés, le mot « communautarisme » permet ici de faire le lien entre la question musulmane et l’homophobie. Car dans les deux cas, il pose une limite à la visibilité dans l’espace public et aux revendications des groupes minorisés, sources potentielles de « ghettoïsation » et de « repli sur soi ». Ainsi interrogée sur le « communautarisme », Marie-Pierre s’exclame :
« Alors moi, personnellement, je suis contre le communautarisme. Vous ne m’avez pas posé la question, le burkini… Qui dit communautarisme, dit repli dans un ghetto, pour faire simple. Pour moi les choses et les gens doivent être ouverts, et pas du tout “on est entre nous, on a nos lois”, non, je suis contre. »
Cet entretien se déroule peu de temps après la polémique sur le burkini, qui éclate en France en 2016, et l’allusion à ce maillot de bain musulman dit bien que le communautarisme est ici associé à l’islam. Les injonctions morales adressées aux gays et aux lesbiennes sont moins fortes que pour les musulmans ; néanmoins on retrouve à travers cette rhétorique les mêmes exigences : la relégation dans le privé, et l’attente d’une certaine discrétion et modération politique.
Mais c’est plutôt sur des espaces étatsuniens qu’elle et d’autres enquêtés se focalisent. Le Bronx et le Queens, deux districts de la ville de New York qui forment des espaces diversifiés mais où habite une importante population noire, sont pointés du doigt comme posant problème du point de vue de l’homophobie. À ces deux espaces est opposé « Brooklyn », où ils habitent. Brooklyn est lui-même un district extrêmement divers et comprend des quartiers populaires, noirs et hispaniques, mais derrière sa « diversité », une même « acceptation » règne aux yeux des enquêtés : « À Brooklyn, il y a tellement plus de diversité, tellement plus d’acceptation », me dit Elizabeth, comparant Park Slope à l’Upper East Side, quartier traditionnellement huppé de Manhattan où elle a habité un an.
Le vocabulaire étatsunien de la « communauté » permet aussi un recoupement entre l’espace et la race, sans la connotation fortement péjorative associée, en France, aux communautés, pire encore au « communautarisme ». Ainsi plusieurs enquêtés new-yorkais interrogés sur l’homophobie évoquent-ils les « communautés noires » et les « communautés hispaniques ». Nicole m’explique que l’homophobie est « un enjeu ethnique » (an ethnic issue).
En France, la dénonciation du « communautarisme » et plus précisément l’évocation du « voile » chez les musulmanes sont autant de manières de s’alarmer du conservatisme des populations non blanches. Ainsi Stéphanie me raconte-t-elle s’être inquiétée d’une amie de son fils qu’elle connaît depuis l’école primaire et qu’elle voit, depuis le collège, porter le foulard dans le quartier. Sans évoquer les indices d’une violence subie par l’adolescente, elle m’explique avoir parlé d’elle à la principale du collège, s’offusquant que celle-ci se refuse à intervenir, et envisageant alors d’appeler le numéro dédié aux enfants en danger.
S’ajoutant à la cartographie dessinant des centres-villes gentrifiés tolérants et des quartiers pauvres où habitent des minorités racisées homophobes, une autre opposition est établie : celle qui oppose les grandes villes comme Paris et New York (auxquelles s’ajoutent les autres agglomérations étatsuniennes des côtes Est et Ouest) au reste du territoire.
Celui-ci est désigné en France à travers l’évocation de la « campagne », des « villages » ou encore des « petits bleds » mais aussi des « petites villes de province » où, selon les Parisiens, il ne fait pas bon vivre quand on est gai ou lesbienne et par conséquent naturellement enclin à venir s’installer dans des quartiers comme le Marais.
Celui-ci est bel et bien vu comme un refuge, à rebours de ce que montrent des enquêtes consacrées aux hommes gais habitant dans des zones rurales, où ils négocient des formes de visibilité et de reconnaissance. L’ignorance ou l’occultation de cette réalité complexe est rendue possible par l’homogénéisation de territoires définis avant tout par opposition à la capitale et par un certain mépris de classe, qui associe « la province » à l’absence de culture, au repli sur soi, et à l’obscurantisme.
Martine, universitaire, me dit, opposant clairement le quartier où elle habite et les espaces ruraux : « Évidemment, moi, je vis dans le Marais, alors je vois plutôt l’aspect tolérance de la chose. Dans la campagne ça doit être plus dur. » Frédéric, producteur à la radio, explique :
« Moi, je trouve ça moyenâgeux. Avec toute l’évolution de la société… Ils sont tellement réfractaires. Moi, je représente dans ma manière de vivre 5 % de la population française. Avec mes goûts. Je les vois à la campagne, les gens, c’est la campagne, quoi… Il y a internet mais les gens ont toujours aussi peur. »
Cet extrait d’entretien fait suite à un développement sur la Manif pour tous dont il occulte la dimension urbaine, pourtant censée garantir l’ouverture d’esprit. La cartographie étasunienne est légèrement différente, notamment parce que les territoires qui incarnent, en dehors des grandes villes, l’homophobie recoupent aussi les cartes mentales du racisme. C’est « le Sud », figure repoussoir sur laquelle revient la suite du chapitre 4.


