« Une rumeur provient du bas, échappe au brouaha
On entend alors clamer : Pas de justice, pas de paix »
La Rumeur, Pas de Justice, pas de paix

Peux-tu te présenter rapidement ?
Je m’appelle Mohammed Bourokba, j’ai 32 ans, je suis né à Perpignan, et j’y ai passé mes premières années. J’y ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire. Mes parents sont algériens, je suis d’une famille de 6 enfants, mon père était ouvrier agricole. C’est de là que je parle. Ensuite, je passe mon Bac, je monte à Paris, à la Cité U d’Antony plus exactement, et je m’inscris à la Sorbonne pour des études de lettres et de cinéma. J’y passe quelques années, et je finis sur un DEA de sociologie des médias que je ne valide pas, parce qu’on est au moment où La Rumeur nous prend tout notre temps : disques, tournée, etc. Je reprends par contre un master de recherche cinématographique quelques années plus tard, en 2007...
Comment arrives-tu à « Lettres /Cinéma ? » À l’école, tu es un très bon élève ?
Pas au moment du bac. J’étais le premier de la classe jusqu’en seconde, mais j’ai très mal vécu ma première et ma terminale en section scientifique. Je n’avais qu’une hâte, c’était d’en finir et de revenir à ce que je n’aurais jamais dû perdre de vue : l’enseignement littéraire et artistique.
Le Bac scientifique, c’était un passage obligé en tant que bon élève ?
Oui, on m’avait vendu le Bac C comme étant la voie royale. Mon entourage, les professeurs, mon grand frère aussi… Il avait toujours eu de très bons résultats, il avait suivi la filière scientifique, puis polytechnique...
De ton côté, le goût pour les enseignements littéraires, ça te vient comment ?
Mes premiers livres, ce n’est ni mon frère, ni mes parents ni l’école, ni la bibliothèque... Ce sont mes grandes soeurs, qui ont toujours aimé les livres, en particulier les romans. Chez nous, il n’y avait pas de livres, pas de journaux, mes parents sont analphabètes. Il n’y avait pas de culture écrite, de culture lettrée, on se l’est donc inventée. Et ce sont mes sœurs qui ont apporté ça. Je les voyais souvent avec des bouquins, qu’elles étaient tenues de lire parce qu’ils étaient au programme, mais qu’elles lisaient avec un immense appétit. Comme si elles avaient pu, en ouvrant des livres, se payer des voyages qu’elles ne pouvaient pas se payer dans le réel. Et comme j’ai toujours eu un amour immodéré pour mes soeurs, tout ce qui brillait à leurs yeux brillait forcément aux miens. J’ai vécu dans ce monde de femmes, de femmes arabes. J’ai juste un frère. Le monde de mon enfance, c’est vraiment le monde de mes soeurs. Ce n’est pas le monde de mon père ou de ma mère, c’est le monde de mes grandes soeurs – mes demi-sœurs en fait, parce qu’on est une famille recomposée. On a un écart de plusieurs années, de cinq à dix ans, entre mes trois demi-soeurs, d’un premier mariage de mon père, et puis mon grand-frère, moi et ma petite sœur qui sommes les fruits de son deuxième mariage. Donc quand j’ai sept ou huit ans, mes grandes soeurs vont au collège. Et le premier bouquin qui m’a marqué, c’est justement un héritage de mes grandes sœurs, c’est le recueil de Prévert, Paroles.
Je devais avoir 7 ou 8 ans. Je me souviens d’un poème bien précis : Le Cancre. Je me souviens de la couverture, avec la tête de Prévert. Le truc traînait comme ça dans leur chambre. Chez nous, il n’y avait que 4 ou 5 livres : Les Fourberies de Scapin, parce que c’était au programme du collège, peut-être Les Fleurs du Mal, et puis Paroles, donc. On avait très peu d’argent, on ne pouvait pas s’acheter de livres. Mon père gagnait 4000 francs par moi, ma mère ne travaillait pas, avec les allocations familiales, on vivait donc avec 6 ou 7 000 francs par mois, à huit. On n’était pas dans une cité, c’était dans une bourgade au nord de Perpignan, des petits pavillons ouvriers. On était la seule famille arabe du coin. Dans le voisinage, il y avait beaucoup de pieds-noirs, c’était la particularité du lieu.

Pour revenir au poème de Prévert, je retiens l’image du cancre qu’on met au fond de la classe, qu’on réprimande et qui, en regardant par la fenêtre, s’évade... Je ne m’en souviens pas plus, je ne pourrais pas le réciter, mais je me souviens des images. J’ai dû voir plusieurs fois mes soeurs se refiler le bouquin et se le réciter l’une à l’autre. Et moi, qui étais tout minot, je m’identifiais au cancre qui regarde la fenêtre, les oiseaux, la liberté, par delà la salle de classe... Parce que me suis vraiment beaucoup ennuyé à l’école, et je m’y suis souvent senti humilié...
Dès cet âge là ?
C’est paradoxal, parce que j’ai toujours eu de très bons résultats, j’ai toujours fait partie des meilleurs, voire j’étais le meilleur. Mais je me suis vraiment beaucoup, beaucoup ennuyé... Et puis j’ai le souvenir d’humiliations frontales, parce que je suis arabe, parce que je suis le petit arabe premier de la classe et que pour certains professeurs, c’est insupportable. En particulier un professeur de CM1, un ancien d’Algérie, qui ne pouvait pas supporter que je sois premier de la classe, et qui, pour ma promotion, avait spécialement créé un classement ex-aequo : je ne pouvais pas être le seul premier de la classe, il fallait forcément que quelqu’un, un élève blanc, soit premier ex-aequo avec moi ! C’était un prof qui avait une conception extrêmement fermée de l’enseignement et de la classe, qui créait des murs. Il avait créé des groupes de niveau. Le premier groupe, c’était les élèves méritants, les meilleurs. Le second, c’était la « classe moyenne », et avec les troisième et quatrième groupes, on descendait vraiment vers les cancres, vers le zéro absolu ! Et dans le dernier groupe, on retrouvait tous les arabes, les gitans, les portugais et les espagnols... Tandis que dans les deux premiers groupes, on retrouvait les enfants des propriétaires terriens du coin, la fille du maire, la fille du médecin… J’étais le seul arabe, et le seul fils de pauvre dans le groupe 1.
Ta première expérience du racisme, c’est celle-ci ? C’est l’école ?
Oui, je n’ai aucun souvenir d’avoir été victime de racisme avant ce souvenir. Ce prof, je me souviens encore de son nom, de son visage. En CE1, le prof était aussi un ancien d’Algérie, mais lui, au moins, était beaucoup plus retenu.
Tu le savais dès cette époque, que c’étaient des anciens d’Algérie ?
Non, je l’ai su après. Je ne comprenais pas encore, à cet âge là tu ne comprends pas, tu penses que l’adulte devant toi a toujours raison, même si parfois tu ne comprends pas... En CE1 par exemple, on m’apprenait que nos ancêtres étaient les gaulois. Et ça, déjà à l’époque, je ne comprenais pas... Ma première leçon d’histoire, c’est ça : Vercingétorix, avec des images d’Épinal façon troisième République ! Cette histoire de France mythologique, bien homogène, avec ses Gaulois, ses Francs, puis ses Rois… Mais cette incompréhension, c’est quelque chose qu’à l’époque je garde pour moi. Je ne sais pas quoi en faire. Quand je quitte la salle de cours, mon premier soucis, c’est d’aller taper dans le ballon ou de jouer à cache-cache.
Jusqu’à ce jour en CM1, donc. C’était un après-midi, pendant une leçon d’histoire. Généralement, le professeur se contentait soit de dicter la leçon, soit de l’écrire directement au tableau. Mais là, exceptionnellement, il me demande à moi d’aller écrire la leçon au tableau. C’était une leçon qui portait sur la conquête de l’Algérie, de 1832 à 1847, de l’arrivée de l’armée française jusqu’à la capitulation d’Abd-el-Kader… J’ai compris bien plus tard. J’avais oublié cette anecdote, et je ne m’en suis resouvenu qu’avec le procès. C’était en novembre 2004, avant le premier jugement en Correctionnelle. Mon avocat m’avait proposé de me livrer à un exercice : lui écrire sur dix pages des choses de ma vie, des anecdotes, pour préparer sa plaidoirie, en croisant des éléments politiques avec des éléments biographiques. C’est pendant ce travail d’écriture que ce truc m’a explosé à la gueule, d’un coup. C’est venu après, en fait, une fois que j’avais écrit, je ne crois pas que je l’ai écrit à l’avocat. Le prof m’envoie donc au tableau, pour écrire la leçon sur la capitulation d’Abd-el-Kader, qui marque le premier mouvement de l’expropriation et de la colonisation de l’Algérie par l’armée française, avec tous les massacres, tous les crimes que ça implique.
Mais ce ne sont pas ces mots là, expropriation, massacres, qu’il y a dans sa leçon…
Non, ce que je dois écrire, c’est une leçon à la gloire de la colonisation. De manière pudique, mais qui en fait quand même l’apologie. Et le pire, c’est que sur le coup, je ne vois pas où est le problème : c’est moi qu’on envoie au tableau, et ça ne pose pas question, ça va de soi. On n’avait jamais parlé de la guerre d’Algérie dans la famille. La première fois que j’en ai entendu parlé, c’était peu de temps après, je devais avoir 8 ou 9 ans. J’étais en vacances en Algérie et un de mes oncles me dit : « Tu vois, même si on n’a pas grand chose, on a gagné les Français ! Même les Allemands ont pas gagné les Français. Nous on l’a fait ! ». Je me souviens que ça m’a marqué, et que je suis allé demander confirmation à ma mère.
Donc, quand j’écris la leçon au tableau, je suis fier, parce que pour moi c’est une récompense. Sur le coup, je ne le vis pas comme une humiliation. Je suis même fier, parce que j’écris « Algérie » au tableau : on parle de l’Algérie, donc on parle de moi, et c’est moi qui l’écrit au tableau. Et quand je retourne à ma place, le prof nous fait répéter la leçon, un peu comme dans les écoles coraniques où tu annones ce qui est écrit. Donc plusieurs élèves ont lu à haute voix ce que j’avais écrit, et c’est là que j’ai eu comme un petit malaise. Ce n’est pas de la clairvoyance, basée sur une analyse précise, c’est quelque chose d’intuitif. Je regagne ma place, je m’efface, le prof reprend sa place de prof, et plusieurs élèves, en choeur je crois, récitent la leçon.
Et à ce moment là, il y a comme une gêne... C’est la première fois que j’ai ressenti la honte d’être ce que je suis, c’est à dire d’être arabe, et de venir d’un lieu, qui, dans l’espace et dans le temps, est un lieu de vaincus, de gens défaits, qui sont en bas, qui ne gagnent jamais. Je ne sais pas si ça s’articule comme ça avec la réponse de mon oncle, mais je me souviens de ce que ça fait, de la marque que ça laisse, une marque qui t’irradie le plexus, qui descend et t’irradie les jambes. Ce sentiment, cette sensation, plutôt, elle a un nom : c’est la honte. Cet épisode, avec la première leçon sur « nos ancêtres les gaulois », c’est le point de départ d’un sentiment négatif forgé sur soi-même. Pas sur une bêtise que tu fais quand tu es môme, pas sur un choix ou une maladresse, mais sur ce que tu es, sur toi-même.
Tu penses à d’autres livres qui t’ont marqué ?
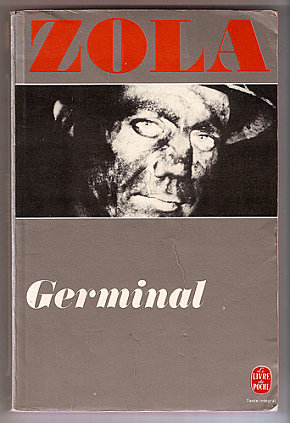
Germinal, en 5ème. C’est le premier livre que j’ai vraiment lu par moi même. Le premier pavé... J’avais une prof de français dont j’étais amoureux, ce genre d’amour platonique qu’on a dans l’enfance, une prof de français très maternelle, très « prof », et qui était communiste. Elle nous avait parlé de ce livre et de Zola, et je m’étais promis d’aller à la bibliothèque à la recherche de ce livre. J’arrive à la bibliothèque et je tombe sur un énorme pavé ! Je ne sais plus quelle édition c’était, mais le livre était vraiment énorme, donc ça m’a un peu intimidé. Mais je l’ai emprunté, et j’ai renouvelé l’emprunt plusieurs fois, de quinze jours en quinze jours, pour le lire jusqu’au bout. Au total, j’ai dû le squatter trois mois ! Mais je l’ai lu jusqu’au bout.
Et ce dont je me souviens, c’est un des fils de la famille des mineurs, qui a eu un accident dans la mine. Il a une jambe paralysée à vie, qui l’empêche de retourner au fond de la mine. Et donc c’est un enfant qui, quand tout le monde est au travail, erre, rôde et explore les corons. J’ai gardé l’image de cet enfant qui sort d’une mine abandonnée et qui court au milieu des tas des charbons, en boitant. Et je pense que ça fait écho à mon père, qui a eu un accident de travail au début des années 50, qui a dû rester un an à l’hôpital. Il a perdu sa rotule, il a une broche qui lui maintient la jambe, et il a toujours boité. Du coup, j’associe Germinal, les souffrances de la classe ouvrière, de ses personnages, aux souffrances de mon père. Pour moi, c’est mon premier « vrai livre ». Même si, au sens strict, le premier livre que j’ai lu, c’est Belle et Sébastien. Mais il m’a moins marqué…
Et le cinéma ? Quand, et comment, deviens tu cinéphile ?
Je ne deviens vraiment cinéphile qu’à la fac. Quand je m’inscris à la fac, j’ai une culture cinématographique minable.
Mais suffisante pour aimer ça et t’inscrire en cinéma...
Oui, j’ai en fait une culture cinéphilique qui vient de la télé. Il y avait bien sûr une salle près de chez moi, mais c’était toute une histoire pour y aller, et puis c’était cher. Ma culture, c’est vraiment la télé, « La dernière séance » d’Eddy Mitchell, le film du dimanche soir sur TF1... Les Westerns de Sergio Leone, les Charlie Chaplin… Et puis plus tard, au lycée, il y a Spike Lee. Do the Right Thing et Malcom X, que je vois en salle, en même temps que je découvre le rap, notamment Public Enemy.
Tu découvres le rap par quel biais, sur quels médias ?
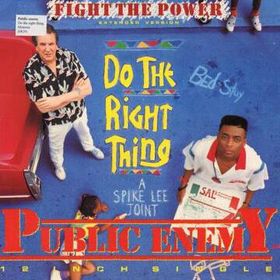
Il y a une émission de radio locale sur Perpignan, animée par un disquaire qui arrive à chopper des imports. Il y a aussi un magazine gratuit, L’affiche, qui devient ensuite payant, et puis Rapline sur M6. Et puis il y a une émission sur la cable, Yo ! MTV rap, qu’on va regarder à plusieurs dans un fast-food qui s’appelle « Les 3 F », les trois frites ! On découvre ça avec des copains du lycée et des voisins. Il y a Ali, et puis les autres, ce sont des asiatiques et puis deux français de classe moyenne. Ca fédère : des asiatiques, un feuj, deux franco-français... Je flashe assez vite sur Public Enemy, mais en passant d’abord par la « médecine douce » : un rap plus cool, plus mélodique, avec un contenu plus abstrait, plus pacifiste, comme A Tribe Called Quest, De La Soul, les Jungle Brothers…
Avant ça, tu t’intéresses à la musique ?
Non, pas vraiment. Je ne sais pas ce que c’est que la musique, je n’y ai pas accès. Par le biais de mes grandes sœurs, j’ai un peu écouté deux groupes de rock : U2, « Sunday Bloody Sunday », et Midnight Oil…
C’est déjà de la musique engagée...
C’est l’influence de mes soeurs, elles adoraient la chanson à message, U2, Midnight Oil, Aznavour aussi.
C’est moins engagé, Aznavour...
Pour moi c’est engagé, dans la mesure où il rend visible des gens qui jusque là étaient invisibles. Il y a beaucoup d’immigrés ou d’enfants d’immigrés qui aiment Aznavour, parce qu’il parle de la Mamma...
Mais ce n’est pas le même engagement que U2 ou Midnight Oil, qui réagissent par rapport à des événements...
Et qui rédigent même des manifestes, des appels à se rassembler et à lutter. C’est sûr. C’est un autre type d’engagement, ce sont presque des animateurs de manifestation.
Donc la musique engagée, c’est aussi un truc qui te vient par le biais de tes sœurs.
Oui. Elles n’avaient pas la possibilité de sortir, ma mère ne voulait pas. Elles ne pouvaient pas aller en boîte, fréquenter les réseaux du rock alternatif – c’était cette époque-là... Mais oui, par mes soeurs, il y a le goût de certains trucs qui m’est passé, une sensibilité, un goût du refus et de l’engagement... Je m’identifiais beaucoup à elles, donc aussi à ce qu’elles aimaient... Je voudrais revenir là-dessus : je fais partie, avec mes frères et soeurs, de la première génération depuis au moins trois siècles, qui a eu accès à l’instruction, à l’écriture, à la lecture. C’est violent, ça ne va pas de soi de ne pas être là où tes origines sociales, géographiques et ethniques devraient te faire être. ça n’a radicalement rien à voir avec ce que mon père a vécu, avec les succès qu’ils ont eus, ceux qu’on leur a laissé...
Ce goût pour les études, c’est l’émulation créée par mes soeurs, qui étaient en révolte contre ce qu’elles appelaient « le beauf rebeu ». Ce personnage du « beauf rebeu », ou du « mec du bled », revenait souvent dans les discussions qu’elles avaient entre elles et que je captais. C’était une figure qui représentait à leurs yeux l’impossibilité pour elles de s’émanciper : le mec qui va venir du bled pour les épouser, se faire faire des papiers et leur faire trois ou quatre mômes, et les enfermer. Pour elles c’était hors de question. À leur contact, j’ai donc connu très tôt ce sens de la révolte, de la résistance à l’enfermement, ce refus d’un destin déjà écrit. Elles pouvaient passer deux heures à parler entre elles de leurs aspirations, de leurs craintes, de leurs révoltes. Et même si je n’avais que cinq ou sept ans, même si je ne comprenais pas intellectuellement tout ce qui se jouait dans ces moments, c’étaient des personnes que j’aimais et que je voyais non pas conspirer, mais se mobiliser et s’encourager mutuellement à ne pas se laisser faire. Leur posture de refus du patriarcat, je crois que c’est le fondement de ma propre posture et de mes propres refus.


