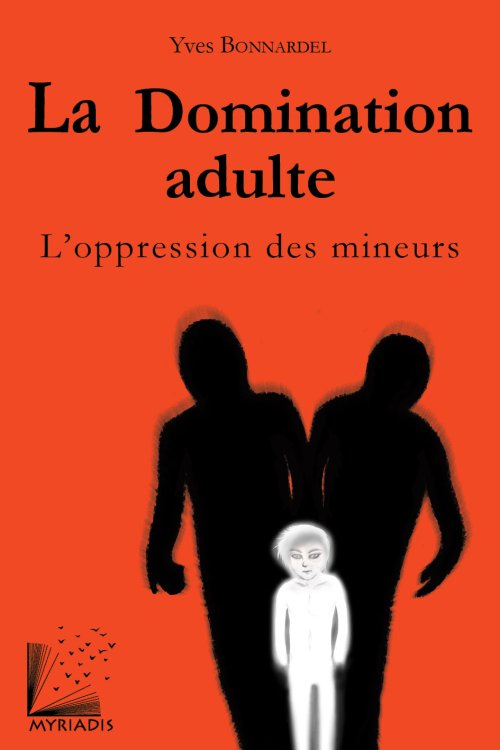Partie précédente : « L’intérêt supérieur de l’enfant »
En accord avec le sens commun, nous considérons connaître de façon spontanée et immédiate ce qu’est un enfant, par observation directe et quotidienne des multiples spécimens que nous voyons s’agiter sous nos yeux. N’avons-nous pas nous-mêmes été enfants ?
Pourtant, il semble bien que nous n’accédons au statut d’adulte qu’en oubliant justement une part importante de ce que nous éprouvions, de ce que nous avons vécu.
Le passage graduel à « l’âge adulte » (au statut de majeur, précisément) s’effectue par distanciation continuelle vis-à-vis de ce qu’on a « été » avant. Le petit garçon de sept ans méprise ce qu’il pensait et ressentait à cinq ans comme ayant été le fait d’un « petit », et sera lui-même devenu ridicule et honteux aux yeux de celui qu’il sera devenu à huit ans, et ainsi de suite. Il s’agit là d’un effet important, mais bien rarement pris en compte, de la structuration de l’enfance par classes d’âge.
Un processus de dénigrement et de dissociation parcourt et hante ainsi le temps de l’enfance – on retrouve la dévalorisation de soi à laquelle sont confrontés tous les dominés humains, mais polarisée ici sur un critère d’âge. L’enfant est habité par l’espoir d’arriver, au bout d’un hélas long parcours, à un état complet, parfait, abouti – enfin respectable et respecté : l’état d’adulte. Le processus de dissociation d’avec son passé implique l’oubli progressif, le déni ou la dévalorisation d’une bonne partie de ce qu’il a pu auparavant vivre, réfléchir, imaginer, rêver et réaliser. Celui qui arrive à l’âge de la majorité généralement ne se souvient plus précisément de ce qu’il pensait et ressentait plus jeune.
Ce processus est encouragé par les adultes, qui n’en ont d’ailleurs bien souvent guère conscience (ils ont dû eux-mêmes l’intégrer si jeunes !). Les enfants pas plus que les adultes n’aiment le mépris et la condescendance. On a oublié la honte qui était attachée à l’idée que nous étions enfants. Les adultes font subir en permanence des humiliations aux enfants en tant qu’enfants, qui sont autant de blessures que ces derniers chercheront à oublier : il y a les plaisanteries, les moqueries, ces petits rires ou ces sourires en coin lorsqu’un enfant fait ou dit quelque chose, et ces humiliations que les adultes (ou les « plus grands ») leur infligent quand ils les « font marcher », par exemple quand ils leur font croire des choses fausses et s’en amusent ensemble, complices.
Ces amusements confortent les adultes dans leur supériorité : ils ont la connaissance, le savoir et la raison et ne gobent plus n’importe quoi, contrairement aux « petits » ! Et, bien sûr, ils confortent les enfants dans leur infériorité. Pour beaucoup d’entre nous, apprendre que le père Noël n’existait pas, par exemple, a été une immense déception, une incompréhension aussi (pourquoi nous ment-on et nous raconte-t-on des choses pareilles ?), et par-dessus tout une profonde humiliation : on s’était, « bêtement », laissés tromper. D’une histoire aussi « innocente », on a ainsi appris que devenir adulte, c’est cesser de « se faire avoir », et c’est au contraire se permettre d’« avoir les autres », ceux qui sont sous notre coupe.
Il me semble qu’on doit pouvoir analyser de même le monde des bisounours qui est présenté avec insistance aux plus jeunes enfants par le biais des « livres pour enfants » ou des dessins animés de la télévision : un monde irréel, gentillet, qui confine à la crétinité, qu’on justifie en disant que les « petits » aiment ça (mais ils aimeraient certainement bien d’autres choses) parce qu’ils sont eux-mêmes « cucul » (ce qui est faux, à moins qu’on ne les y incite), et parce qu’il faut les protéger de la violence du monde (mais en la leur masquant et en leur refusant les moyens de penser celle dont ils sont victimes ?). Bref, un monde où des animaux humanisés et niais expriment en détail justement cette sorte d’innocence plus ou moins idiote que les adultes projettent sur les enfants.
La plupart des jeunes enfants sont fascinés par « les animaux », et le monde univoque, gentil et frivole de Walt Disney est nécessairement plaisant : ils adhèrent à la vision du monde qui leur est présentée, mais s’aperçoivent progressivement qu’elle est continuellement raillée comme une marque d’immaturité par les plus grands ou par les adultes. Grandir, ça signifie donc encore se désolidariser de celui qu’on a été avant, prendre de la distance par rapport à ces modèles fournis par des figures animales (c’est aussi un moment, bien souvent, où l’on commence à réaliser que dans la réalité, pour ces gentils animaux, c’est la boucherie), et s’éloigner du monde des bisounours, faire le deuil de ce qui apparaît désormais comme des illusions. Faire celui qui a compris que le vrai monde n’est pas de la tarte et qui en prend « adultement » son parti.
On passe donc d’enfant à adulte. Qu’est-ce qui distingue les deux ? On a tôt fait de répondre que devenir adulte se caractérise par la prise de liberté, prise d’autonomie, prise de responsabilité, etc. Mais ces prétendues « prises de... » s’avèrent plutôt des libertés progressivement octroyées. L’adulte est celui dont l’éventail de choix s’est considérablement étendu, et qui est devenu relativement respecté.
« Grandir », c’est ainsi se voir autoriser des activités toujours plus nombreuses. L’avancée en âge, d’année en année, de classe en classe, scandait notre vie, et signifiait davantage de droits, un accès accru à des biens ou à des comportements jusque-là prohibés. L’enfance est un temps rythmé par des acquisitions, banalisées ou au contraire fêtées comme significatives.
Pas de jurons ni de gros mots pour les enfants, c’est une règle quasi absolue, en particulier pour les petites filles : « Ce n’est pas beau pour une petite fille de dire des gros mots ! » Les gros mots sont des attributs masculins et adultes. Les filles qui disent des gros mots sont vulgaires : ce sont les prostituées ! Et les jeunes garçons qui disent des « gros mots », que sont-ils ?
Qu’est-ce qu’un « gros mot » ? C’est presque toujours un terme, insulte ou non, à connotation anale ou sexuelle. Il ne faut pas dire « merde ! », mais « mercredi ! ». Non pas « putain ! », mais « purée ! ». Quelle logique derrière tout cela ? Ne pas dire « merde »parce qu’on n’est pas un petit animal, qu’on doit se civiliser ? Ne pas dire « putain »parce que tout ce qui touche à la sexualité est sale, ou doit rester le privilège des adultes ? Quant aux jurons, une analyse nous indique qu’ils constituent un jugement sur le monde : « saloperie ! », « putain de merde ! », que seuls les dominants auraient autorité à faire valoir [1]…
De même, certains sujets de discussion sont réservés aux adultes :
« Il faut souligner la différenciation des sujets de conversation, certains thèmes étant reconnus comme l’apanage des adultes : politique, économie et actualité en général. Fréquemment les enfants s’entendent dire : « C’est une discussion de grandes personnes », « Tu comprendras quand tu seras grand-e », les excluant ainsi des conversations jugées « sérieuses ». Pour les plus petit-e-s, l’argument invoqué est qu’ils-elles ne comprennent pas, ne maîtrisent pas ce type de notions abstraites, mais en même temps comment le pourraient-ils-elles puisqu’on ne veut pas les leur expliquer ? Pour les adolescent-e-s, cette raison est plus difficile à invoquer, au vu des enseignements en histoire, géographie et donc géopolitique, éducation civique, juridique et sociale, sciences économiques et sociales pour certain-e-s. J’ai pourtant constaté à l’occasion de repas de famille que des jeunes de 16 et 17 ans étaient écarté-e-s des conversations portant sur les élections présidentielles à venir : toutes leurs tentatives de prises de parole ont été avortées (interruption, absence de réponse). [...] Les sujets de conversations des enfants semblent ne devoir porter que sur des domaines mineurs, voire pour les petits enfants quasi uniquement sur leurs expériences vécues, excluant tout sujet d’abstraction ou de réflexion : s’ils-elles peuvent raconter leur journée passée avec des ami-e-s ou ce qu’ils-elles ont appris à l’école, il semble qu’on leur reconnaisse difficilement un avis sur une chose ne les concernant pas directement (« Qu’est-ce que t’en sais ? ») [2].
Les enfants se débattent ainsi dans une toile tissée de restrictions et de tabous, d’obligations et d’empêchements. Une amie mineure témoigne et analyse ainsi :
« Du coup, tout ce qui nous était interdit nous paraissait enviable, parce que c’était interdit ! C’est comme ça qu’on tombe dans le piège, et qu’on envie les plus grands, et qu’on devient progressivement adultes ! C’est comme ça qu’on en vient à faire les pires bêtises : accepter les récompenses des parents et des profs (des sous, des images, et quand on en a dix, on a droit à une grosse image…), vouloir passer dans la classe « supérieure », avoir le bac (une grosse image censée nous permettre de s’en procurer de plus grosses encore par la suite…), passer le permis et conduire une voiture, dépenser des sous, en gagner (ça coûte vraiment cher, les sous !), aller vivre ailleurs que chez ses parents (ouf !)… Mais aussi le premier baiser, la première pénétration sexuelle, se mettre en couple plus tard et, consécration finale, apothéose, avoir des enfants : là, c’est le passage définitif au statut d’adulte, on est vraiment responsable, on reprend le flambeau, le piège se referme, la plante carnivore nous a gobés et se prépare déjà à avaler les suivants. »
On devient majeur à dix-huit ans, mais on devient progressivement « adulte » au fur et à mesure qu’on prend de l’âge et qu’on se soumet à une plus grande diversité d’exigences [3] – sans quoi on risque fort d’être qualifié d’« enfant perdu », « enfant à problèmes », « mineur en difficulté » ou, dernièrement, de « psychotique », « hyperactif »… et d’être traité « comme tel ». On devient adulte en acceptant de rouler sur l’un des multiples rails constituant le grand réseau de voies ferrées qui tisse la trame de la société tout entière.
Dans la religion chrétienne, il faut idéalement être toujours plus chrétien, tendre en permanence vers la sainteté. Pour les humanistes, il faut devenir plus humain, ou à tout le moins veiller à rester humain, quoi que ce soit qu’on entende par là : être moins animal, bestial, bête, sale, désordre, insensé, irresponsable, barbare, monstrueux, etc. La religion qu’on impose aux enfants, c’est de devenir toujours plus adultes.