Première partie Deuxième partie
Troisième partie Quatrième partie
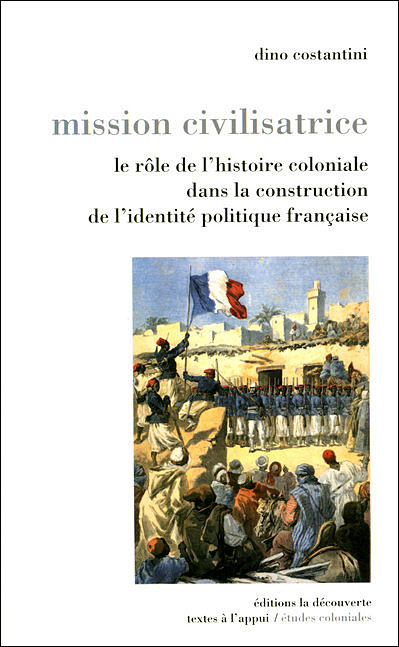
La colonisation en tant que civilisation
« s’écarte avec netteté des conceptions d’autrefois qui étaient limitées aux intérêts du négoce et qui, par suite du manque de tout horizon humain, aboutissaient à une exploitation systématique et presque impitoyable des populations administrées [1]. »
Cette « nouvelle » [2] doctrine de la colonisation reconnaît, à côté des sacro-saints droits de la puissance colonisatrice, ses devoirs envers les populations soumises, des devoirs qui deviennent chaque jour plus précis et urgents et apparaissent d’autant plus méritoires que leur réalisation est estimée difficile. Selon Georges Hardy :
« le mot de Colonisation […] risquerait de perdre tout sens vraiment précis, si l’on n’y voyait, en fin d’analyse, non point tant l’établissement de colons en pays soumis ou la subordination d’un pays à un autre que la prise en charge d’un groupement momentanément faible par un organisme plus fort, avec le dessein, plus ou moins égoïste, plus ou moins altruiste, de développer les ressources de ce groupement et d’élever son niveau de vie [3]. »
La colonisation en tant que civilisation naît du constat de l’existence de populations dotées de niveaux de « force » différents, lequel impose comme devoir à la société plus forte, plus avancée ou plus civilisée la prise en charge de celle plus faible. La colonisation se conçoit donc comme l’action tutélaire exercée par les populations civilisées pour prendre en charge le retard des groupes humains les plus faibles. Selon Arthur Girault, cette action tutélaire est l’objet d’un savoir spécifique, d’un véritable « art de la colonisation [qui] peut se comparer à une œuvre d’éducation [4] » :
« Coloniser c’est […] éduquer les indigènes, les faire évoluer vers le stade de notre civilisation, […] peut-être faire naître des difficultés imprévues pour eux mais, en tous les cas, la barbarie primitive aura cédé devant la civilisation [5]. »
La colonisation est l’acte par lequel les sociétés plus évoluées se font sujets actifs et conscients du procédé éducatif qu’est la civilisation du monde, en prenant en charge les responsabilités dérivant directement de leur degré supérieur d’évolution.
Le caractère tutélaire constitue l’aspect majeur de la relation coloniale de cette période et la raison de sa supériorité morale sur la colonisation des origines. Selon René Maunier, le colonialisme ancien se distinguait par son caractère de domination violente, d’imposition d’une « autorité illimitée, impartagée, intempérée » :
« Dans l’ancien temps, les colonies avaient ce but de dominer, de régenter ces pays éloignés, ou leurs populations, pour nous exprimer mieux : de les subjuguer sans contrôle aucun [6]. »
Selon lui, le type de domination exercé par le colonialisme des origines avait comme modèle le pouvoir paternel tel que défini par le droit romain, c’est-à-dire la soumission absolue des fils au pater familias. L’ancienne domination coloniale, construite sur le modèle d’une « paternité puissance » dotée d’un pouvoir sans réserve et sans entrave, se réduisait à l’exercice d’un pouvoir sans autre but que lui-même et sa reproduction.
Au cours de son histoire, la colonisation s’est de plus en plus éloignée de ce modèle primitif. Toutefois selon René Maunier, l’analogie avec le pouvoir paternel n’a pas disparu, mais s’exprime dans une tonalité différente :
« Aujourd’hui, l’idée de la paternité a pris un autre tour ; il faut parler non plus de la paternité puissance, mais bien de la paternité tutelle, usant du mot, parfaitement, au sens qu’il a en droit civil [7] »
L’institution de la tutelle est définie par le droit civil comme une mesure de protection, qui intervient à partir de la reconnaissance de l’incapacité d’agir d’une personne. La tutelle des mineurs s’exerce en cas de carence du pouvoir parental – lorsque les parents sont décédés ou pour toute autre raison empêchant son exercice. Dès lors, les fonctions du tuteur sont de protéger la personne du mineur, de le représenter dans tous les actes civils et d’administrer ses biens. Le passage du droit du père, qui dans l’Antiquité exerçait le pouvoir dans son propre intérêt, au concept moderne de fonction est l’un des développements marquants de l’évolution du droit civil [8].
De la même manière, le passage de la « paternité puissance » à celui de la « paternité tutelle » est considéré par René Maunier comme caractéristique de la relation coloniale de cette période. Modelé sur le modèle de la paternité tutelle, le pouvoir colonial ne peut être considéré comme une fin en soi, mais comme mû par une finalité de caractère éminemment moral :
« Car de nos jours le dominant, qui reste dominant, qui se prétend toujours le maître et le seigneur, qui croit toujours régner, ou tout ou moins régir, tient pourtant que son pouvoir a pour raison de remplir un devoir : de procurer à ses sujets ou le salut, ou le bonheur, ou le confort [9]. »
Comme le pouvoir tutélaire, le pouvoir colonial est un « pouvoir devoir [10] », un pouvoir tempéré, qui trouve sa limite dans la nécessité de satisfaire sa fonction, celle de pourvoir au bien du sujet en tutelle :
« pouvoir pour le devoir, moyen d’un but, ou instrument d’une fonction ; pouvoir ayant pour rôle et pour mission l’éducation des peuples subjugués. Pouvoir-tutelle donc, car la tutelle aussi a pour raison l’éducation de l’enfant “gouverné”, dans le vieux sens du mot [11]. »
L’analogie entre pouvoir paternel et pouvoir colonial se fonde sur l’équivalence, d’une part, entre les peuples colonisateurs et l’adulte, pleinement rationnel et capable de maîtrise de soi, et, d’autre part, entre les peuples colonisés et l’enfant, être encore immature, irrationnel, incapable d’agir de manière autonome. L’incapacité d’agir ne concerne par les colonisés en tant qu’individus – auxquels peut-être reconnue une maturité plus élevée – mais l’ensemble du groupe.
Penser le pouvoir colonial à travers le modèle du pouvoir paternel signifie donc considérer les peuples colonisateurs comme des « peuples adultes », pouvant agir librement et rationnellement, et les peuples colonisés comme des « peuples enfants », incapables d’agir collectivement de façon rationnelle et nécessitant donc un pouvoir tutélaire pour les diriger vers leur propre bien.
L’illustration la plus évidente de l’immaturité des « peuples enfants » est la misère proverbiale prévalant avant l’intervention de la puissance colonisatrice :
« Un peu partout, avant notre installation, l’indigène menait une vie misérable, inconfortable au possible [12]. »
La raison de cette misère est politique. Ces peuples ne connaissent pas ce qui pour la tradition française est la « seule » forme politique légitime et rationnelle : l’État-nation. Les sociétés non européennes (dont on reconnaît la pluralité et la différence) peuvent ainsi être présentées comme un tout indistinct, uni par le dénominateur commun qu’est leur incapacité politique. Quand elles ne vivent pas dans la plus complète anarchie, les populations non civilisées ne sont capables de développer que des structures politiques primitives et despotiques, qui les condamnent à une insécurité endémique :
« Avant l’occupation européenne, nulle colonie ne connaissait ce qu’on entend ici par indépendance. Toutes vivaient sous la poigne de dynasties despotiques ou dans une anarchie qui permettait simplement aux forts de tyranniser les faibles. Elles étaient continuellement ravagées par des guerres, des massacres, des pillages, des enlèvements en masse, et c’est cette inquiétude même, plus encore que les conditions du milieu naturel, qui, de siècle en siècle, les a maintenues dans l’infériorité et la misère » [13].
Le caractère tyrannique des structures politiques préexistantes à l’occupation européenne est à l’origine d’un droit d’intervention des pays civilisés et démocratiques, un droit que Joseph Folliet interprète comme un devoir envers l’humanité :
« L’un des principaux motifs qui permettent l’exercice de ce droit, c’est la présence, chez un peuple, d’une tyrannie intolérable écrasant la masse ou une notable partie des citoyens. Chez certain peuples “sauvages”, il arrive que cette tyrannie se rencontre sous différentes espèces : sacrifices humains, anthropophagie, traite des esclaves, ainsi de suite. Dans ces conditions, la charité fait un devoir aux peuples mieux évolués de prendre la défense des faibles, de les secourir et de les libérer, même par la force si des résistances injustes dressent leurs obstacles [14]. »
L’existence de sociétés tyranniques impose la colonisation comme un droit-devoir aux sociétés qui ont développé une structure politique légitime. Les structures politiques tyranniques semblent destinées, en l’absence d’intervention coloniale, à reproduire l’infériorité et la misère, car elles sont incapables de garantir ce qui, depuis Hobbes, est le devoir minimum de toute société politique, la pacification. Celle-ci constitue la première et plus fondamentale prestation des sociétés colonisées, justifiant à elle seule l’entreprise :
« Pour tant de crimes dont on l’accuse et dont elle n’est pas toujours innocente, la colonisation contemporaine a du moins le mérite d’avoir établi, dans des pays dévorés de guerres intestines, de razzias et d’invasions, la paix. La pacification était la première de ses besognes, la condition même de son action. Rien que par là, elle faisait déjà œuvre de moralisation et se montrait supérieure aux autorités qu’elle remplaçait [15]. »
L’incapacité politique des populations « non civilisées » a pour corollaire leur invisibilité sur le plan du droit international. N’étant pas en mesure, en raison de leur immaturité, de constituer un corps politique légitime, les populations non organisées politiquement selon le modèle de l’État-nation, sont considérées comme inexistantes et leurs territoires comme « inoccupés ».
Louis Le Fur, dans un influent Précis de droit international public, publié à Paris en 1936, considère les terres occupées par les populations non civilisées comme des « territoires sans maître », disponibles à l’appropriation. Par l’expression « territoires sans maître », Louis Le Fur ne veut pas indiquer des espaces sans habitants, mais des territoires non organisés, qui, ne connaissant pas une organisation politique comparable à celle prévalant en Occident, peuvent être considérés comme ouverts à l’occupation coloniale :
« L’existence de territoires sans maître, c’est-à-dire non organisés, telle est la première condition d’une occupation régulière [16]. »
Cette doctrine ne remonte pas aux années 1930. L’idée que les terres habitées par des tribus « barbares » ou « sauvages » – c’est-à-dire des populations non européennes – doivent être considérées, du point de vue du droit international, comme terrae nullius avait déjà trouvé une expression canonique de la part des puissances coloniales lors de la conférence de Berlin de 1885. Jules Ferry, à l’époque ministre des Affaires étrangères, l’exprime en ces termes :
« D’après la doctrine communément admise par les auteurs, un État peut acquérir, par la seule prise de possession, la suzeraineté de territoires, soit inoccupés, soit appartenant à des tribus sauvages [17]. »
Les territoires sans habitant et les territoires habités par des populations « inférieures » peuvent, sur la base de ce principe, être considérés de la même manière. Selon Frédéric de Martens, l’un des plus grands juristes français de la fin du XIXe siècle, c’est chose possible en vertu de l’asymétrie caractérisant, en liaison avec le concept clé de « civilisation », toute relation coloniale :
« Le droit international européen n’est point applicable aux relations d’une puissance civilisée avec une nation demi-sauvage [18]. »
La relation coloniale ne met pas en rapport des pairs, mais des populations relevant de niveaux de développement si différents que ceux-ci rendent impossible l’application d’un droit uniforme. Les « peuples enfants », incapables d’action politique, ne peuvent être considérés comme des sujets juridiques dans le cadre du droit international :
« Le droit international n’est pas applicable à tout le genre humain. Comment saurait-on appliquer ce droit, qui est le produit de la civilisation et une conséquence de la communauté des idées morales et juridiques des nations civilisées, aux peuples qui n’ont aucune conscience des devoirs qui en découlent [19] ? »
Définir les populations colonisées comme politiquement irresponsables rend les relations coloniales étrangères au cadre du droit international. Les terres occupées par des populations « arriérées » peuvent ainsi être légitimement occupées par des peuples adultes, rationnels et industrieux, seuls capables, comme nous le verrons, de les faire fructifier de façon adéquate.
Le pouvoir colonial en tant que pouvoir tutélaire – de même que le pouvoir paternel qui s’arrête lorsque le mineur atteint la majorité et acquiert la capacité d’agir – doit être pensé comme limité dans le temps, puisque dès le départ son but est de disparaître :
« Il vient un temps où le tuteur se sent tenu d’émanciper l’enfant mineur, où la loi à la fin fait de lui un majeur [20]. »
C’est pour cette raison que la prise de possession d’un pays ne peut que de façon impropre être comparée à une expropriation. Selon Joseph Folliet une comparaison semblable ne tient pas compte du caractère nécessairement temporaire de la tutelle coloniale :
« Sans dépouiller les indigènes coloniaux de leur propriété sur leur territoire et les biens qu’il abrite, l’État colonisateur tirera parti de ces ressources, en attendant qu’ils soient capables d’y suffire par eux-mêmes. Il agira comme en curateur à l’égard d’un mineur : il gérera leurs possessions en “bon père de famille” et il les éduquera pour les rendre, au plus tôt, aptes à la gestion de leurs biens [21]. »
Reste à évaluer le temps nécessaire pour mener à bien l’émancipation des peuples colonisés, un temps qui, de par la difficulté de l’entreprise, ne peut jamais être établi de façon précise. Il coïncide, en définitive, avec le temps qui doit être concédé aux « populations enfants » des colonies pour qu’elles puissent réaliser, sous la tutelle du colonisateur, le long chemin qui les sépare de l’âge adulte, de l’acquisition de la raison, de la conscience et de la capacité politique.
Selon Hardy, l’émancipation des peuples colonisés devra advenir de façon prudente et progressive du fait qu’« un peuple ne change pas ses instincts en quelques années [22] » :
« Si la domination européenne disparaissait, le passé resurgirait du jour au lendemain. Ce serait le recommencement des luttes sanglantes, des tyrannies de clans et de classes, des poursuites féroces et des refoulements ; ce serait aussi l’abandon de toutes les entreprises de relèvement et de progrès – en somme, la plus désastreuse faillite qu’on puisse imaginer [23] »
Concéder aux populations colonisées une liberté et un pouvoir ne correspondant pas à leur degré de développement et qu’ils ne sont pas capables d’exercer car leur « dressage moral » n’est pas adéquat, signifie selon Arthur Sarraut risquer de les faire retomber « dans l’anarchie d’où nous les avons tirées », abdiquant ainsi le devoir moral fondamental de la colonisation (« Nous n’avons pas le droit de les rejeter aux ténèbres, après avoir illuminé leurs fronts des aurores d’un avenir nouveau [24]. »)
Pour cela, Albert Sarraut se déclare fermement hostile à toute hypothèse de concession de droits politiques aux populations colonisées :
« Je repousse les systèmes de naturalisation en masse, comme les systèmes de self-government ou de suffrage universel conféré collectivement aux populations indigènes. Ce serait à mon avis la pire démence que d’imposer à des races hétérogènes, dont les stades d’évolution sont au surplus infiniment différents, l’uniformité rigide des directions sociales et politiques auxquelles nous n’avons abouti qu’après de longs siècles d’études et d’éducation [25]. »
L’âge de la maturité des colonisés est ainsi renvoyé à un futur indéterminé mais suffisamment lointain pour rendre nécessaire une présence tutélaire stable.
Dernière partie : Différence coloniale et histoire universelle


