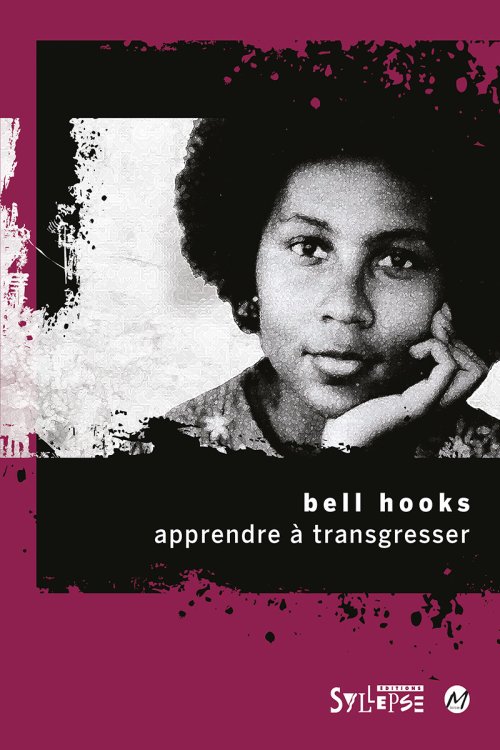Imaginez le changement qui s’est produit au sein des mouvements féministes pour que des étudiant·es, la plupart des femmes, arrivent en cours pour lire ce qu’on leur présente comme de la théorie féministe, et avoir uniquement l’impression que ce qu’iels lisent n’a aucun sens, ne peut être compris. Et cela quand bien même on le comprendrait n’aurait aucun lien avec les réalités « vécues » à l’extérieur de la classe. En tant qu’activistes féministes on peut se demander à quoi sert une théorie féministe qui agresse les psychismes fragiles de femmes luttant pour se débarrasser du joug de l’oppression patriarcale.
On peut se demander à quoi sert une théorie féministe qui les démoralise, littéralement, qui les laisse le regard troublé, titubant hors de la classe, humiliées, comme si elles s’étaient tenues dans un salon ou une chambre, quelque part, avec quelqu’un·e les ayant séduites ou sur le point de le faire, mais qui en même temps leur impose un processus humiliant, les dépouille de leur estime d’elles-mêmes. Il est clair qu’une telle théorie féministe peut servir à légitimer les études féminines (Women’s Studies) et une littérature féministe aux yeux du patriarcat en place, mais elle sape et sabote les mouvements féministes.
C’est peut-être l’existence de cette forme très visible de théorie féministe qui me pousse à parler du fossé entre théorie et pratique. Car c’est en effet le but d’une telle théorie : diviser, séparer, exclure, maintenir à distance. Puisque cette théorie est utilisée pour réduire au silence, censurer, ou dévaloriser nombre de voix féministes théoriciennes, on ne peut simplement l’ignorer.
Dans le même temps, malgré son usage comme outil de domination, cette théorie peut aussi contenir des idées, des pensées, des visions importantes qui, si elles sont utilisées différemment, peuvent servir des fonctions guérisseuses, libératoires. Nous ne devons cependant pas ignorer les dangers qu’elle fait peser sur la lutte féministe qui doit rester ancrée dans un corpus théorique qui informe, modèle, et permet une pratique féministe.
Dans les cercles féministes, beaucoup de femmes ont répondu à la théorie féministe hégémonique qui ne leur paraissait pas claire en démolissant la théorie, promouvant en conséquence une dichotomie factice entre théorie et pratique. Ce faisant, elles se retrouvent à être de connivence avec ceusses à qui elles s’opposeraient. En internalisant le présupposé trompeur que la théorie n’est pas une pratique sociale, elles encouragent au sein des milieux féministes une hiérarchie potentiellement oppressive où toute action concrète est perçue comme plus importante que toute théorie, écrite ou parlée.
Je suis récemment allée à une réunion de femmes, en majorité noires, où nous avons débattu pour savoir si les leaders noirs, par exemple Martin Luther King Jr ou Malcolm X, devaient être soumis à une critique féministe qui poserait des questions intransigeantes sur leur attitude quant aux problèmes de genre. La conversation dura deux heures. Alors que la réunion se terminait, une femme noire, qui était restée particulièrement silencieuse, expliqua qu’elle n’était pas intéressée par toute cette théorie, cette rhétorique, tous ces débats, et qu’elle était davantage intéressée par l’action, par faire quelque chose et qu’elle était juste « fatiguée » de toute cette discussion.
L’intervention de cette femme me perturba : c’est une réaction courante. Peut-être que dans son quotidien habite-t-elle dans un monde différent du mien ? Dans le monde dans lequel je vis au quotidien, il y a peu d’occasions pour les femmes noires, ou les penseuses racisées de se réunir et de débattre avec rigueur des notions de race, de genre, de classe, ou de sexualité. Je ne savais donc pas d’où elle venait quand elle suggéra que notre discussion était chose commune, tellement commune qu’on pourrait s’en passer. J’avais pour ma part eu l’impression que nous nous engagions dans un processus de dialogue et de théorisation critiques restés longtemps tabous. Et donc, de mon point de vue, nous tracions de nouvelles routes, revendiquant pour nous autres femmes noires, un terrain intellectuel où nous pourrions commencer la construction collective de la théorie féministe.
Dans bien des contextes noirs, je fus témoin du rejet des intellectuel·les et de la théorie, et restai silencieuse. J’en suis venue à comprendre que le silence est un acte complice, qui aide à perpétuer l’idée qu’on peut entreprendre une libération noire révolutionnaire et une lutte féministe, sans théorie. Comme beaucoup d’intellectuel·les noir·es insurgé·es, dont le travail et l’enseignement sont souvent menés dans des contextes majoritairement blancs, je suis souvent si contente d’accéder à un groupe comportant d’autres Noir·es que je n’ose pas faire de vagues, où m’exclure en exprimant des désaccords avec le groupe. Dans de tels contextes, où le travail des intellectuel·les est dévalorisé, je contestais rarement, auparavant, ces présupposés dominants, et j’ai parlé rarement avec détermination ou enthousiasme du processus intellectuel. Je craignais qu’en prenant une posture insistant sur l’importance du travail intellectuel, la théorisation en particulier, ou en affirmant simplement qu’il me paraissait important de lire beaucoup, je prendrais le risque d’être vue comme arrogante, ou comme prenant le groupe de haut. Je restais bien souvent silencieuse.
Ces risques posés à l’estime de soi semblent d’une grande platitude par rapport aux crises auxquelles nous faisons face en tant qu’Afro-Américain·es, à notre besoin désespéré de raviver et alimenter la flamme de la lutte pour la libération noire. Lors de cette réunion, j’osai dire, répondant à la suggestion que nous perdions notre temps à parler, que je voyais nos paroles comme des actions, que notre lutte collective pour parler de genre et d’identité noire [blackness], sans censure, était une pratique subversive. La plupart des problèmes que nous affrontons, en tant que Noir·es : mauvaise estime de soi, nihilisme et désespoir intensifiés, rage et violence réprimées qui détruisent notre bien-être physique et psychologique, ne peuvent être abordés par des stratégies de survie qui auraient fonctionné par le passé. J’insistai sur le fait que nous avions besoin de nouvelles théories, enracinées dans une tentative de comprendre à la fois la nature de notre situation contemporaine, et les moyens par lesquels nous pourrions collectivement entrer en résistance pour transformer notre réalité actuelle.
J’étais, cependant, moins rigoureuse et impitoyable que je ne l’aurais été dans un autre contexte, afin de souligner l’importance du travail intellectuel, de la production théorique comme une pratique sociale pouvant être libératrice. Bien que je n’eusse pas peur de parler, je ne voulais pas être celle qui « gâcherait » ces bons moments, ce sens collectif d’une solidarité douce, entre personnes Noir·es. Cette peur me rappela ce que ça pouvait être, il y a plus de dix ans, de se trouver dans des contextes féministes et de poser des questions sur la race et le racisme, questions potentiellement perçues comme perturbant la solidarité et la sororité.
Il parut ironique qu’à un rassemblement pour honorer la mémoire de Martin Luther King Jr, qui si souvent osa parler et agir en résistance contre le statu quo, des femmes noires nient encore notre droit aux dialogues et aux débats d’opposition politique, particulièrement lorsque ce n’est pas le cas dans les communautés noires. Pourquoi les femmes noires présentes ressentaient le besoin de se policer les unes les autres, de nier aux autres un espace, parmi notre race, où nous pourrions parler de théorie sans être complexées ?
Pourquoi, alors que nous pouvions célébrer ensemble la puissance d’un penseur critique noir qui osa sortir du lot, y avait-il dans la salle cet empressement à réprimer tout point de vue suggérant que nous puissions apprendre collectivement des idées et des visions des intellectuelles/théoriciennes noires, qui par la nature même de leur travail, brisent le stéréotype selon lequel la « vraie » femme noire est celle qui parle toujours avec les tripes, qui place le concret au-dessus de l’abstrait, le matériel au-dessus du théorique ?