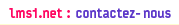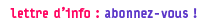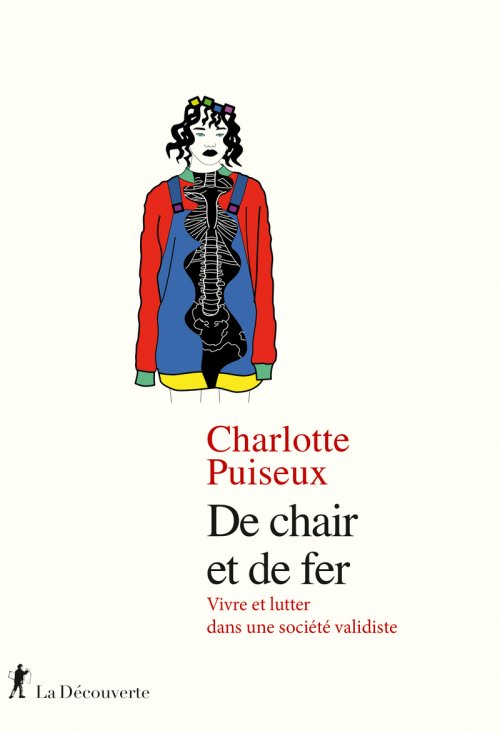
J’ai souvent éprouvé cette indifférence, ce sentiment d’invisibilité que je ne pouvais analyser autrement que comme un problème venant de moi, de l’image que renvoyait mon corps, de qui j’étais. C’était selon moi la seule explication plausible dans ce monde où la validité était exaltée comme la valeur ultime, le gage de la beauté et de la désirabilité. Pourtant une autre voie était possible, mais il fallait aller la chercher par‑delà ce qui était donné et déconstruire un système fait pour broyer les êtres qu’il considérait comme anormaux.
Ce désir de compter dans l’espace public, d’exister aux yeux des autres, m’a longtemps fait aimer le Téléthon, dans la lignée de mes parents pour qui ce moment restait une fête, une revanche sur la sombre destinée qui m’était alors prédite. Cette émission, j’y ai participé très jeune puisque j’ai été le visage de l’affiche à cinq ans, et j’ai fait partie du public de nombreuses fois. J’avais, à l’époque, enfin l’impression d’éveiller de l’intérêt, de ne plus être cette petite fille qui devait cacher son handicap pour être attrayante, au contraire !
Dans ma famille, on a toujours adoré le Téléthon. Mes parents avaient trouvé du soutien grâce à l’Association française contre les myopathies (AFM), qui gère cet événement médiatique, des interlocutrices qui proposaient des alternatives médicales, des traitements en vue d’améliorer mon espérance de vie, des pistes thérapeutiques pour peut‑être un jour me soigner, un espoir auquel se raccrocher. Ce que je comprends tout à fait au vu de l’environnement validiste dans lequel ma famille évoluait.
Mon grand‑père maternel, lui, avait décidé de soutenir encore plus activement les actions du Téléthon en créant sa propre association, 2ARM, et en reversant chaque décembre les fruits des brocantes et autres braderies auxquelles il avait participé pendant l’année. Pour mes dix ans, il avait même eu la grande idée d’organiser une traversée de la baie du Mont‑Saint‑Michel, où nous avions l’habitude de passer nos vacances puisqu’il était originaire de cette région et que nous y avions de la famille. Il avait réussi à intéresser la presse locale, ce qui m’avait valu d’être en photo dans les journaux du coin. Plusieurs centaines de personnes avaient répondu à son appel, ce qui l’avait rendu éminemment fier.
J’adorais mon grand‑père, mais inutile de dire que j’ai vite déchanté à l’idée de cette traversée (événement réitéré chaque année jusqu’à mes dix‑huit ans…). Toutes ces histoires de journalistes, de télévision et autres médias avaient eu le même effet sur moi que ma participation au Téléthon : on s’intéressait enfin à moi, mon handicap n’était plus une source de dénigrement. Pourtant, chaque fois que je lisais un article ou regardais une émission qui parlait de moi, quelque chose me dérangeait. L’impression que ce que j’avais voulu dire n’avait pas été compris, que mon message ne passait pas. À un peu plus de dix ans, j’étais encore loin d’avoir saisi les concepts d’inspiration porn ou même de validisme bienveillant (je n’en avais même jamais entendu parler…), mais aujourd’hui je sais que c’était bien de cela dont il était question.
Je comprends maintenant qu’il s’agissait de mettre en avant, à travers mon histoire, une certaine image des personnes handicapées qui s’inscrit dans la logique même du validisme. On ne parle pas ici de validisme assumé, de haine ouverte envers les personnes handicapées, mais d’un validisme souterrain bien plus sournois dont les individus qui le véhiculent n’ont pas conscience. L’inspiration porn, théorisée en 2012 par la militante handicapée australienne Stella Young, soutient l’idée selon laquelle les personnes handicapées sont utilisées par les valides comme des sources d’inspiration, y compris dans les plus petits événements de la vie quotidienne. Prêter des qualités extraordinaires aux personnes handicapées uniquement du fait de leur handicap (ces qualités seraient banalisées chez une personne valide) contribue à les déshumaniser. C’est un validisme prétendument bienveillant, au sens où il se présente comme un intérêt à l’égard des personnes handicapées, voire un amour pour ces personnes frappées par un destin tragique. Nous sommes en plein dans la rhétorique caritative qui inonde les esprits lorsqu’on parle de handicap (le Téléthon en est un parfait exemple), et sur laquelle je reviendrai plus tard dans ce livre.
Mais quelles sont les conséquences de cette perception ? C’est qu’elle exclut encore et toujours les personnes handicapées du commun des mortelles ; elles ne sont pas considérées à égalité avec les valides, qu’elles soient dénigrées et infériorisées ou présentées comme des super‑héroïnes… Ces arguments justifient d’un côté les discriminations qu’elles subissent et, de l’autre, alimentent l’idée qu’il est possible, à force de volonté, de se rapprocher de la validité et d’être moins handicapée.
C’est ce message qui circule dans la glorification des exploits réalisés par certaines personnes handicapées (dans les domaines sportif, économique ou social), qui n’est qu’une exaltation des normes validistes et une injonction plus ou moins cachée adressées à toutes les autres personnes handicapées. La logique est que si certaines y sont arrivé, toutes peuvent le faire, et si d’autres n’y arrivent pas, c’est qu’elles ne le veulent pas vraiment. La réussite des personnes handicapées serait ainsi une affaire de volonté et ne serait absolument pas conditionnée par des réalités sociales, l’inaccessibilité des lieux, des discriminations structurelles, un système validiste en somme ! Après tout, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel a bien déclaré en 2018 dans une interview pour le journal 20 Minutes [1] que le validisme n’existait pas…
La validité m’a accompagnée de classe en classe, d’année en année ; j’en ai découvert peu à peu les effets sans comprendre le système dans lequel elle m’avait enfermée. Elle était là, mais silencieuse, elle ne faisait pas encore parler d’elle à la télévision ou dans les journaux. Le handicap oui, mais pas le validisme… J’ai pris mes distances avec le Téléthon et ses discours remplis de pitié, d’angélisme ou de validité exaltée qui me dérangeaient de plus en plus. Je n’étais pas opposée à la recherche, et j’entendais bien le désir des parents de sauver leurs enfants d’une mort annoncée qui pouvait être bien réelle. Mais le chemin pris par cette émission ne me convenait plus et était problématique à bien des égards.