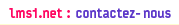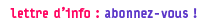Première partie : « S’attaquer aux filières »
Avec la sortie du film Welcome [1] surgit dès le mois de mars une autre polémique. Cette fois, Éric Besson l’a moins choisie que subie. En effet, elle vient contredire la rhétorique nouvelle : le ministère humanitaire punirait-il la solidarité ?
Face à l’offensive des associations, la contre-offensive ministérielle repose essentiellement, dans un premier temps, sur l’idée que le « prétendu délit de solidarité » est un « mythe ».
Toutefois, dans un deuxième temps, Éric Besson invoque la thématique des passeurs à l’appui de cette thèse : à ceux qui affirment l’existence de poursuites au titre de l’article L. 622-1 du Ceseda [2] à l’encontre de personnes ayant aidé des migrants en situation irrégulière, le ministre explique que celles-ci « sont allées beaucoup plus loin que l’humanitaire, en participant au travail des passeurs en toute connaissance de cause » et « regrette » que les associations contribuent ainsi à une « campagne de désinformation » entretenant
« une confusion entre ce qui relève de l’humanitaire, parfaitement légitime et utile auprès d’étrangers en situation de détresse, et ce qui participe d’une collaboration active, par passion, par idéologie ou par imprudence, à des filières exploitant de manière indigne la misère humaine. » [3]
À première vue, la distinction est claire entre la solidarité et l’exploitation. Mais le ministre n’est pas prêt pour autant à exempter les bénévoles en les opposant aux passeurs : selon lui, la « passion » et « l’idéologie » peuvent servir l’intérêt le plus « indigne ». En effet, le bénévole est accusé de travailler pour le passeur, « par imprudence », et parfois « en toute connaissance de cause ». Quand les associations et ses adversaires politiques contestent l’assertion d’Éric Besson selon laquelle « le délit de solidarité n’existe pas », le ministre suggère donc de plus en plus que c’est en raison de leur complicité, et non de leur solidarité, que des bénévoles sont poursuivis en justice. Il déclare ainsi, lors d’une visite à Calais :
« Ne soyons pas naïfs. Les passeurs facturent une prestation globale, incluant l’intervention éventuelle de bénévoles et d’associations. La passion quelquefois imprudente des uns peut faire la fortune des autres. » [4].
La limite entre l’action humanitaire et l’implication dans une filière d’immigration clandestine s’estompe ; bénévoles et passeurs participeraient ensemble d’un même trafic organisé, les premiers servant « objectivement » les intérêts des seconds, nonobstant leurs motivations « subjectives ».
Ce débat amène Éric Besson à affiner pour un temps le vocabulaire en jeu : il propose de supprimer l’appellation d’« aidant », communément utilisée par la police dans la lutte contre l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, pour la remplacer par celle de « trafiquant ». Ce nouveau terme continuera de désigner, selon les sous-catégories utilisées par la police,
« les organisateurs, les passeurs, les logeurs, les employeurs, les fournisseurs et les conjoints de complaisance ; il y a donc 6 réalités concrètes et opérationnelles de trafiquants. » [5]
Au sein d’un discours qui de façon générale utilise massivement les termes de « passeur » et de « filière » de la façon la plus vague possible, cette catégorisation est suffisamment rare pour mériter d’être soulignée. Néanmoins, elle demeure une exception ; Éric Besson continuera de lui préférer ces deux termes habituels.
Éric Besson a promis aux Calaisiens qu’il reviendrait « avant le 1er mai avec des solutions » : effectivement, une deuxième visite est prévue pour le 23 avril 2009. Aussi plusieurs opérations de police sont-elles organisées simultanément le 21 avril sur réquisition judiciaire, à Calais et aux alentours. Plus de 150 policiers sont mobilisés, et 194 migrants sont interpellés et placés en garde à vue.
Un surcroît de fermeté
Éric Besson déclare alors :
« Il fallait réaffirmer, face à la dégradation de la situation, que force doit rester à la loi ! » [6].
Interrogé sur les ondes de RMC le 22 avril, le ministre précise qu’il s’agissait d’une « vaste opération de démantèlement des filières de l’immigration clandestine »
« - En clair, il y a des passeurs, il y a des mafieux, il y a des personnes qui exploitent la misère humaine (…) Et le préfet a coordonné une vaste opération policière qui visait à rechercher des passeurs. Et je crois savoir qu’une dizaine d’entre eux sont en garde à vue (…)
- Donc parmi ces 200 migrants, des passeurs ont été arrêtés ?
- Oui, bien sûr, c’était l’objectif de l’opération » [7]
Comme souvent avec Éric Besson, les choses sont « simples » :
« D’abord force doit rester à l’État de droit et à la loi (…) Nous luttons contre les passeurs et pas contre les migrants. »
Toutefois, en fait de passeurs arrêtés, les 9 personnes encore en garde à vue le 22 avril au matin ont été libérées le jour même, « aucun chef d’inculpation n’[ayant] pu être retenu contre eux », selon Jean-Philippe Joubert, le procureur de Boulogne-sur-Mer :
« Les enquêteurs vont continuer leur travail, mais aucune charge ne permettait de dire que telle ou telle personne était un passeur. » [8]
Cette déconvenue n’entame pas la détermination d’Éric Besson qui, le lendemain à Calais, dresse un portrait de la situation particulièrement sombre :
« Après une période d’amélioration liée à la fermeture de Sangatte, qui a permis de faire baisser les interpellations d’étrangers en situation irrégulière de 100 000 en 2002 à 35 000 en 2008, la situation recommence à se dégrader. Le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents dans le Calaisis a doublé depuis un an. Les rapports des services de police font état d’une recrudescence des réseaux d’immigration clandestine dans toute la région. D’autres rapports témoignent de la multiplication autour de Calais des squats et des campements sauvages. Une “mosquée de fortune”, puisque c’est ainsi que l’a qualifiée la presse, a même été érigée par les passeurs aux abords du port, démonstration supplémentaire de la volonté d’enracinement de ces réseaux. »
Une situation qui concerne tout le Calaisis ; ainsi, à Norrent-Fontes :
« un campement y a été installé par une filière clandestine d’origine érythréenne. Des cas de tuberculose et de gale y ont été récemment signalés. Les forces de police y ont même été prises à parti il y a quelques semaines et ont dû se replier face à des dizaines de passeurs et de clandestins qui les ont attaquées. » [9]
En somme :
« il n’y a pas trop de pression de la police sur les passeurs et les filières, il n’y en a pas assez ».
Le ministre promet donc la multiplication d’opérations « coup de poing » comme celle du 21 avril, ainsi que le renforcement de la direction zonale de la police aux frontières et la plus grande mobilisation d’une unité de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (Ocriest, voir « Ramification des filières et multiplication des aidants », p. 208) à Calais. Enfin, Éric Besson insiste :
« La loi de la jungle, c’est la loi des passeurs ».
En conséquence :
« la jungle devra avoir disparu avant la fin de l’année. Car la lutte contre les filières d’immigration clandestine, qui sont aussi celles de la traite des êtres humains, du proxénétisme, de la servitude et de l’exploitation, est la priorité de mon action ».
En conclusion :
« Calais ne doit pas se transformer en une zone de non-droit soumise à la mafia des passeurs. Force doit rester au respect de la loi. »
Un discours apocalyptique
Pour que néanmoins l’humanité de sa tâche ne soit pas tout à fait oubliée, Éric Besson promet des mesures (des douches, un point de distribution de nourriture, un point d’accueil des demandes d’asile). Sans doute celles-ci restent-elles « légères », c’est qu’il convient d’éviter tout « appel d’air » :
« C’est en assurant le respect de la loi que la République assure, à mon sens, sa première fonction humanitaire. »
Si désormais une plus grande fermeté est de mise, c’est toujours pour garantir davantage d’humanité. Cette ligne sera fidèlement suivie jusqu’au « démantèlement » effectif de la jungle. Ainsi, en juillet 2009, dans son bilan à trois mois du plan d’action présenté le 23 avril à Calais, Éric Besson continue de brosser le tableau d’une zone intégralement sous le joug d’organisations mafieuses qui alimentent l’insécurité :
« La pression des filières aboutit à la multiplication des agressions et des trafics en tous genres et à un développement sans précédent de la délinquance (…) Des zones entières sont désormais sous le contrôle de ces filières. » [10]
Le communiqué du ministère, le 16 septembre, dans lequel est annoncée officiellement la prochaine destruction de la jungle, poursuit cette description :
« Les comptes rendus des services de l’État sur la situation font apparaître une remontée très forte de la délinquance dans le Calaisis, après plusieurs années d’accalmie due à la fermeture du camp de Sangatte en 2002. Depuis deux ans, les filières clandestines ont reconstitué une nouvelle plaque tournante du trafic d’êtres humains, à proximité directe du port de Calais. »
La région est devenue « une zone de non-droit, où les passeurs entendent faire la loi, rackettent et brutalisent les migrants et les font vivre dans des conditions indignes » :
« Les rixes et les violences sont quotidiennes. Une épidémie de gale s’est développée. Les habitants de Calais subissent chaque jour des agressions. Les entreprises situées à proximité ne peuvent plus travailler normalement. » [11]
Une telle description a de quoi susciter l’effroi. Dans le Calaisis ainsi dépeint, en proie aux filières occultes mais omniprésentes, et qui menacent tout à la fois les migrants et les habitants locaux, toute la palette des risques est présente : sécuritaires (violence, chaos), sanitaires (épidémie, insalubrité), économiques (pour les entreprises), voire identitaires (avec la construction d’une mosquée).
Le Calaisis serait-il une exception notable au sein du Pas-de-Calais ? Ce département fait précisément partie – sur la base d’autres « comptes rendus des services de l’État » – des cinq départements salués début septembre 2009 par le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, pour avoir connu les plus fortes baisses de leur taux de délinquance générale entre août 2008 et juillet 2009 [12].