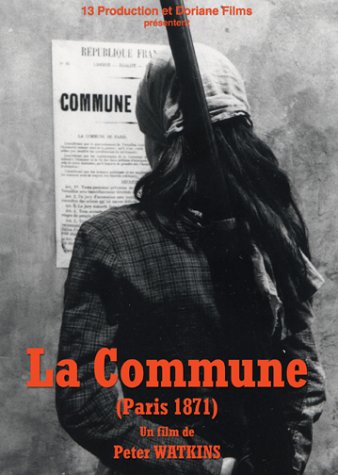Les deux reporters de la télévision communale rendent compte des faits à chaud, de façon immédiate. Ils plongent au coeur des événements et leurs téléspectateurs avec eux. Ils interrogent les acteurs de la Commune, les connus et les inconnus, les officiels et les gens du peuple, les pour et les contre. Ils sont avec eux.
Après le 18 mars et l’affaire des canons, ils vont entre autres recueillir les impressions, et surtout les espoirs fous de Parisiens qui ont participé à l’insurrection et attendent des changements révolutionnaires de la part des représentants du peuple qui s’installent à l’Hôtel de Ville et s’apprêtent à gouverner Paris. Plusieurs personnes s’expriment, les revendications sont nombreuses.
Le peuple réclame du travail et à manger ; il veut la fin de l’exploitation et des conditions de travail misérables qui ont été les siennes jusqu’alors ; il considère que l’éducation (apprendre à lire et écrire) doit être accessible à tous, que tout le monde doit pouvoir aller à l’école, a le droit à la culture. Les femmes veulent un espace de liberté et d’expression. Et nombre de Parisiens refusent l’oppression cléricale et réclament le remplacement de l’éducation religieuse par l’éducation laïque et révolutionnaire.
La volonté est profonde d’aller « jusqu’au bout », de changer radicalement le cours des choses en tirant les leçons des révolutions ratées du passé. La joie et l’espérance se mêlent à la colère accumulée à travers les ans et qui enfin peut éclater. Au-delà des revendications concrètes et des besoins matériels, on sent la volonté du peuple d’être respecté pour ce qu’il est. Il veut vivre et vivre dignement. Il entend que l’on reconnaisse son existence et que l’on prenne en compte ses désirs et sa culture. Il se considère comme l’égal de tous ceux qui composent la société humaine.
Peter Watkins a le souci de donner aussi la parole à ceux qui sont contre la Commune ou qui sont inquiets de la situation mise en place par les communards. Il laisse s’exprimer le point de vue des Versaillais purs et durs, celui des bourgeois qui sont restés à Paris et qui vivent dans les beaux quartiers en attendant que la tempête s’éloigne, celui des bourgeois qui choisissent de rester parmi les communards même s’ils ne partagent pas leurs convictions, leurs joies, et leurs espérances.
En contrepoint aux émissions de la télévision communale, le réalisateur montre les émissions de la télévision versaillaise qui déverse à travers l’écran ses mensonges et sa propagande, qui distille sa haine anti-communarde, son racisme et sa misogynie. On notera que si la télévision de la Commune est représentée à travers deux journalistes souriants qui sont auprès des gens du peuple, qui sont dynamiques et vont là où les événements importants se déroulent, la télévision versaillaise est principalement représentée à travers un présentateur aux allures d’aristocrate pincé, coincé derrière son bureau, loin des lieux où se joue concrètement l’Histoire.
L’image de ce présentateur est constamment entourée d’un cadre noir qui évoque la diffusion télévisuelle, mais qui renforce surtout le caractère statique de sa position. Il arrive que l’on voit un journaliste de la télévision versaillaise interroger des bourgeois ou en mission d’espionnage au coeur du Paris communard, mais c’est rare.
Tout au long du film apparaît le personnage de Jenny Talbot qui va servir à rendre compte du mode de vie et des idées de « la bourgeoisie moyenne à Paris sous la Commune ». Jenny Talbot habite dans un appartement cossu du quartier de la Madeleine (VIIIe arrondissement). Elle est mariée à un professeur de rhétorique qui lit les journaux, notamment le Gaulois, tabloïd de tendance versaillaise interdit par la Commune à partir du 21 mars.
Elle écrit des lettres à sa fille sur la situation et son évolution à Paris [1]. Jenny Talbot critique l’action du gouvernement Thiers qui n’a pas su empêcher l’éclatement de l’insurrection et l’établissement de la Commune. Elle voit les communards comme de vulgaires pilleurs. Apparemment, ses conditions de vie ne se dégradent pas : la nourriture ne manque pas même si le prix des denrées augmente. Elle est même en mesure d’inviter ses amis et de leur offrir un « délicieux repas ». Jenny Talbot reste manifestement à l’écart des lieux de misère et de combats, lovée dans le cocon de son appartement. Au long des événements, elle oscille entre la calme et froide certitude que la Commune est vouée à sa perte, et l’inquiétude, notamment quand les combats s’annoncent dans la capitale.
Au cours d’une réunion dans un club révolutionnaire, une femme de médecin exprime sa déception quant à la Commune : elle juge égoïstes et inhumains les communards qui envoient leurs enfants sur les barricades ; elle affirme vouloir aider les Parisiens qui sont dans le besoin, non pas parce qu’elle approuve leurs choix politiques, mais par charité chrétienne. Les autres personnes présentes lui reprochent son humanisme non révolutionnaire, le fait qu’elle ne sorte pas de sa condition de bourgeoise.
Les religieuses de l’école de la rue Oberkampf (XIe arrondissement), qui est perquisitionnée par la Garde Nationale, s’inquiètent de la situation, des enfants dont elles sont responsables, et du « devenir du quartier ». Elles, qui vont pouvoir se replier dans des communautés de Province, se demandent ce que vont devenir les pauvres à qui elles apportent des soins, de la nourriture.
La diversité des points de vue au sein de la population communarde, les contradictions qui secouent les individus sont montrées, soulignées parfois. Elles ressortent notamment des débats, des discussions menés par ceux qui participent aux événements de Paris. On sent d’ailleurs ici la volonté de Peter Watkins de faire dialoguer démocratiquement les personnages qu’il a à mettre en scène, de montrer que la Commune a ouvert un espace de parole et de liberté pour tous, qu’elle a permis aux plus humbles de s’exprimer.
Manifestement, les principales contradictions apparaissent à propos de la religion, du rapport à l’institution cléricale. Beaucoup de femmes condamnent sans nuances à la fois les principes religieux et le rôle de l’église. D’autres sont moins catégoriques. La citoyenne Constance Fillon, qui s’est présentée à la caméra au début du film, reconnaît l’importance de l’école laïque et le rôle positif qu’elle joue, mais considère que les soeurs du couvent Saint Vincent-de-Paul lui ont été d’un grand secours en prenant soin de sa fille Frédérique. À l’église Saint Ambroise (XIe arrondissement), des femmes interrogées par les journalistes de la télévision communale critiquent le prêtre quand il condamne naïvement et hypocritement la violence, mais affirment continuer à pratiquer les rites religieux, car le fait de venir à l’église leur permet de manger, et aussi parce qu’elles ont « toujours été élevée[s] comme ça ».
Plus tard, un groupe de femmes est interrogé par la télévision communale : certaines d’entre elles, qui se disent parfois croyantes, refusent que l’église leur dicte leur conduite, se mêle de ce qui ne la regarde pas, culpabilise les femmes, notamment à propos de l’avortement. D’autres se veulent moins critiques, considérant que certains curés aident les pauvres gens.
Les communards ne sont pas d’accord entre eux sur la façon dont la vie des citoyens doit être gouvernée. Un soldat de la Garde Nationale pense que les élections sont inutiles, il refuse d’élire des représentants qui seront forcément des bourgeois. Il veut que le gouvernement se fasse à la base, à travers de petits comités composés par les gens du peuple qui ont pris les armes et se sont battus directement pour la révolution.
Une femme affirme, elle, que les élections devraient permettre d’élire à l’Hôtel de Ville un gouvernement populaire, composé de « gens qui souffrent, qui savent ce que c’est que l’exploitation (...) l’humiliation ». Une autre femme, qui tient significativement un fusil à la main et porte une casquette de la Garde Nationale, décrète pour sa part que l’Hôtel de Ville devrait être brûlé, et craint qu’« à se prélasser sur les fauteuils en velours », les prochains élus en oublient leur tâche et les raisons pour lesquelles ils ont été mandatés. En un mot, elle considère que le pouvoir corrompt.
Les soldats de la Garde Nationale ne sont pas d’accord entre eux sur les raisons pour lesquelles il faut marcher sur Versailles. Quelques-uns veulent fraterniser avec les soldats versaillais, considérant qu’ils « sont encore dans l’ignorance du grand élan populaire qu’il y a sur Paris ». D’autres pensent que la situation n’est plus celle du 18 mars, que l’armée de Thiers est maintenant une armée clairement monarchiste, dirigée par des nobles, et qu’il n’y a plus de rencontre pacifique possible. Le même problème sera débattu par des femmes, quelques instants plus tard.
Les femmes veulent participer aux combats menés par la Garde Nationale. Certains soldats sont prêts à les accueillir, d’autres s’y refusent absolument. Un cynique misogyne tente de concilier les antagonismes, en balayant certains espoirs qu’a fait naître la Commune : « Restons tout de même pratiques... les femmes peuvent tout de même servir à la cuisine, à la couture, peut-être à l’infirmerie... et certainement dans l’alcôve (...) comme repos du guerrier » [2].
La sympathie de Watkins pour la Commune est indiscutable. Le cinéaste rappelle les avancées sociales et politiques que celle-ci a rendues momentanément possibles, et note les perspectives extraordinaires qu’elle a ouvertes. Il ne cache pas cependant les difficultés rencontrées par les communards, difficultés existant non pas seulement parce que Paris est en état de guerre, mais aussi à cause de l’impréparation, de l’incompétence de certains d’entre eux.
Il évoque la désorganisation régnant au sein de certains groupes ou certaines institutions, les conflits suicidaires qui déchirent les meneurs de la révolution, les tentations dangereusement autoritaires de certains d’entre eux, le retour de vieux démons révolutionnaires. Il montre les déceptions que ressentent certains communards, la désillusion qui les frappe quand le pouvoir communal s’installe et prend ses décisions.
Une des premières mesures décidées par les élus à l’Hôtel de Ville est de fermer les séances au public. La population, quand elle apprend cette nouvelle, proteste fermement. Dans un café, une femme lance : « C’est le début du secret, c’est le début de la manigance. Le peuple a le droit de savoir ». Un homme questionne : « Pourquoi, tout de suite, on voudrait nous confisquer le pouvoir ? ». Un autre répond : « Pour reproduire le système du passé ».
On sait qu’effectivement, le 28 mars, le délégué aux Affaires Extérieures, Paschal Grousset, réclame le secret des délibérations, considérant que la situation vécue alors est celle d’une guerre civile et que l’ennemi n’a pas à savoir ce qui se passe au sein de l’Assemblée communale. Son collègue Arthur Arnould n’est pas d’accord. Il juge le secret immoral, et rappelle que la Convention de 1792 délibérait « sous les yeux du peuple ». Grousset obtient gain de cause, mais concrètement les procès-verbaux des séances de l’Assemblée seront publiés au Journal Officiel à partir du 18 avril.
L’idée a germé assez tôt dans l’esprit de certains communards de créer un Comité de Salut Public chargé de centraliser fortement le Pouvoir, de le concentrer entre les mains d’une poignée de gouvernants, et qui fut donc constitué le 1er mai. Un carton précise que le nom donné à ce groupement est lourd de signification : « Le Comité de Salut Public, pendant la révolution de 1789, fut célèbre pour la terreur politique qu’il fit régner dans Paris. Parler de Salut Public en 1871 c’était raviver de sinistres souvenirs » [3].
Le journaliste de la télévision communale qui annonce la constitution du Comité ne peut cacher sa colère. Il démissionne peu après en expliquant que les « principes de la Commune » ont été trahis.
Les tensions qui ont existé entre le Comité Central de la Garde Nationale (à l’origine de l’insurrection, et ayant administré Paris du 18 au 28 mars) et la Commune (assemblée issue des élections du 28 mars) sont évoquées à plusieurs reprises dans le film. On sait que les membres de la Commune considéraient qu’il fallait fondre toutes les forces en une seule, qu’il fallait centraliser l’action dans le but de vaincre les Versaillais. Le Comité Central, avec Édouard Moreau à sa tête, ne partageait pas ces vues. Il considérait son existence autonome comme légitime. Il restait attaché à un principe de démocratie décentralisée et directe. Il ne voulait pas s’associer à la politique de la Commune et entendait développer vis-à-vis d’elle un « antagonisme » fort.
L’opposition, au sein de l’assemblée, entre une minorité, considérée comme socialiste ou girondine, et une majorité, jacobine, est évoquée dans le film. La minorité critique la politique de lutte armée souhaitée par la majorité, la dictature incarnée par le Comité de Salut Public, et souhaite que soit instaurée immédiatement la démocratie directe. Elle décide de quitter l’Hôtel de ville, le 15 mai. Une partie du manifeste rédigé par 22 membres de la minorité est lu à l’écran par des personnages représentant certains d’entre eux. On sait que le 21 mai, les minoritaires rentrent dans le rang... Mais, à ce moment, les Versaillais commencent à entrer dans Paris...
Au moment de la chute du Fort d’Issy, le spectateur assiste à une réunion de membres importants de la Commune. Ceux-ci critiquent le fait que les communards parlent beaucoup, mais agissent peu [4]. Ils dressent un constat sévère concernant l’action accomplie et établissent une liste des problèmes qui n’ont pas été traités jusqu’alors : difficulté à mettre en place l’enseignement laïque, notamment par manque de moyens financiers - l’argent étant utilisé pour faire la guerre ; dégradation de la situation militaire ; absence d’organisation de la Garde Nationale ; manque de réformes permettant une amélioration de la situation des femmes.