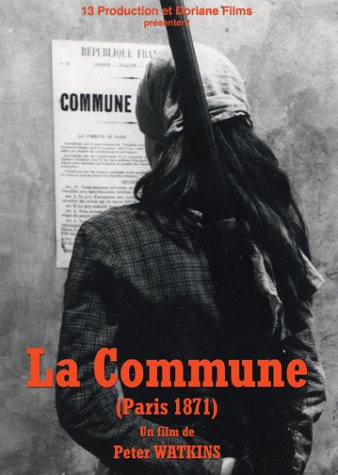On l’a vu, Peter Watkins entend, à travers son film, lier le présent au passé, faire passer l’un à travers le prisme de l’autre. Il cherche à montrer que l’Histoire se répète. Que les problèmes qui ont mené à l’insurrection communarde, que les difficultés que les révolutionnaires de 1871 ont rencontrées, que la répression exercée par les exploiteurs sur les exploités quand ceux-ci veulent changer leurs conditions d’existence, que les revendications de ces exploités, traversent l’Histoire. En somme, que la lutte menée par les communards est encore d’actualité.
Il propose une certaine pédagogie de l’Histoire, qui fait connaître et explique une époque donnée à travers des rapprochements signifiants avec d’autres époques, en assumant d’ailleurs le risque de la confusion des temps et des discours. Cette confusion est susceptible d’être créée du fait de l’insertion, non pas tant de rapprochements que d’anachronismes comme, par exemple, la présence dans le quartier Popincourt d’une institutrice noire...
Le dispositif consistant à introduire des journalistes de télévision (avec leurs micros, que l’on voit, et leur caméra, que l’on devine) qui vont commenter, interpréter, parfois travestir les événements de la Commune, qui vont interroger ceux qui vivent de près ou de loin ces événements, est bien sûr le principal de ces anachronismes. Il permet de rendre actuel l’objet de représentation (la Commune), de montrer comment la presse audiovisuelle d’aujourd’hui traiterait les événements de mars, avril et mai 1871...
Peter Watkins critique fortement le travail des journalistes, le jeu que jouent les mass medias dans le monde moderne, y compris ceux qui sont censés être dans le bon camp. Il fustige le refus de prendre parti et le goût du sensationnel. On sent que les journalistes de la télévision communale essayent de plaire au spectateur en lui souriant artificiellement et en lui parlant de façon complice et complaisante, en cherchant non pas seulement à l’informer, mais à créer des émotions, une certaine forme de spectacle.
Le premier problème important se pose quand ces journalistes commencent à sélectionner l’information, quand ils décident, pour ne pas susciter la peur du public, de ne pas mentionner à l’antenne le fait que certains communards ont très tôt la volonté de centraliser de façon dictatoriale le pouvoir, quand ils décident de ne pas évoquer un article publié dans le Père Duchêne qui prône la création du Comité de salut Public.
Le deuxième moment fort concernant la télévision communale, c’est lorsque ce Comité de Salut Public est effectivement créé. Le collègue de Blanche Capelier est nerveux, anxieux. Il ne peut s’empêcher d’exprimer sa colère contre le retour des « jacobins », des héritiers de Robespierre. Blanche Capelier lui reproche alors de donner son opinion. On apprend que, le lendemain, ce personnage masculin joué par Gérard Watkins démissionne pour protester contre ce qu’il considère être une « trahison des principes de la Commune ». Revient alors en mémoire l’autocritique à laquelle s’était livrée Blanche Capelier au début du film, quand elle parlait de sa crédulité, de son « optimisme forcené », de son absence de dénonciation des moyens de communication de masse.
Il est étonnant de voir que c’est le journaliste qui a démissionné qui continue à tendre le micro aux communards, durant la Semaine sanglante. Il ne capitule pas comme Blanche Capelier semble l’avoir fait. Mais bientôt il se fondra vraisemblablement dans la foule des insurgés : quelqu’un lui enjoint d’abandonner son micro. Le temps n’est plus à la représentation, mais à l’action... Ce n’est pas un hasard si ce journaliste est incarné par un membre de la famille du réalisateur, et si le prénom du personnage n’est pas différent de celui de l’acteur. En s’adressant à lui, les insurgés s’adressent également à Peter Watkins. Le dispositif de la télévision communale est, à un certain niveau, une représentation du dispositif cinématographique. De même qu’il met en cause le médium télévisuel, le cinéma dans son ensemble, en tant qu’industrie de spectacle, Peter Watkins, semble accepter de mettre en question sa propre position de cinéaste faisant peu ou prou partie de ce système...
À travers la critique de la couverture télévisuelle des événements de 1871 qui sont ramenés au présent, une critique des médias de l’époque de la Commune est également menée. Mutatis mutandis, la presse du XIXe siècle se comportait déjà comme la télévision d’aujourd’hui, même si on a un peu l’impression que Watkins lui reconnaît cette capacité, qui se serait perdue, de prendre des positions idéologiques et politiques fortes, de s’engager. Lorsque le chroniqueur du Père Duchêne reproche aux deux journalistes de la télévision communale de ne pas mentionner l’article sur le Comité de Salut Public, et qu’il constate leur manque d’esprit critique et de prise de position claire par rapport à la situation dont ils ont à rendre compte, il considère négativement le caractère très lapidaire des interviews proposées par le médium télévisuel. À ce moment-là, Blanche Capelier et Gérard Watkins renvoient la critique à leur confrère en notant que, dans le Père Duchêne, les textes sont également courts et saccadés, écrits sur un rythme agressif, et ponctués de slogans nécessairement réducteurs.
Un certain nombre de problèmes qui sont évoqués par les communards lorsqu’ils parlent dans le micro de la télévision communale ou lorsqu’ils débattent entre eux sont manifestement des problèmes actuels ou relativement récents, et des problèmes commentés dans le langage d’aujourd’hui (rappelons que les acteurs avaient souvent à créer leur texte par eux-mêmes, mais aussi à l’improviser). Sont ainsi évoqués la position de la femme dans la société, son exploitation au travail, au foyer, sa nécessaire émancipation ; l’interdiction de l’avortement par l’Église ; le problème des sans-papiers, c’est-à-dire des étrangers vivant dans la société française, mais qui en sont officiellement exclus parce que leur situation n’est pas en règle [1]. Et lorsqu’ une femme parle de la syphilis, de la honte que l’on impose à la personne malade, de la difficulté à obtenir des médicaments, on ne peut s’empêcher de penser aux problèmes liés au Sida.
Tout au long du film, à travers des cartons et l’expression de certains personnages originaires d’Afrique du Nord, la situation insurrectionnelle en Kabylie (Algérie) est évoquée et mise en relation avec celle que connaît Paris, de même qu’est évoqué le ralliement de certains Spahis à la Commune [2]. Ici, le mouvement centrifuge par rapport au point central que constitue la Commune se fait sur un axe diachronique (on pense à la guerre d’Algérie, aux combats des autochtones pour leur indépendance ; aux problèmes actuels rencontrés par les immigrés venus du Maghreb sur le territoire français), et sur un axe synchronique (des échos à l’insurrection communale se faisaient entendre ailleurs que dans la capitale, en France et hors de France).
À un certain moment du film, des réunions de femmes, d’ouvriers sont filmées. Elles ont lieu dans des cafés, dans des églises converties en clubs révolutionnaires. Mais ce sont les acteurs qui s’expriment. Ils s’essayent à une analyse de ce qui s’est passé lors de la Commune et évoquent les rapports qu’ils sentent et établissent entre le Paris de 1871 et la société de la toute fin du XXe siècle dans laquelle ils vivent ; ils cherchent à tirer les leçons de l’Histoire [3]. L’un d’eux constate à ce propos : « Ce que j’ai cru comprendre, c’est qu’il y avait une volonté de destruction de la part des Versaillais qui était en germe bien avant que l’on prenne les armes, et que cette volonté de destruction, moi j’ai le sentiment qu’en 1999, on la retrouve à chaque fois qu’on essaye de faire une avancée, de prendre un tout petit peu de pouvoir, de liberté, de liberté publique. Et que si on en prend, et bien on retrouvera en face de nous les fusils, les canons, exactement pareil. Alors, ils n’ont pas pris la Banque [4]]... Est-ce que nous on va se décider un jour à prendre la Banque ? (...) Est-ce qu’on va s’attaquer au pouvoir des autres ? ».
D’autres personnes, à d’autres moments, évoquent leur travail et leur expérience lors du tournage du film. L’une des actrices témoigne : « Je voudrais parler du travail que je suis en train de faire avec Peter (...). C’est un processus [à travers lequel il est question] de la Commune. Pendant ce tournage, en tant que travailleuses... en tant que comédiennes, dans ce film, il nous a fallu (...) trouver notre démocratie pour pouvoir avancer pendant ce processus, laisser la place aux autres, pouvoir prendre la sienne. J’ai trouvé qu’il y avait un parallélisme avec la Commune, parce que je pense que cela a été très très difficile (...) d’être démocrate quand il y a des désirs très forts, quand les gens sont poussés par des énergies d’espérance et que la foule rend les choses difficiles à atteindre profondément. Et, dans ce film, on avait parfois cette joie qui partait comme ça et on partait avec, et quelques déceptions qui nous faisaient retomber et rechercher notre place. J’ai trouvé ça très passionnant »... Nous allons revenir sur cet important rapprochement entre l’expérience du tournage du film et ce que l’on sait de l’expérience de la Commune...
Au moment de la bataille finale, les communards qui défendent Paris sur les barricades s’expriment dans le micro du journaliste de la télévision communale. Celui-ci est nerveux, agressif. La caméra est extrêmement mobile, les plans sont serrés. Là encore, comme c’était parfois le cas dans les réunions de personnages/acteurs dont il vient d’être question ci-dessus, la frontière se fait indistincte entre 1871 et 1999. Le journaliste demande à certains participants s’ils seraient allés sur les barricades pour défendre la Commune.
Les personnes interrogées semblent rejouer dans le présent et dans une tragique urgence ce qui s’est déroulé au moment de la Semaine sanglante et qu’ils ont la charge, en tant qu’acteurs, de restituer. Mais elles semblent également vivre une révolte et une action subversive et insurrectionnelle dans leur présent. Une femme lance : « On va se battre, on va continuer à se battre. Et bien sûr qu’on va gagner, on est là pour ça ». Qui parle, l’actrice ou le personnage ? À partir de quel point de vue temporel cette femme s’exprime ?
Un trouble peut parfois saisir le spectateur. Il semble saisir les personnes interrogées elles-mêmes qui, déstabilisées, perdant la maîtrise d’elles-mêmes, confondent les époques, sont prises dans le tourbillon de la révolte. La femme dont il vient d’être question répond ainsi au journaliste qui lui demande si elle serait allée se battre à l’époque de la Commune : « Oui, j’y serais allé, parce qu’aujourd’hui de la même façon il faut continuer à se battre ».
Watkins cherche manifestement à mettre en scène une révolte insurrectionnelle dans le présent. Il la montre, l’appelle de ses voeux. Il veut exacerber les énergies dont il dispose. À travers son film, il cherche à les canaliser pour mettre en cause la société actuelle. À ce qu’il semble, certains acteurs, poussés dans leurs retranchements, incommodés par la tournure que prenait le tournage lors de la représentation de la Semaine sanglante, ont reproché à Watkins des méthodes jugées violentes et manipulatrices. Ils semblent avoir vécu le tournage sur le mode du psychodrame.
C’est, selon Patrick Watkins, le fils du cinéaste qui a participé à l’élaboration du film, à partir de ce moment que l’idée se serait fait jour de tourner des scènes où des acteurs, ayant pris place dans le « café », discuteraient du film, de leurs positions par rapport aux événements de la Commune et aux événements de cette fin du XXe qui peuvent leur être comparés.
Au montage, ces scènes ont donc été insérées avant la représentation de la Semaine sanglante. Cela dit, tout le monde n’est pas d’accord, ni avec l’attitude des acteurs se rebellant contre le cinéaste, ni avec l’interprétation de la situation que propose Patrick Watkins. L’actrice Myriam Belhiba, avec laquelle nous nous sommes entretenus, affirme que le film est une « oeuvre d’art » et qu’il était normal que son auteur soit « maître à bord » ; qu’il ne faut pas confondre « manipulation » avec utilisation des « implications individuelles pour les orienter vers quelque chose de collectif ».
La situation est cependant intéressante, car elle renforce cette idée d’une mise en abyme de l’événement et de sa représentation. Comme le phénomène de la Commune, comme le compte-rendu qui en est fait par la presse de l’époque, comme la représentation télévisuelle qui donne à voir à la fois la Commune et le travail de la presse de 1871, le dispositif filmique est bien mis en question, de même qu’est susceptible de l’être celui qui l’utilise, en l’occurrence Peter Watkins - et même si ce dispositif est le produit d’une démarche qui se veut en rupture avec celles qui prévalent dans l’industrie de l’art cinématographique. Comme si l’esprit de subversion, la volonté de critiquer celui qui dirige, oriente la vie des individus (en l’occurrence les acteurs sur le tournage), et la volonté de réclamer l’appropriation des instruments de représentation, se propageait à tous les niveaux de l’oeuvre, y compris au niveau de l’instance où elle se réalise.
Certains collaborateurs de Peter Watkins, on l’a déjà entraperçu, considèrent d’ailleurs plus ou moins explicitement que le tournage du film, ce qui s’y est déroulé, est comparable au mouvement communard. Que les acteurs se sont parfois crus sur le théâtre réel de la Commune et que l’esprit de révolte qui les animait s’est naturellement retourné contre celui qui dirigeait ces comédiens, contre celui qui, sur les lieux de tournage, représentait d’une certaine façon l’autorité. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Patrick Watkins, le fils de Peter Watkins, parle à un moment, significativement, de l’« insurrection » des comédiens. Et l’actrice Marie-Reine Bernard, avec laquelle nous nous sommes également entretenus, en évoquant à cette occasion le paradoxe du comédien, considère que les acteurs devenaient parfois à tel point leur personnage que « toute contrainte venant de l’extérieur était mal vécue ».
Notons pour conclure que La Commune est en fait la poursuite d’un travail de représentation de l’Histoire et de l’actualité que Peter Watkins a commencé dès 1964, avec son tout premier film. Dans La Bataille de Culloden, le réalisateur cherchait déjà à faire la chronique très précise du déroulement d’un événement historique : la destruction, par les Anglais protestants, du système des clans dans les Highlanders, clans constitués par des catholiques. Il s’agissait d’expliquer les tenants et les aboutissants de la bataille, de présenter aussi bien les personnalités d’importance que les humbles combattants, de montrer les erreurs et les folies du camp catholique qui vont l’amener au désastre, autant que la politique génocidaire des Anglais.
Dans La Bataille de Culloden comme dans La Commune, les personnages parlent face la caméra et la regardent. Un commentateur se trouvant hors champ en interroge certains. Et, par ailleurs, un personnage de la diégèse a un peu le rôle que tient, en 1871, le journaliste du Père Duchêne. C’est Andrew Henderson, historien du camp des Whigs, biographe de Cumberland et « témoin de la bataille de Culloden ». Il informe le spectateur sur certains événements qui se déroulent sur le champ de bataille et que la caméra ne montre pas. Il fait le lien entre le monde diégétique, par rapport auquel il est dans une position relativement extérieure, et l’instance narratrice, qu’il fait comme pénétrer au coeur des combats.