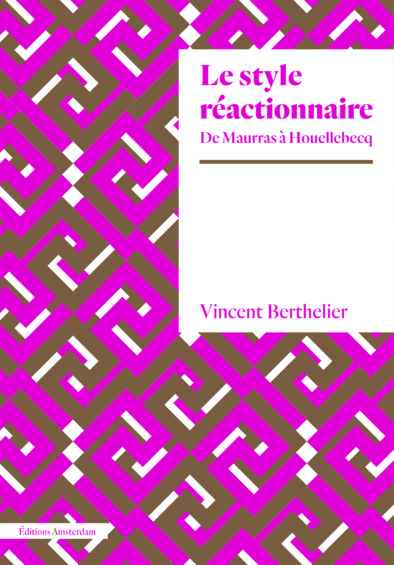
Dans l’entreprise de réhabilitation menée par les Hussards, le style joue un rôle crucial, et pas seulement comme pratique d’écriture : ces écrivains se sont aussi efforcés de forger un nouvel imaginaire stylistique. On le voit dans le numéro de juin 1955 de La Parisienne, avec l’entretien collectif intitulé « Existe-t-il un style littéraire de droite ? ». Jacques Audiberti (poète qui avait publié dans le premier numéro de la NRF de Drieu) y propose tout un développement sur les styles de gauche et de droite. Avançant d’abord que cette distinction n’a pas de sens, Audiberti se lance ensuite dans une vaste prétérition : si l’on prenait la distinction au sérieux, on pourrait attribuer au style de droite l’aisance, la fluidité, l’élégance, la désinvolture, un rythme « impair » et bâclé. À gauche, le style est laborieux, carré, travaillé, il roule des muscles. D’un côté l’aristocratie, de l’autre le prolétariat. À droite, Mme de Lafayette, Saint-Simon, Lamartine, Musset, Stendhal, Verlaine et Drieu. À gauche, Bossuet, Michelet, Hugo, Péguy, Zola et Jaurès. Audiberti articule le style à un corps (délicat et manucuré, ou au contraire transpirant et musculeux) en même temps qu’à un camp politique (Péguy ou Michelet « suggèrent la CGT »).
Les autres participants de l’entretien attaquent le fanatisme des écrivains de gauche, soumis aux ordres de la collectivité. Paul Sérant résume cela de la manière suivante : « Jusqu’à la dernière guerre, la droite défendait la Cité et la gauche l’individu. Depuis la guerre il semble que ce soit un peu le contraire. La droite se confond avec un certain individualisme, un certain scepticisme, tandis que la gauche, qui a pris le pouvoir un peu partout en Europe, défend la collectivité, le sens de la cité. »
Tout en euphémisant les causes historiques du renversement qu’il mentionne (le fascisme et la collaboration), ce propos fait du style l’incarnation par excellence de l’individualisme. C’est un retournement impressionnant des représentations réactionnaires. Contrairement à la conception néo-classique maurrassienne et à ses ramifications, qui exigeaient du style l’expression adéquate des idées, les Hussards et leurs amis revalorisent le style pour lui-même, et réduisent la politique à une affaire de goût. L’imaginaire stylistique ainsi refondé demeure réactionnaire, d’aspiration aristocratique et antidémocratique. Moins expressif que suggestif, le style n’est cependant plus en adéquation directe avec des idées (nationalistes, traditionalistes), mais avec une posture de dédain et de dandysme.
Ce revirement s’explique par le contexte politique de la Libération. J’ai rappelé que Céline attribuait l’origine de ses « malheurs » à ses audaces stylistiques. Sans surprise, Nimier (qui travaille pour Gallimard) œuvre à sa réhabilitation en suivant la même ligne de défense : « Crime beaucoup plus grave aux yeux de certains, [Céline] continue à couper ses phrases de points d’exclamation ou de points de suspension. » Il en fait de même pour les autres collabos : Morand, Jouhandeau et Chardonne sont autant de purs stylistes dont les engagements doivent être tenus pour nuls.
Les Hussards reprennent le « Fiat ars – pereat mundus » de Rebatet ou Drieu – non plus cette fois sous la forme romantique d’une esthétique de la destruction, mais sous la figure désinvolte de l’indifférence. Une figure rhétorique qui -l’illustre bien, c’est le parallélisme, chez Jacques Laurent par exemple :
« La France sous l’Occupation a pris l’habitude de se diviser entre ceux qui comprenaient que les Allemands nous pillent et ceux qui comprenaient que les Anglais nous bombardent. »
À un moment où les oppositions partisanes sont aiguës, et où l’asymétrie des valeurs politiques est patente, le parallélisme introduit une « dialectique mutilée ». Il pose dans la langue « l’équivalence de Tout et Rien », caractéristiques de la pensée de droite selon Beauvoir. Or ce n’est pas, loin de là, le seul trait de style qui remplisse cette fonction et nourrisse l’idée opportune d’irresponsabilité.
L’irresponsabilité passe par un thème fondateur : l’enfance. Les titres des Hussards en sont témoins : L’Europe buissonnière (1949), Les Enfants tristes (1951), Le Petit Canard (1954), Les Bêtises (1971). L’esprit d’enfance transparaît aussi dans leurs modèles littéraires, comme Dumas : Nimier, qui a préfacé Les Trois Mousquetaires, en écrit la préquelle avec D’Artagnan amoureux ou Cinq ans avant (1962) ; Jacques Laurent a préfacé Le Comte de Monte-Cristo, qu’admire le héros des Bêtises. Les protagonistes de leurs romans sont jeunes : Sanders n’a pas quinze ans au début des Épées (1948), et Muguet, le héros de L’Europe buissonnière de Blondin, est un gamin qui, à cause d’un problème de glandes, a l’apparence d’un adulte… Petits soldats de la droite, les Hussards aiment à se forger une image d’enfants attardés.
La jeunesse, c’est un thème privilégié du fascisme – mais le rapprochement est un peu facile. C’est aussi une préoccupation bernanosienne : Nimier, qui aurait rencontré Bernanos vers 1946 ou 1947, lui consacre un de ses premiers essais (Le Grand d’Espagne, 1950), et lui emprunte un de ses titres (Les Enfants tristes font écho aux Enfants humiliés). Mais, tandis que chez Bernanos, l’enfance symbolise la situation de la jeune génération (celle qui a fait la guerre de 1914 et celle qui lui succède : générations sacrifiées et désespérées), chez les Hussards, elle incarne l’insouciance et l’insolence. Singulier retournement quand on y songe : pour les réactionnaires, l’enfance est généralement l’image de ceux qui ne peuvent pas raisonnablement se gouverner eux-mêmes (le peuple, la femme, le colonisé). Avec les Hussards, elle devient une figure par excellence de la liberté.
Cette figure de sales gosses est également entretenue par la dimension ludique de leur écriture. Nimier construit les nouvelles des Indes galandes autour de jeux ou de devinettes. Le premier titre publié par Laurent est fondé sur un jeu de mots : La Mort à boire (1947). Mais les calembours sont surtout la spécialité de Blondin (L’Ironie du sport, « On crie vendange », « Le promeneur solidaire », etc.). L’auteur d’Un singe en hiver pratique aussi la syllepse, ou glissement sémantique : « une éminence grise, vêtue d’un manteau de même couleur ». Autre jeu apprécié par eux : la naturalisation sauvage des mots anglais, dont Marcel Aymé avait lui-même fait un usage abondant (« bohiscoutes », « claquesonne », etc.).
Tous trahissent en outre un penchant pour les blagues de mauvais goût. Dans L’Europe buissonnière, on lit par exemple : « La Guittonnière appartient aujourd’hui à un type de Paris, nommé Lévy d’Anjou. — Un Juif ? — Ça, pour te dire, on n’a jamais su si Lévy s’était fait appeler d’Anjou, après la guerre de quatorze, ou si d’Anjou s’était fait appeler Lévy, après les grèves de trente-six. » La blague repose en fait sur deux prémisses, antisémites et réactionnaires : les juifs ont profité de la guerre de quatorze pour usurper des brevets de francité ; les grèves de trente-six étaient manipulées par les juifs.
Dans le même ordre d’idée, cette plaisanterie de Nimier sonne comme du Rebatet : « Les “dispos”, forme familière pour “disponibles”, étaient des membres du péhésef, prêts à toute éventualité qui ne serait ni dangereuse, ni salissante. » Ce qui change, entre Rebatet et les Hussards, c’est le détour par la forme non assertive et humoristique. À -l’esprit de sérieux du pamphlétaire, indigné par l’inaction du colonel « de la Locque », ils opposent leur ethos badin et relativiste. Encore faut-il souligner que ce changement d’ethos -s’explique par un changement de contexte. Les plaisanteries visent moins à attaquer les juifs, ou a fortiori le défunt PSF, qu’à signifier leur attachement à des aînés littéraires et une commune sensibilité idéologique.
Les Hussards du contingent
L’irresponsabilité infantile a son équivalent dans la construction des romans, tant les aventures que traversent les héros des Hussards sont sans conséquences, pour de rire. Ces antihéros sont indécis, maladroits, ballottés par les hasards, et héroïques par mégarde (leur virilité n’est en revanche jamais mise en cause, et ils multiplient comme il se doit les aventures féminines). Sanders, le héros de Nimier, passe de la Résistance à la Milice au gré des circonstances. Dans L’Europe buissonnière de Blondin, Muguet s’engage dans la guerre de 1939 à cause d’une amourette, puis cherche désespérément un stalag où se faire emprisonner, afin de terminer la guerre tranquillement. Quant au héros du Petit Canard, Antoine, s’il « entre à la L.V.F. c’est parce qu’un officier polonais a embrassé celle qu’il aimait ». Aucun n’est mû par des principes, ni par une conviction politique ferme.
Cet antihéroïsme s’inscrit dans l’écriture elle-même, et dans certains stylèmes, comme les causalités non pertinentes. Voici par exemple comment le Sanders des Épées explique sa présence dans la Résistance : « De toute façon, il y avait entre les Allemands et moi mille sujets de brouille. Leur allure appliquée, leur sang sur les mains – tellement semblable aux taches d’encre sur les doigts des bons élèves… »
Dans cet humour dandy, les critères esthétiques prennent le pas sur les principes éthiques, et les taches de sang suscitent le même dégoût que les taches d’encre. Dans Le Hussard bleu, Sanders dit rester dans l’armée française parce que « le bleu marine [lui] va bien au teint ». Les prisonniers échappés du stalag dans L’Europe buissonnière justifient leur évasion par les motifs les plus farfelus : « Je reçois une carte de ma femme, une tous les quinze jours, tu sais ce que c’est ; voilà-t-il pas que, dans la dernière, cette garce m’annonce qu’elle va vendre la machine à jambon… une machine qu’on m’a livrée à la veille de la mobilisation… Hein, et moi je resterais là, sans lever le petit doigt, comme un couillon. »
L’argument, évident pour le personnage, ne l’est évidemment pas pour le lecteur, ce qui produit un décalage ironique. Mais l’accumulation de raisons incongrues (le suivant s’évade parce qu’il ne reçoit pas de chocolat dans ses colis, le troisième parce qu’il ne supporte pas l’air libre, qui lui cause des suffocations, et le dernier, « par principe », parce qu’il est garde mobile) finit par installer l’idée qu’il n’y a au fond pas de bonne raison, juste et héroïque, de s’évader – ni de résister, ou de collaborer. Une machine à jambon n’est pas un motif plus absurde que d’autres, dans ce nivellement général des causes. Les romans des Hussards adoptent un parti pris anti-réaliste, où l’Histoire est une somme de circonstances fortuites auxquelles les personnages ne peuvent pas grand-chose, et où les seules causes à garder un peu de consistance sont les inclinations des individus. Ce n’est pas un hasard si dans Les Épées, Sanders finit attablé à la terrasse du Lafcadio – discrète allusion à l’acte gratuit gidien.
Dans le contexte de la Libération, à un moment où -l’extrême droite a perdu sa position héroïque (celle d’après 1914), cet humour antihéroïque a un sens politique. La figure du soldat incompétent se place dans le prolongement du défaitisme de droite, des années 1930 à la drôle de guerre (selon les réactionnaires, l’armée française était composée d’incapables amollis par le pastis et les congés payés). Mais surtout, les Hussards s’inscrivent en faux contre l’héroïsme de l’épopée gaullienne ou communiste. La réfutation et la dispersion des causalités dans le roman trouve d’ailleurs son pendant dans le pamphlet de Jacques Laurent contre de Gaulle – où il affirme que la France aurait été libérée même sans l’existence du général, et que l’on surestime toujours notre maîtrise sur le cours des événements.
Cause toujours
Si les actes héroïques n’ont aucune motivation consistante, subséquemment les actes ignobles n’en ont pas davantage. Quand Faypoul, le héros-romancier du Dormeur debout (1986) de Jacques Laurent, demande à des miliciens ce qui les a déterminés à intégrer la Milice, ils répondent par les mêmes bouffonneries que les évadés de Blondin :
— Pourquoi es-tu entré dans la milice ? demanda Faypoul. À cette question il avait déjà entendu des réponses diverses. L’un avouait franchement qu’il avait évité une petite peine de prison en s’engageant, un autre, voué par sa mère au culte de Jeanne d’Arc, […] tenait à bouter les Anglais ; un hégélien lui avait assuré que l’Europe nazie constituait une étape nécessaire dans la dialectique de l’histoire. — Moi, dit le jeune homme, j’avais été recalé quatre fois au baccalauréat, j’ai trouvé que la société était injuste et qu’il fallait la brusquer.
Quarante ans après, Jacques Laurent poursuit encore l’entreprise de réhabilitation des collaborateurs au nom de leur irresponsabilité. La ligne de défense est similaire à celle employée par Marcel Aymé. Jean Dutourd parlait pour sa part des romanciers qui avaient « fait l’andouille » sous l’Occupation. Le protagoniste du Dormeur debout regrette quant à lui de s’être « fourvoyé dans une connerie ». Ce genre d’euphémisme fonctionne toujours mieux adossé à l’humour : la faute n’est qu’à moitié avouée, mais se croit déjà pardonnée.
L’écriture des Hussards met en cause toutes les causes, celles qui expliquent et celles pour lesquelles on s’engage. C’est au cœur de ce que Jacques Laurent reprochait à Sartre, « romancier à thèse », en 1951 :
Deux expressions reviennent souvent l’une chez Jean-Paul Sartre, l’autre chez Paul Bourget. « Ce n’est pas par hasard que… » répète le premier. Et l’autre : « Il faut en chercher la cause dans… » Ce n’est peut-être pas par hasard que ces deux écrivains à thèse emploient facilement des expressions aussi peu romanesques. Il faut en chercher la cause dans une communauté de formation rhétorique.
Derrière la brillante raillerie adressée au pape de la littérature engagée, Laurent trace une frontière entre le domaine esthétique (romanesque en l’occurrence) et le domaine explicatif ou philosophique, qu’il renvoie à des habitudes scolaires. La causalité bien affichée, ça sent le devoir de bon élève, pas le roman. Au contraire, quand le personnage de romancier Faypoul explique sa manière d’écrire, il la fonde sur tout autre chose que la causalité rationaliste : « Ce livre s’appela d’abord La Vie de château. […] Comme je me répétais mon titre en m’endormant et que sans chercher vraiment je jouais avec lui en l’altérant, je tombais sur Vide-château. Ce terme comparable à vide-poches et à vide-ordures était à la fois l’effet du hasard et de l’intérêt que je portais à cette génération spontanée du langage. »
La réflexion dépasse le registre du calembour : il s’agit bel et bien, comme dans les jeux surréalistes, de laisser parler l’inconscient et la langue elle-même. Le sens se produit hors du raisonnement logique, et donc hors d’une écriture explicative et « à thèse ». Ainsi, cette poétique formulée en 1986 – un peu à contretemps donc – se rattache à un questionnement sur le langage résolument moderne, teinté de psychanalyse, anti-logiciste, et pas dépourvu de connotations libertaires.
Pour résumer, la situation historique de l’extrême droite (compromise sous l’Occupation) la pousse à la fois vers une position intellectuelle (l’irrationalisme, la pensée historique de la contingence), et vers une posture, une théâtralisation de soi faite de dandysme infantile et désinvolte. Cette position et cette posture s’articulent à un style, caractérisé par une pratique non logique de la langue (la syllepse, le calembour, le défigement) et par une syntaxe romanesque qui met en cause les logiques causales, ruinant le principe de tout engagement et de toute responsabilité. Pour des raisons plus politiques qu’intrinsèquement esthétiques, les Hussards développent une écriture commune, et qui effleure des enjeux proches des avant-gardes de leur temps (Nouveau Roman et structuralisme).


