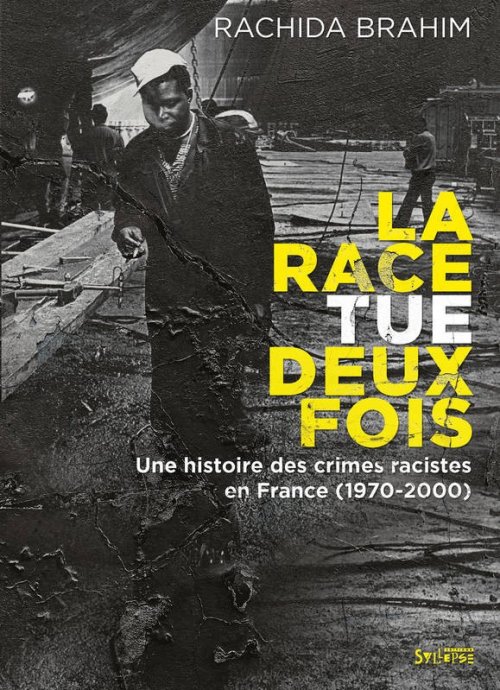
Pourquoi dites-vous que « la race tue deux fois » ?
« La race tue deux fois », cette phrase résume pour moi ce que j’ai compris à travers cette enquête. Il y a d’une part, le premier coup porté par le racisme : le fait que les personnes soient violentées, touchées dans leur intégrité physique, en vertu de ce qu’elles représentent dans la tête de l’agresseur. C’est la première violence. Mais il y a une deuxième violence, c’est le fait que le système pénal ne reconnaisse pas la violence subie comme une violence raciste. Il touche alors la personne dans son intégrité psychique. La race tue deux fois, c’est cette double violence. À la fois physique et psychique, à la fois interpersonnelle et institutionnelle.
Comment avez-vous été amenée à travailler sur le sujet ?
Il y a plusieurs raisons, au croisement de mon histoire personnelle et de la grande histoire. Je suis française et algérienne. Mes parents ont immigré en France dans les années 70. Et j’ai grandi avec ce qu’on appelle la « post-mémoire », comme surement beaucoup d’enfants dont les parents ou les grands-parents ont vécu une violence de masse. La post-mémoire, c’est l’idée qu’en tant que descendant d’un crime collectif, on garde en mémoire cette violence, sans l’avoir vécue directement soi-même. Je pense que cette post-mémoire m’a habitée pendant longtemps et qu’elle continue de m’habiter. Et c’est elle qui m’a poussée à me mettre en quête d’éléments de réponse sur la violence raciale, la violence coloniale et post-coloniale.
Ensuite, il y a une dizaine d’années, j’ai rencontré des personnes qui m’ont parlé de crimes racistes restés impunis, et de toute l’injustice que cela représentait à leur yeux. Étrangement, alors qu’elles me parlaient d’un problème, c’est comme si elles venaient de me donner un élément de réponse, comme s’il y avait là une clé, quelque chose à creuser qui allait m’éclairer davantage. J’ai alors entamé cette recherche qui a mis en évidence le fonctionnement du racisme structurel, donc un sujet très dur mais, paradoxalement, très éclairant. Parce qu’il me semble qu’il vaut mieux vivre avec une violence que l’on comprend qu’avec une violence que l’on peut s’expliquer, retracer, qu’avec une violence sur laquelle on ne peut mettre aucun mot.
Vous dites que l’enjeu est de "Dire ce qui eut lieu, donc. Mais aussi comment et pourquoi". Qu’est-ce que cela fait apparaitre et qu’est-ce que cela rend possible ?
Il y avait d’abord une idée d’administration de la preuve. Les personnes que j’ai interrogées ont témoigné de crimes racistes dans les années 1970, 80, 90. Elles avaient la mémoire de ces évènements-là. Leur parole est extrêmement précieuse, juste et valable. Je reconnais pleinement la valeur du témoignage au sein de l’enquête en sciences sociales. Mais il y a aussi beaucoup de disqualification autour de ces paroles qui dénoncent le racisme. J’ai donc fait le choix d’aller chercher la preuve de ce qu’elles disaient ailleurs, d’objectiver leur sentiment d’injustice, en décrivant comment ça a eu lieu. Ce qui m’a menée vers les archives de la police, de la justice, de la presse, du parlement, du ministère de l’intérieur. L’idée était de voir non seulement le fait, l’interaction entre l’agresseur et l’agressé, le comment, mais aussi de regarder à l’échelle macrosociale, sur le temps long, dans quoi s’inscrit ce crime-là, dans quelle généalogie, dans quelle structure sociale, quel contexte géopolitique, le pourquoi. Et ce qui est apparu c’est la manière dont le racisme structure nos sociétés.
J’ai eu besoin de retracer cette histoire, presque de redonner corps à ces morts tombés dans l’oubli, de faire un linceul. Il y avait l’idée de réparer. Dire comment et pourquoi, ça apporte une réparation, je crois. Derrière ça, il y a la notion de soin. De prendre soin de moi, mais aussi de toutes les personnes qui se sentent concernées par cette violence-là. Et je crois qu’on est tou·te·s concerné·e·s. C’est donc à la fois faire un linceul pour les morts, et un onguent pour les vivant·e·s, les apaiser, en disant très clairement que ces personnes sont mortes du racisme interpersonnel mais aussi institutionnel et structurel, dire aussi que la violence coloniale continue. Le dire à voix haute, paradoxalement, ça fait du bien. C’est une phrase terrible, mais cette violence est plus terrible quand elle est tue.
Vous tracez une continuité historique et sociale entre la guerre d’Algérie, les crimes coloniaux et les crimes policiers aujourd’hui en France. En Belgique, les violences policières tuent également. Qu’est-ce qu’un travail comme le vôtre peut nous permettre de comprendre de cette actualité ?
Ces violences policières résonnent avec cette notion de racisme d’Etat, puisque ce sont des crimes qui sont commis par des représentants de l’Etat. Les victimes de ces crimes policiers sont des individus qu’on a définis comme étant différents, inassimilables, dangereux, posant problème. Or, pour qu’ils existent comme problème, il faut que parallèlement, l’Etat ait défini qui est la norme. C’est cela qu’on appelle le racisme d’Etat : le fait que l’Etat se serve de la race comme un levier, un mécanisme, pour différencier les individus. Et ensuite, qu’il use de la violence qu’il peut exercer légitimement parce qu’il a autorité pour le faire, de manière à contraindre ces corps, les discipliner et les faire mourir à force de violence et d’exclusion.
Est-ce que la législation antiraciste, telle qu’elle existe aujourd’hui en France, suffit pour lutter contre le racisme, et notamment pour reconnaître et punir ces crimes ?
En l’état actuel des choses, non. Il y a eu un long combat pour faire du mobile raciste une circonstance aggravante, qui a commencé dès les années 1970 avec le Mouvement des travailleurs arabes en France, avec la Marche pour l’Égalité qui a suivi dans les années 80, le MIB, l’ensemble des « comités Vérité et Justice » qui se sont créés depuis et les émeutiers dans les banlieues, qu’on a qualifiés de délinquants et qui étaient en fait mus par ce même désir de justice et de reconnaissance de la violence qui avait été faite. Et il a fallu attendre 2003 pour qu’une loi fasse du racisme une circonstance aggravante en France, mais dans des conditions assez restreintes, parce que c’est très difficilement mobilisable en procès. Il faut que l’auteur des faits ait prononcé avant ou pendant le crime une injure raciste, ce qui n’est pas toujours le cas et qui est très difficile à prouver, d’autant plus si la victime est décédée des suites de l’agression.
Non seulement le Droit a mal reconnu cette idée du mobile raciste, mais en plus il s’est évertué, à chaque nouvelle loi en France sur la question, à insister sur le fait que les violences qui étaient dénoncées étaient des violences tout à fait ordinaires, qu’il n’y avait pas de Droit particulier qui devait s’appliquer-là, pour ces personnes, qu’elles étaient comme les autres. On a convoqué un Droit universaliste, républicain, qui est le même pour tous, pour des personnes qui étaient pourtant constamment renvoyées à quelque chose de particulier, y compris dans d’autres pans de la loi d’ailleurs, comme dans le domaine de la politique du logement, ou de l’immigration, la législation antiraciste, déracialise donc des personnes qui sont racialisées dans d’autres pans de l’action publique. Il y a ce double mouvement constant au sein des lois et des politiques publiques : ces personnes se plaignent de violences qu’elles subissent en vertu de la question raciale, et on les renvoie à quelque chose d’universel.
Vous distinguez différents types de violences motivées par le racisme qui traverse et structure la société. En quoi ces violences racistes touchent différemment les hommes et les femmes ?
Dans les archives, j’ai recueilli 731 cas de crimes racistes : des agressions, des attentats et des homicides. Ce qui est frappant, c’est que sur les 731 cas, il y a seulement dix cas qui touchent directement les femmes. Les faits réaccueillis montrent donc que c’est un type de violence qui touchent plus massivement les hommes. Cela est à raccrocher aux représentations héritées de la période coloniale, de l’homme africain ou arabe, de l’homme des cités, dangereux, qu’il faut discipliner, déshumaniser. Alors que la femme est perçue différemment. Mais cela ne signifie pas qu’elles ne subissent pas de violence. Je pense que ce ne sont pas les mêmes types de violence, ce ne sont pas forcément des crimes, mais elles existent. Et peut-être qu’elles ont seulement été moins visibilisées que celles qui touchent les hommes. Quand j’en ai parlé avec les personnes que j’ai interviewées, la question du suicide est apparue à demi-mot. Il y a aussi la question des discriminations, des humiliations et la violence psychique que cela cause. Et puis le viol, évidemment, qui était une arme de guerre pendant la période coloniale. Je n’ai pas enquêté là-dessus mais cela mériterait une grande enquête.
Vous avez expliqué dans la presse qu’on vous a reproché de « ne pas être objective », puisque vous étiez vous-même d’origine algérienne. Est-ce que vous pourriez réagir là-dessus ?
Ce qui m’a frappée, c’est que cette question de la subjectivité, on ne la posait pas à mes collègues. Seules certaines subjectivités sont suspectes. À travers cela, on me dit que je ne peux pas penser ma condition, que je suis une subalterne, et que les subalternes ont besoin d’un regard extérieur pour se penser elles-mêmes. Je pense que cela s’inscrit dans une longue tradition de sciences sociales qu’on n’a pas pris le temps de décoloniser. Si l’on prenait ce temps-là, il apparaitrait clairement que nous sommes tous subjectifs et que nous devons tous interroger nos subjectivités.
Vous dites également que dans votre travail, le "regard sociologique surplombant et distancié" n’est pas adéquat. Quelle est donc votre approche et que rend-t-elle possible ?
Personnellement ce travail a fait naître en moi un profond besoin de réenchanter le monde. Je n’ai quasiment rien pour le faire, mais j’essaye de définir une posture, une manière d’être qui soit de ce registre-là. Je m’évertue à mettre mon humanité à l’œuvre et je convoque celle des autres, en disant « cette chose-là, cette idée de race, est absolument abominable, mais regardons-là en face et prenons-en soin. A l’inverse, je crois qu’en restant aveugle à la race, on participe consciemment ou non à cette violence. Par conséquent, c’est aussi une posture éminemment politique parce qu’elle est intransigeante et elle va à l’encontre de tout un système qui lui s’évertue à nous abrutir et nous déshumaniser.
Qu’est-ce que vous avez appris de ce travail en tant que sociologue, mais également en tant que femme, française, fille de parents algériens ?
Le métier de sociologue est passionnant, il permet de dévoiler les mécanismes cachés qui sont à l’œuvre, de se donner les moyens d’aller voir par-delà ce qu’on nous donne à lire les fils sous-tendus qui permettent à tels ou telles violences de perdurer, et aussi à telle ou telle résistance de perdurer. En tant que sociologue, c’était l’enjeu de mon travail.
A titre personnel, ça a été salvateur d’étudier le racisme structurel parce que, comme je le disais, j’avais besoin de comprendre, cerner, décrire, et mettre en récit cette violence, c’est comme si ça venait combler des brèches. Ça vient réparer des fissures, ça vient restaurer quelque chose, à titre individuel et, je l’espère, pour d’autres personnes aussi. Il y a vraiment cette idée de nous restaurer en mettant des mots. C’est la puissance du récit, d’un récit qui soit complet, qui ne soit pas amputé de tout un pan. C’est ça qui répare. C’est d’avoir remis ces morts-là au centre, de leur avoir redonné un corps. C’est comme s’ils étaient cachés sous le tapis. Et là, on a enlevé les tapis, on a lavé les corps, on leur a préparé une sépulture, on a mis des bougies autour. J’ai ces images qui viennent en tête. C’est étrange, mais c’est comme ça que ça m’a travaillé depuis le début, et encore maintenant. C’est l’image d’Antigone qui enterre son frère. Je voudrais que cette chose-là soit un bien commun. Parce que je pense que faire ça, c’est bon pour tout le monde. On ne peut pas vivre avec des morts sous le tapis. Ce n’est pas possible.
Une dernière question, pour finir, comment voyez-vous l’avenir, qu’est-ce que vous estimez nécessaire comme changement ?
Ce livre-là nous dit quelque chose sur la violence du monde social, qui est extrêmement ancrée, profonde, tentaculaire, à la fois dans le temps et dans l’espace. Et en avoir conscience, être lucide là-dessus, ça doit nous pousser à résister, c’est-à-dire vivre de manière intempestive, être très exigeant, vigilant, mais également participer à se conscientiser, à conscientiser les autres. J’ai l’impression ce qui rend le monde meilleur, c’est à la fois de mener des luttes sociales pour rendre le monde plus égalitaire, mais aussi d’opérer un retour sur soi, creuser en soi, pour continuer à devenir toujours une meilleure version de soi-même. J’ai l’impression que ces deux choses-là vont ensemble. Si chacun fait cet effort-là, je pense que ça peut donner des choses plus fécondes et plus prospères. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait très envie de faire ça, c’est un gros travail, mais ce qui me donne espoir, c’est qu’on est très nombreux à la faire. Et ce qui fait du bien, c’est de se connecter à des personnes qui partagent ces idéaux et ces valeurs, cette manière de voir le monde. La fraternité, la sororité, ça a un réellement un sens profond. C’est très puissant quand ça vous prend. Puissions-nous tous connaître ce sentiment.


