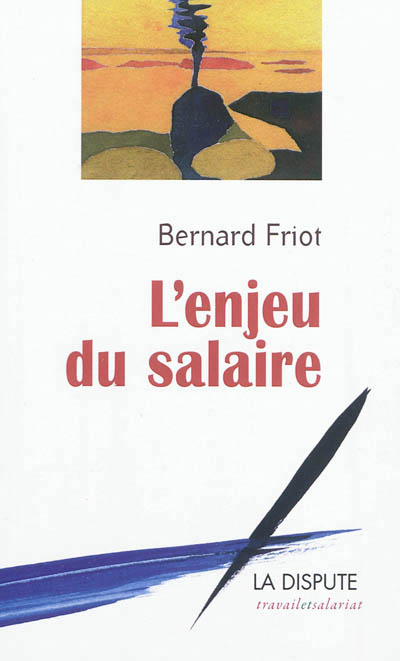
Qu’est-ce qu’on produit ? Comment ? Qui produit ? La réponse à ces questions simples, mais décisives, dépend de l’organisation du pouvoir dans la société. C’est pourquoi elles ne seront pas les mêmes dans une société patriarcale, théocratique, féodale, capitaliste, car elles dépendent de ce qui est considéré comme ayant valeur parmi tout ce qui est produit d’utile, et de la façon dont on mesure cette valeur économique qui doit conforter le pouvoir des dominants.
La flotte commerciale bretonne était au 16ème et encore au début du 17ème siècles plus importante que celle des Provinces Unies, mais ce sont les Pays Bas qui ont conquis un empire car bretons et néerlandais n’avaient pas la même conception de la valeur économique : aussi bien est-ce en Bretagne qu’on visite des enclos paroissiaux, et pas chez les iconoclastes bataves.
C’est dire que la valeur économique change d’une société à l’autre… et donc que celle que nous connaissons n’a pas toujours existé et n’existera pas toujours : c’est réconfortant, surtout si on pense au désastre auquel nous ont conduit la définition et la pratique capitalistes de la valeur économique. On peut en sortir, car le salaire nous fournit toutes les armes pour le faire : le capital nous tient sous la dictature du temps de travail, le salaire nous en libère par la qualification.
Nous n’allons pas nous attaquer ici, d’entrée de jeu, à cette démonstration qui est le cœur de ce livre, mais faire sentir l’ampleur du déplacement à opérer dans le regard que nous portons sur le salaire. Ce regard est aliéné, et les idées reçues sont un très gros obstacle aux émancipations radicales dont le salaire est porteur.
Insistons ici sur deux d’entre elles.
La première, c’est que le salaire sert à satisfaire les besoins des travailleurs.
En témoigne l’expression courante, sans rapport au demeurant avec Marx, du salaire comme « prix de la force de travail » : nous avons une force à entretenir par le salaire.
La seconde, c’est que le salaire est la rémunération du travail. Ici nous sommes dans l’appréhension du salaire comme contrepartie de la productivité du travailleur, comme prix du produit de son travail.
Ainsi, tour à tour, ou en même temps, le salaire, défini comme « prix du travail », ou « revenu du travailleur », est considéré comme le gagne-pain et la récompense de l’effort. Et s’il ne l’est pas, il devrait l’être : avec son salaire, on doit pouvoir vivre et faire vivre ceux dont on a la charge, et chacun doit être payé à proportion de la pénibilité ou de la responsabilité de son travail.
Mais il faut bien voir que ces deux propositions aboutissent au même résultat : faire du salaire un « pouvoir d’achat ». C’est évident pour la première : le salaire permet d’acheter de quoi continuer à travailler. Mais c’est vrai aussi pour la seconde : si le salaire paye le produit de son travail, le travailleur en le touchant « a son compte », il n’a pas d’autres droits sur son travail que d’en tirer un revenu. Le salaire « donne un pouvoir d’achat à la mesure du travail fourni », voilà l’idée reçue dont il faut sortir.
Le salaire, revenu du travailleur et rémunération du travail : une impasse
Cette idée reçue entraîne deux dérives de pensée, qu’on désignera ici sous les termes de contrepartie et de minorité sociale. Elles pèsent dans l’impossibilité où a été jusqu’ici la mobilisation populaire, si forte soit-elle, d’infléchir le cours de la réforme initiée par Giscard d’Estaing dès 1973, reprise à leur compte par Mitterrand et Delors à partir du « tournant de la rigueur » de 1982, et engagée à marche forcée depuis le gouvernement Rocard en 1988.
Pire : loin d’être mis en difficulté du fait des turpitudes éclatantes des acteurs des marchés financiers qu’ils servent, les réformateurs, qu’ils s’appuient sur des majorités de gauche ou de droite, invoquent au contraire ces turpitudes pour accélérer le rythme et approfondir le niveau de la régression des droits sociaux construits au cours du siècle précédent.
Nous en avons un exemple incroyable avec l’austérité présentée comme inéluctable pour envoyer un « signal positif » aux agences de notation, alors que leurs analyses sont menées du point de vue des intérêts des actionnaires et des prêteurs. C’est le sauvetage depuis quatre ans de ces derniers qui a relancé l’endettement des Etats. Un endettement structurel depuis quarante ans, depuis l’interdiction de financement des dépenses publiques par la banque centrale et le mouvement de baisse de la part des impôts dans le PIB, deux politiques délibérées qui donnent tout le pouvoir aux prêteurs.
La condition pour sortir de cette imposture est de bien mesurer l’importance des tremplins qu’offre le salaire. Or ils ne sont pas vus. D’où l’importance de bien identifier ce qui ne va pas dans la représentation du salaire courante chez celles et ceux qui s’opposent à la régression des droits sociaux. Examinons successivement la minorité sociale et la contrepartie.
La minorité sociale renvoie à la définition classique du salarié : en échange de la subordination à un employeur qui assume le risque de la production, il a droit à la sécurité de ses ressources. Une part du droit du travail s’est construite sur cette structure asymétrique du rapport salarial, et entretient cette représentation du salaire comme ce qui est dû à un mineur social : un pouvoir d’achat pour satisfaire ses besoins.
Que le salaire soit lu comme le prix de la force de travail, et donc référé aux besoins du travailleur, n’a pas toujours fait de celui-ci un être réduit à ses besoins. Il y a eu une époque, celle de la classe ouvrière organisée, où la définition du salaire comme prix de la force de travail a été le vecteur d’une affirmation des salariés comme classe de producteurs.
Le raisonnement était le suivant : c’est nous qui produisons la valeur, mais nous sommes volés d’une partie de ce que nous produisons parce que nous sommes payés pour la valeur de notre force de travail et non pour celle du produit de notre travail. Cette proposition (qui pose un autre problème, celui de la contrepartie, comme nous allons le voir, et aussi d’une possible légitimation de la valeur travail) été marginalisée au bénéfice de revendications qui insistent sur la hausse du pouvoir d’achat et non plus sur la suppression du profit.
Avec comme conséquence que la force de travail n’est plus un concept explicatif de l’exploitation capitaliste, mais une donnée de nature : chacun « a une force de travail », y compris les travailleurs indépendants ou les fonctionnaires (qui, comme nous le verrons, n’en ont pas, et c’est tant mieux !) et le salaire doit permettre de la reproduire. Ce qui était dénonciation du capitalisme qui réduit les personnes à de la force de travail mesurée par le temps de sa production et nie leur propriété sur la valeur devient dénonciation d’une injustice devant un capitalisme banalement défini par la soif du profit, et nourrit la revendication d’un meilleur partage de la valeur ajoutée grâce à la construction par l’action syndicale d’un rapport de forces plus favorable aux travailleurs.
Il faut dire qu’en dénonçant comme elle le faisait la plus-value, la classe ouvrière organisée a revendiqué que les salariés soient payés pour la valeur de leur travail, mais a peu dénoncé explicitement la valeur travail et le marché du travail qui, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, sont au cœur de la définition (et de la pratique !) capitaliste du travail. Les travailleurs se sont battus pour la qualification, surtout dans la négociation des conventions collectives, et ce fut une mobilisation magnifique dont il faut tirer maintenant tous les fruits en mettant explicitement en cause l’existence d’un marché du travail avec des forces de travail et des employeurs.
Une telle mise en cause n’a jamais été portée massivement et ne s’est exprimée, sporadiquement, que dans des moments très brefs comme à la Libération ou dans l’après-68, avec les entreprises réquisitionnées ou mises en autogestion. Quant aux nationalisations pratiquées à grande échelle à la Libération ou en 1981, elles n’impliquaient pas davantage la gestion par les travailleurs eux-mêmes des entreprises publiques ni le changement de sens de la valeur économique.
Si l’on se tourne vers la représentation courante du salaire comme rémunérant la productivité, elle ne pose pas davantage la question de qui décide de la production et sur la base de quelle définition de la valeur. La revendication d’une meilleure reconnaissance du produit du travail dans le salaire ne s’accompagne d’une mise en cause ni de la forme que prend la valeur économique ni du partage des tâches entre propriétaire et salariés, qui ôte à ces derniers toute maîtrise sur le produit de leur travail.
Rien d’autre n’est dû aux salariés qu’une juste rémunération. Le travailleur produit pour être payé. Son « capital humain » est envisagé non pas du point de vue de la maîtrise de la production qu’il lui permettrait, mais du seul point de vue du revenu qu’il est en droit ou en capacité d’en tirer. C’est un mineur social. S’il veut maîtriser son travail, qu’il se « mette à son compte », même si cette mise à son compte, idéal largement partagé en milieu populaire, est illusoire de ce point de vue, comme on l’a toujours vu et comme on le voit aujourd’hui avec les auto-entrepreneurs.
Examinons maintenant l’autre conséquence de la représentation du salaire comme pouvoir d’achat à la mesure du travail fourni : la problématique de la contrepartie du salaire en travail. Sa prégnance a des manifestations nombreuses. En 2010 par exemple, le principe d’une « carrière complète » n’a pas été mis en cause dans la mobilisation considérable contre la réforme des retraites. Et pourtant, c’est une double peine que la condition d’annuités inflige aux femmes, qui non seulement arrivent à 60 ans avec un salaire inférieur aux hommes et donc un espoir de pension inférieur, mais en plus se voient pénalisées une seconde fois au nom du caractère incomplet de leur carrière !
Ce n’est pas simplement à cause de la décote que la pension moyenne en droits directs des femmes est de plus de 45 % inférieure à celle des hommes alors que leur salaire est de 25 % inférieur. C’est d’abord et avant tout à cause du principe même des annuités, qui fait que leur pension, déjà calculée sur la base d’un salaire de référence plus faible, est amputée par la proratisation.
Bien sûr, les opposants à la réforme ont critiqué, et à juste titre, la décote. Mais aucun des partis, aucun des syndicats qui se sont fortement impliqués dans la lutte contre la réforme des pensions n’a revendiqué la suppression des annuités et donc de la proratisation. Les réformateurs et leurs opposants étaient certes en conflit sur la durée de cotisation exigée pour la carrière complète, mais on a assisté à une montée en puissance idéologique de la condition d’annuité soit avec la revendication du retour aux 37,5 années à la FSU, à SUD ou à FO, soit avec celle de la CFDT, encore plus significative, d’en finir avec l’âge légal et de tout miser sur la durée de cotisation, le silence de la CGT sur la carrière complète accompagnant avec embarras cette dérive générale du mouvement syndical.
Qu’il ait fallu cotiser, et cotiser un certain temps, pour avoir droit à pension, est aujourd’hui de l’ordre de l’évidence, alors qu’un régime en répartition, puisqu’il n’est pas fondé sur l’accumulation d’un capital, peut se créer et distribuer des prestations du jour au lendemain. C’est ce qui s’est fait en 1947 pour l’AGIRC. Un régime en répartition socialise le salaire au temps t, il ne le transfère pas de t-1 en t comme s’il s’agissait d’une prévoyance. Or la thématique du « salaire différé » a progressé au cours des dernières années, c’est un des principaux résultats idéologiques des coups de boutoirs réformateurs.
Des exemples ? La convention de l’UNEDIC de 2009 entre la partie des syndicats signataires et le Medef pose comme norme « un jour presté pour un jour cotisé ». Les réformateurs préconisent, en matière de pension, la « neutralité actuarielle individuelle », sur le modèle suédois : chacun accumule (fictivement : nous sommes en répartition) les cotisations de toute sa carrière sur un compte qui, pour calculer la pension annuelle à laquelle il aura droit au moment où il prendra sa retraite, sera divisé par l’espérance de vie de son groupe de référence (cohorte en Suède, groupe socio-professionnel dans les projets français) : de sorte que la somme des pensions sera l’égal de la somme des cotisations.
Nous verrons pourtant comment la seule revendication qui prolonge ce qui s’est construit avant la réforme est : 100% du meilleur salaire à 60 ans (sans salaire inférieur au SMIC), quelle que soit la durée de carrière ou la somme des cotisations. Car la pension s’est construite non pas sur le réactionnaire « nous avons cotisé, nous avons droit à un revenu différé » ou, ce qui revient au même, « nous avons travaillé, nous avons droit à un repos mérité », mais sur le révolutionnaire « nous avons enfin une qualification personnelle et un salaire à vie, nous pouvons maîtriser enfin notre travail ». L’impossibilité dans laquelle sont les opposants à la réforme d’énoncer cette proposition tient à leur attachement à la représentation de la contrepartie du salaire en travail, et donc de la pension en travail passé.
Or cette position empêche de lire le neuf dont est porteur le réel, et de ce fait rend plus difficiles des changements émancipateurs radicaux. Ces thématiques récentes rejoignent des thématiques plus anciennes comme celle des « charges indues » qui mettent en cause la prise en charge par la sécurité sociale de prestations non liées à des cotisations préalables ou « non liées au travail », qui devraient être prises en charge par l’impôt et non par le salaire. C’est ce qui a fondé l’argumentaire de la contribution sociale généralisée (CSG), comme si la production des soins de santé d’une personne était moins « liée au travail » que celle de ses cigarettes ou d’une voiture, qui sont, elles, assumées sans débat par le salaire.
On voit que l’argument est inepte, mais il a pour lui la paresse intellectuelle de la contrepartie « naturelle ». C’est aussi au nom de la contrepartie que LOLF de Jospin et RGPP de Sarkozy orchestrent la mise en cause du salaire au grade : selon ces réformateurs, le salaire des fonctionnaires doit rémunérer le travail qu’ils fournissent dans le poste qui est le leur, ce qui est une négation du statut de la fonction publique, qui confère au fonctionnaire un grade, c’est-à-dire une qualification personnelle et le salaire à vie qui va avec. Et dans le privé qui ignore la qualification des personnes mais où s’est construite par convention collective la qualification du poste, même celle-ci est mise en cause parce qu’elle subvertit la façon dont le capitalisme pose le temps de travail comme mesure de la valeur. Partout la rémunération au mérite des réformateurs tente de prendre le contre-pied du salaire à la qualification ; cette entreprise si mortifère pour le travail est possible parce qu’elle rejoint la représentation tellement courante du salaire comme contrepartie d’un temps de travail.
Généraliser un déjà-là émancipateur
Cet ouvrage tente de suivre une ligne de crête. Pour échapper à l’impuissance des opposants à la réforme, il s’agit de dépasser à la fois :
– les propositions de la social-démocratie de gauche [1], dominante chez les opposants, qui, parce qu’elle partage peu ou prou la représentation du salaire comme pouvoir d’achat à la mesure du travail fourni sans voir la contestation de la valeur économique capitaliste qu’il représente, épuise depuis vingt ans les mobilisations dans des revendications très en-deçà de ce que la réalité du salaire rend possible en termes de sortie du capitalisme ;
– les propositions minoritaires de celles et ceux qui, décidés à sortir du capitalisme mais ne voyant pas, elles et eux non plus, les tremplins qu’offrent pour ce faire les institutions du salariat, errent à chercher la sortie dans l’abolition du salariat ou la fin du travail et de la monnaie.
Cette ligne de crête, c’est celle d’une action politique délibérée de sortie du capitalisme s’appuyant sur le déjà-là émancipateur présent dans les deux dimensions du salaire qui se sont imposées dans le conflit salarial du vingtième siècle : la qualification personnelle et la cotisation sociale finançant du salaire. Tel qu’il s’est construit de manière conflictuelle au 20ème siècle, le salaire s’est chargé de dimensions tout autres que celles par lesquelles on le désigne habituellement. En un mot : il ne relève ni du pouvoir d’achat ni de la contrepartie, ni des besoins du travailleur ni de la mesure de son temps de travail, il repose sur une autre mesure de la valeur économique, celle de la qualification, et ouvre la perspective de l’affirmation de la capacité de chaque salarié - et du salariat pris comme ensemble d’institutions alternatives à celles du capital - de décider de la valeur économique et de sa mesure. Et c’est en cela qu’il est un déjà-là émancipateur, au cœur des puissances du salariat [2]]].
« Tu es payé, tu as ton compte, restons en là ». Définir les producteurs par la ressource qu’ils tirent de leur « capital humain », et non par leur capacité de décider de la valeur économique et donc de ce qui va être produit, par qui et comment : telle est la représentation du travailleur, et partant du salaire, que tente d’imposer le capital. La loi de l’été 2007 fondatrice du sarkozysme, la loi TEPA, a fait depuis l’objet d’un débat politique nourri sur le bouclier fiscal ou la suppression des cotisations et impôts des heures supplémentaires, qui en sont des mesures phares. Mais a-t-on pris garde à son titre, qui sonne comme la devise du quinquennat : « travail, emploi, pouvoir d’achat » ? Si la classe dirigeante entend affirmer le lien entre travail, emploi et pouvoir d’achat, c’est que ce lien est un des lieux essentiels de son pouvoir.
Il faut aller plus loin : une classe est dirigeante pour autant que la représentation des choses qu’elle met en scène est partagée par une majorité. Pour la classe dirigeante, afficher « travail, emploi, pouvoir d’achat » sur les frontons de la République est possible parce qu’une majorité adhère au fait que le travail s’exerce dans le cadre d’un emploi et donne au travailleur un pouvoir d’achat, et que cela est bon : plein emploi, hausse du pouvoir d’achat, qui a à y redire ? Poser – comme je le fais dans ce livre – qu’il faut, et que nous pouvons, nous libérer de ce consensus, c’est souligner l’ampleur du déplacement de nos représentations qu’impose l’indispensable – et la possible, nous allons le montrer en détail - sortie du capitalisme.
De même, en appréhendant le salaire du point de vue du pouvoir d’achat et non du point de vue de la valeur économique, on s’empêche de voir comment il est possible de s’appuyer sur lui pour supprimer le crédit et de la propriété lucrative et on en reste à des propositions de taxation du capital, de nationalisation des banques et de certaines entreprises décisives, de création de monnaie par la banque centrale pour financer des investissements publics. L’enjeu du salaire, c’est la possibilité de sortir du capitalisme. Non pas de le contenir, non pas de bouger le curseur de la répartition de la valeur ajoutée en faveur du salaire et au détriment du profit, mais de se passer des capitalistes, d’affecter toute la valeur ajoutée au salaire, y compris la part qui doit aller à l’investissement. Nous n’avons besoin pour travailler ni d’employeurs ni d’actionnaires ni de prêteurs, et nous le prouvons depuis soixante ans dans les pays capitalistes les plus avancés.
Pour conclure, revenons au titre de ce chapitre qui invite à passer, dans l’analyse du salaire, « du pouvoir d’achat au pouvoir économique ».
Insistons sur toute l’épaisseur du pouvoir économique, qui est à comprendre à la fois comme maîtrise et comme nouvelle définition de la valeur économique. Car à quoi bon prendre le pouvoir économique si c’est pour faire pareil faute de changer la mesure de la valeur ? Aussi bien ce livre marche-t-il sur deux pieds. Il s’agit de maîtriser la valeur économique, oui, mais pour en changer le sens. Suppression du marché du travail et de la mesure de la valeur par le temps de travail, attribution à tous d’une qualification et d’un salaire à vie ; suppression du crédit et de la propriété lucrative par une cotisation économique et une création monétaire articulée à la qualification : le salaire fonde ces possibles parce qu’il les pratique déjà à grande échelle et avec une remarquable efficacité.


