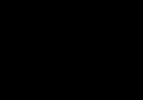Céline et Julie vont en bateau, sorti en 1974, est un film révolutionnaire. « Mis en scène » [1] par un des cinéastes français les plus singuliers (Jacques Rivette), son originalité réside notamment dans l’association rare qu’il opère, entre un jaillissement collectif (projet de Juliet Berto et Dominique Labourier, modalités d’écriture polyphonique extrêmement originale [2] , production soucieuse de favoriser la liberté des auteurs due à un artiste remarquable : Barbet Schroder) et une mise en forme absolument libre.
Sa philosophie féministe, et la réflexion politique sur le cinéma qu’il propose, ont déjà été évoquées ici même par Pierre Tevanian (dans Les Spectatrices émancipées). Dans la continuité de cette lecture, il s’agira ici de proposer une lecture analytique du récit (extrêmement drôle et enthousiasmant, mais aussi déconcertant et hermétique) qui ouvrira, nous l’espérons, vers de nouvelles interprétations.
Le caractère fantastique [3] de l’intrigue, ainsi que l’importance des jeux de langage liés à une quête existentielle, impliquent une réflexion à la fois thématique et symbolique visant à proposer différentes hypothèses sur le « sens caché » de certaines composantes du récit.
Céline (Juliet Berto) est donc une prestidigitatrice travaillant dans un petit cabaret de Montmartre, et Julie (Dominique Labourier) une bibliothécaire passionnée par la magie et l’occultisme.
Ensemble elles s’engagent dans une quête autour d’une vieille maison, au 7 bis rue du Nadir aux pommes, qui semble être le lieu d’étranges souvenirs qu’elles revisitent grâce à des séances de visions hallucinées survenant après ingurgitation d’un mystérieux bonbon vert. L’intrigue de ces visions, ce « film » mis en abyme, semble recommencer éternellement la même comédie bourgeoise que des acteurs, de plus en plus blafards, semblables à des fantômes, incarnent de manière caricaturale.
Entre ces moments de visions, les deux jeunes femmes, devenues complices et amies, s’amusent à déjouer les plans de deux dominants : un fiancé ridicule et un imprésario sans scrupules.
« Le plus souvent, ça commençait comme ça. »

« ... ça commençait comme ça ». Quoi donc ? Dans un jardin parisien, une jeune femme (Julie) assise sur un banc, lit un livre de magie et prononce des incantations. Une autre femme (Céline) passe devant elle en laissant tomber plusieurs objets que Julie ramasse au fur et à mesure. Julie l’interpelle, mais Céline ne se retourne pas et poursuit sa course.
Elles se retrouvent face à face : elles ne parlent pas, ne semblent pas se connaître, mais leurs regards sont ironiques, leur attitude visiblement ludique... Le chat et la souris. Alice poursuivant le lapin.
Julie, après avoir escaladé la butte Montmartre à pied (alors que Céline montait en funiculaire), traversé une brocante et attendu Céline devant un cabaret, se retrouve subitement essoufflée au pied d’un hôtel dans lequel son amie est entrée. Le personnage de Lewis Carroll se retrouvait au pays des merveilles (un terrier symbolisant l’inconscient) – après une chute. Céline et Julie se retrouveront devant un espace symbolisant aussi comme nous le verrons, leur inconscient, après une ascension suivie d’une promenade à travers le passé – incarné par cette brocante (vendant des bibelots, des objets anciens : motifs jouant un rôle primordial dans le scénario). En somme, l’anamnèse – le récit des antécédents jouant un rôle essentiel dans l’analyse, prend ici la forme d’une remontée dans le temps, au sens littéral, réalisée concrètement et physiquement par ces deux femmes qui semblent avoir mis en scène et inventé cet exercice qui les confronte, comme nous le découvrons dans la suite du film, à un passé douloureux et refoulé.
Jeu de rôle
Un nouveau carton nous indique que la scène suivante a lieu « le lendemain matin » : elles font connaissance assez singulièrement dans un café puis se séparent sans avoir échangé aucun renseignement particulier. Elles se retrouvent (par hasard ? Céline a-t-elle suivi Julie ?) dans la bibliothèque où travaille Julie, puis devant la porte de l’appartement de cette dernière. L’atmosphère devient étrange. Leurs échanges semblent n’avoir aucun sens. Puis elles échangent leur identité, leur vie (Céline se faisant passer pour Julie va régler son compte à « Guilou », le « fiancé d’enfance » de Julie qui, de son côté, s’occupera de l’imprésario...), explorent ensemble leur passé et leurs souvenirs.
Sommes-nous dans un monde merveilleux ? C’est bien l’impression que nous donne la vision de ces images étonnantes, lorsque nous voyons à plusieurs reprises l’une ou l’autre deviner les secrets de son amie [4], ou lorsque nous nous interrogeons sur le statut des images de ces films qu’elles se font après avoir ingurgité le fameux bonbon vert.
Mais pourquoi le premier carton (« le plus souvent, ça commençait comme ça... ») ? En quoi ces rencontres, ces poursuites, ces jeux de séduction, ces bizarreries, ces dialogues loufoques peuvent-ils constituer une habitude ? Le film nous présente-il une situation archétypale, ou faut-il prendre les choses à la lettre, et émettre l’hypothèse que Céline et Julie se (et nous) montent un bateau : qu’en vérité elles se connaissent, et qu’elles se livrent à une série de jeux, d’exercices physiques et spirituels, qui au premier abord pourraient nous laisser penser qu’elles ne se connaissent pas, alors que visiblement, le fait qu’elles puissent se connaître et faire exprès, correspondrait tout à fait à l’esprit ludique et léger qu’elles révèlent tout le long du film. « Le plus souvent, ça commençait ça » voudrait dire alors : le plus souvent, confrontées à certaines situations, dont il faudra préciser la nature, elles agissaient comme nous le voyons au début du film.
La dernière scène où le même jeu se reproduit avec une inversion des rôles (Céline est assise et Julie court devant elle) semble bien confirmer cette thèse.
« Journée perpétuelle »

Lors de leur (fausse ?) rencontre dans l’appartement de Julie, Céline prétend être poursuivie par ses anciens patrons – deux femmes et un homme chez lesquels elle travaillait comme nourrice d’une petite fille. Ce dernier détail est, curieusement, deviné par Julie.
Sous la douche, dans un récit de vacances très loufoque, Céline raconte à Julie, qui est restée dans la pièce voisine, l’histoire d’un certain « tigre of Bengali » et celle d’un « Roi des Pygmées » amoureux d’elle, qui lui offre la peau d’un tigre. Puis survient dans le récit, une certaine « Zuba », maléfique et jalouse, qui voulait la peau de Céline afin de pouvoir épouser le Roi – raison pour laquelle Céline a finalement dû « se tailler ».
Céline se retrouve donc, dans ses deux récits, sous des modalités différentes, au milieu d’un même schéma : deux femmes, un homme, une menace, une victime et une fuite. Or, est-ce exactement le schéma qui structure les films qu’elles se font sous bonbon vert. Lors d’une visite de Julie à sa nourrice – voisine du 7 bis rue du Nadir aux pommes, nous apprenons en outre qu’un souvenir d’enfance fort traumatisant inspire certainement ces films : les voisins lui raconte-t-elle ont subitement disparu, sont tous partis sans donner de nouvelles, les parents, la petite qui avait le même âge que Julie ainsi que l’infirmière dont elle avait si peur.
Qu’est-il arrivé exactement à la petite fille ? [5] Comment Céline peut-elle le connaître au point d’en raconter plusieurs fois différentes versions ? Dans lesquelles elle apparaît à chaque fois dans des rôles de victime ? Céline est-elle Madlyn qui a grandi – et Julie son ancienne voisine, ou bien une petite amie qui la connaît depuis son enfance ?
Ce que nous apprenons en outre lors de la visite chez la vieille nourrice, c’est que « Bengali » est aussi le surnom d’enfance de Julie. Céline le savait-elle en le plaçant au milieu de son récit pastichant le souvenir traumatisant de leur enfance ? « Tigre of Bengali » au lieu de « tigre du Bengale »... Le détournement, le mélange des langues, le décalage, sont-ils gratuits, ou bien s’agit-il de mise en œuvre stratégiques dont le but serait de pouvoir prononcer ce mot qui ne laisse pas Julie indifférente ? Un plan de coupe nous la montre alors surprise, chuchotant depuis le salon, alors que Céline lui précise que le Bengale est une région, que « Bengali » est aussi le nom d’un oiseau. Au courant de la polysémie de ce mot, sait-elle que c’est aussi le nom d’un zébu ? Un zébu « à robe rouge » nous dit le dictionnaire – comme la méchante dame du film sous bonbon vert qui « veut la peau de Madlyn »... et comme « Zuba » qui voulait la peau de Céline en compensation de la perte de la peau du « tigre of Bengali ». ..
Zuba/zébu, tout comme persil / esprit ou « boa conquistador » / « boa con qui m’adorait », les approximations langagières et les détournements inventifs des personnages peuvent ne pas être innocents. L’inconscient est structuré comme un langage, dit-on, et c’est pourquoi l’analyse consiste souvent en un travail sur ledit langage, ainsi que sur les rapports que nous entretenons avec les récits mythiques : n’est-ce pas précisément ce à quoi se livrent Céline et Julie ?

À deux reprises, peu après leur rencontre, Julie demande à Céline l’adresse de la maison de ses patrons. Et nous voyons que Céline fait en sorte de ne pas répondre la première fois, et ment carrément la seconde en prétendant l’avoir déjà donnée la veille. Curieusement, alors que nous savons que cela est faux, Julie l’approuve et prononce distinctement « Ah oui, 7 bis rue du Nadir aux pommes ! ». Comment le sait-elle ? (Et ce n’est pas le seul cas de divination dans ce film où à plusieurs reprises l’une sait ce que seule l’autre est censée savoir : outre les exemples cités plus haut concernant le récit de Céline chez ses patrons ou la scène du Bloody Mary, on peut considérer que les récits de Céline - sur ses vacances avec le « Roi des Pygmées » ou celui concernant ses mésaventures avec ses patrons, préfigurent étrangement ce qu’elles verront plus tard après avoir ingurgité le fameux bonbon vert).
Céline a-t-elle voulu faire ressurgir ce souvenir chez Julie – qui paraît, dans de nombreuses scènes, particulièrement amnésique ? Fait-elle exprès de raconter ces histoires loufoques qui reproduisent le schéma narratif du souvenir d’enfance traumatisant ? Ou s’agit-il d’affabulations caractéristiques notamment des mythomanies développées à la suite de certains traumatismes ?
Le fantastique en littérature se définit notamment par l’hésitation du lecteur face à des événements inexplicables rationnellement. Lorsque les événements bizarres trouvent une explication rationnelle, nous sommes dans le genre de « l’étrange », et lorsque nous devons visiblement les accepter c’est dans le « merveilleux » que bascule le récit. Le fantastique implique donc le plus souvent des situations narratives indécidables, propres à faire naître le doute – ce qui se traduit la plupart du temps par des situations où des personnages malades, déstabilisés, sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, présentent leurs visions d’un point de vue subjectif.
De telles caractéristiques poussent le lecteur à suspendre son jugement sur la « véracité » de ce qu’il lit (ou voit dans le cadre du cinéma), et face aux événements bizarres de Céline et Julie, une autre possibilité est de nous laisser séduire par la magie de leur parcours révolutionnaire sans jamais remettre quoi que ce soit en cause. Lorsque les images sont clairement irrationnelles – par exemple lorsque les deux amies s’introduisent dans la comédie bourgeoise à la fin du film pour y foutre un joyeux bordel – nous pouvons soit les considérer comme des images mentales des deux personnages (et classer le récit dans « l’étrange »), soit les considérer comme survenant réellement dans le récit (et le classer dans le « merveilleux »), comme nous pouvons aussi, bien sûr, ne rien faire de tout cela et simplement regarder et apprécier sans se poser de question. Mais l’interprétation que nous proposons, sans empêcher une vision naïve, sensible au caractère fantastique du film [6], tend à considérer le récit comme présentant des images au statut divers (histoire de Céline et Julie et de leurs hallucinations) – ainsi le classerions-nous en dernière instance dans le genre de l’étrange.
La notion de « régime de vérité » peut aussi être utile pour rendre compte de la richesse sémantique du récit : sans être réel, par définition, le surnaturel de certaines scènes peut néanmoins être vrai – dans le cadre d’une lecture pouvant aussi par ailleurs s’interroger sur la nature du rapport qui lie les personnages aux événements auxquels ils sont confrontés : si un personnage hallucine, il voit vraiment des images irréelles – il ne ment donc pas, et en un sens ses visions ont quelque chose de vrai.
Aller en bateau ?

Ces mises scène et ces jeux apparaissent clairement, dans notre lecture classant le récit dans le genre de l’étrange, comme des exercices plus ou moins volontaires permettant à ces deux femmes de faire ressurgir un passé traumatisant. Pour mieux le surmonter, l’affronter, et détruire ensemble tout ce qui dans ce type de souvenirs peut structurer notre imaginaire : cette « histoire faite corps », pour reprendre le mot du sociologue, parfois mal digérée, orientant nos actes et pouvant aliéner tant le corps que l’esprit.
Afin de pouvoir vivre librement une relation en rupture totale avec l’ordre sexiste, les deux amies entendent mater ce passé peuplé de vilains, en nouant notamment, d’une manière originale, un rapport étroit avec le cinéma. Elles décident d’avancer, d’aller ensemble en bateau – contrairement aux personnages de la maison qui s’entredéchirent – ces personnages d’un vieux cinéma, dépassé et sexiste, qui « permanentent et perpétuent » (dixit Céline et Julie qui parlent aussi de « journée perpétuelle »), en reproduisant éternellement les mêmes actions, et finissent verdâtres et figés, semblables à la mort, à bord d’une barque grotesque voguant absurdement au milieu d’un fleuve d’ennui.
« Bengali », « Nadir », un bateau, un fleuve... Ces clés peuvent surprendre : correspondent-elles à une référence liée au thème que nous avons choisi de développer ? Car il se trouve qu’un réalisateur bengali très connu des cinéphiles des années 70, Ritwik Ghatak a réalisé en 1973, un an avant Céline et Julie , un film intitulé Titash Ekti Nadir Naam – ce qui peut se traduire par « Un Fleuve nommé Titash » : un fleuve, un nadir, un Bengali... Cela peut faire beaucoup : peut-être pas assez pour parler d’influence, mais assez pour situer notre film [7].
Or, si Céline et Julie ont été traumatisées dans leur enfance, et si leur rapport au cinéma (celui qu’elles se font – dans tous les sens du terme – sous bonbon vert, et celui qu’elles se jouent dans leur vie réelle) leur permet de surmonter ce passé, il n’est pas exclu que ce rapport passe par un réinvestissement de motifs appartenant à un autre film, abordant sous une autre forme une problématique très proche.
Céline et Julie choisissent un mode ludique et joyeux pour cette bataille contre le temps : là où d’autres se seraient engagé(e)s dans des voies beaucoup moins drôles, leur psychologie bricolée, fort efficace, mêle jeux de tarots, poupées, magie, incantations, photos, jeu de piste, jeu de rôle, potions magiques persilées et bonbons hallucinatoires...
La psychologie nous apprend en outre que la fabulation est un moyen courant, pour ceux qui n’arrivent pas se souvenir d’informations passées, de compenser ce manque de mémoire : les amnésiques présentent en effet souvent, en mêlant le vrai et le faux (qui est souvent du vrai transposé), une réalité comme purement imaginaire sans être capable de répondre clairement aux questions qu’on leur pose : en un sens donc, comme la fabulation aide l’amnésie , Julie (la bibliothécaire amnésique) s’aide de la mythomanie de Céline (l’illusionniste) – et vice versa.
Leurs « maladies » sont donc complémentaires [8].
On peut en somme considérer que leurs habitudes, décrites au début du film, et qui semblent devoir se reproduire à la fin, sont des jeux post-traumatiques : l’une attend l’autre près du 7 bis rue du Nadir aux pommes, et nous avons vu qu’elles en sortaient systématiquement éprouvées et plus ou moins durablement amnésiques – un peu comme si cette intrusion les confrontait à un souvenir traumatisant. L’amie qui est restée à l’extérieur attend assise sur un banc en récitant des incantations, et se met à poursuivre sa copine, possiblement amnésique, en se livrant à son tour à un nouvel exercice de remontée dans le passé – compensant sous une autre forme celui qui vient d’être réalisé.
Céline et Julie donc vont en bateau... mais un bateau ivre, comme celui du poète selon lequel la poésie « ne rythmera plus l’action ; elle sera en avant ».