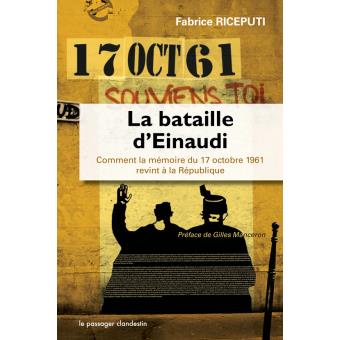
À sa mort, le 22 mars 2014, il n’y eut pas vraiment de réaction officielle. Le ministère français de la Justice, employeur de Jean-Luc Einaudi, fit parvenir une gerbe lors des obsèques au Père-Lachaise. À l’issue de la cérémonie, la petite foule venue saluer Einaudi la déposa, avec les autres fleurs, au Mur des Fédérés [1]. Mais aucun communiqué ne signala à la nation, comme c’est pourtant très souvent le cas, la disparition d’une « personnalité ». Le disparu sentait-il encore trop le souffre ? Seul l’État algérien s’exprima dans un message lu lors des obsèques par son ambassadeur. C’est un historien algérien qui trouva la formule retenue par le journal Le Monde pour qualifier le défunt : « Un héros moral », déclara Mohammed Harbi [2].
La presse française, tout au moins celle, assez peu nombreuse, qui s’attarda sur la nouvelle, évoqua bien sûr « l’homme qui défia Papon », mais aussi « un pionnier », un « explorateur de la mémoire », un « briseur de tabous ». Elle le qualifia aussi souvent, non sans un certain bon sens, d’historien. Jean-Luc Einaudi publia en effet 17 livres, dont une grosse majorité relative à la guerre d’Algérie, et tous sont le fruit de ses propres recherches, basées sur les témoignages et les documents de l’époque, sur des personnages et des évènements sur lesquels il fut souvent le premier à écrire. Que fit-il donc ainsi, sinon de l’histoire, au sens le plus élémentaire de ce mot ? Pourtant, Jean-Luc Einaudi n’était pas historien de métier. Son activité salariée, celle d’éducateur, était même tout à fait éloignée de la recherche historique. Lui-même ne souhaitait pas être qualifié d’historien. Ses adversaires s’acharnèrent d’ailleurs à lui contester absurdement le droit de porter ce titre.
En 1999, alors que Maurice Papon demandait à un tribunal de « faire taire ce pseudo-historien », un véritable historien, Pierre Vidal-Naquet, fit l’honneur à ce non-collègue de lui appliquer le détournement provocateur d’une maxime célèbre [3] :
« L’histoire est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls historiens ».
Un brin espiègle, il ajouta même ce jour-là :
« On ne naît pas historien, on le devient » [4].
Sans doute voulait-il pointer le fait que les historiens de métier ne s’étant pas du tout bousculés jusqu’alors pour faire l’histoire du 17 octobre, Einaudi avait, à ses yeux, fait œuvre éminemment utile à l’histoire.
À ceux, nombreux, qui lui demandèrent ce qu’il était exactement et dans quelle catégorie on devait le ranger, l’intéressé répondait invariablement qu’il était seulement « un citoyen » exerçant un droit élémentaire : celui de savoir ce qui avait été commis en son nom. Il ajouta ironiquement un jour que, pour faire l’histoire des crimes d’État, le fait de ne pas avoir eu de soucis de déroulement de carrière universitaire avait sans doute été un atout [5].
Face à une adversité certaine et hors de toute position académique, Einaudi exerça donc son « droit » sans autre motivation et sans autres moyens qu’une détermination peu commune à chercher la vérité et à la faire entendre. En d’autres termes, il consacra la quasi-totalité du temps que lui laissait son travail d’éducateur à mener, à ses frais et en solitaire, ses recherches.
D’où cette détermination farouche lui vint-elle ? Étudiant l’histoire mémorielle du 17 octobre 1961, les historiens Jim House et Neil MacMaster montrent que son « retour », si difficile et si tardif, dans le débat politique et historique français fut un effet indirect et différé de Mai 68 [6]. L’examen du chemin qui conduisit Jean-Luc Einaudi à écrire La bataille de Paris illustre bien cette thèse.
Né le 14 septembre 1951, il n’avait aucun souvenir personnel du 17 octobre 1961. C’est bien plus tard, dans une séquence du film Octobre à Paris de Jacques Panijel, qu’il apprit que la chasse aux Algériens avait eu lieu aussi, cette nuit-là, à Alfortville, la commune de la banlieue sud de Paris où il avait grandi. Devant le « pont suspendu » d’Alfortville, Panijel y filme en effet un Algérien qui raconte comment, à quelques centaines de mètres de l’école dans laquelle Einaudi était scolarisé, il fut, comme tant d’autres, passé à tabac et, tenu pour mort, jeté à la Seine par des policiers dans la soirée du 17 octobre.
Einaudi n’en appartient pas moins à cette « génération venue au souci du monde durant la guerre d’Algérie », selon la formule d’Edwy Plenel [7]. Cette guerre fut en effet « la toile de fond » de son enfance. Elle était alors l’objet de toutes les conversations des adultes, notamment, en mai 1958, lorsque se développe dans cette banlieue populaire un mouvement de solidarité avec un appelé insoumis qui refuse d’aller combattre en Algérie. Et des Algériens, « étranges étrangers », sont présents. Non loin de chez les Einaudi, le café rempli d’hommes nord-africains fait peur, on presse le pas, se souvient-il, pour le dépasser. L’unique élève algérien de son école lui montre une photo fascinante, prise là-bas, d’hommes armés dans la montagne.
Lors du putsch d’Alger, le jeune Einaudi est impressionné par les mitrailleuses postées sur le dôme des Invalides. Puis, alors que les murs d’Alfortville se couvrent d’inscriptions menaçantes signées « OAS », une alerte à la bombe provoque l’évacuation de son école dans le stade voisin. Il se rappelle nettement aussi du « ton inhabituel » du journaliste décrivant à la radio la répression d’une manifestation au métro Charonne. Et c’est comme si, dit-il, il avait « toujours connu » le nom du « préfet Maurice Papon », tant de fois entendu durant son enfance [8].
En mai 1968, Einaudi a 17 ans. À Fougères, où il réside à présent, le lycéen participe aux manifestations et au soutien des grèves ouvrières. En avril 1971, revenu en région parisienne, il adhère au Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF), organisation interdite depuis juin 1968. Il est, à 20 ans, rédacteur à L’Humanité rouge qui est la couverture légale de l’organisation. Il signe « André Colère », en référence à André Marty, connu alors comme « le mutin de la mer Noire » de 1919, et à François la Colère, pseudonyme de Louis Aragon pendant l’Occupation. Deux renvois à l’histoire glorieuse d’un Parti communiste dont les maoïstes estiment à présent qu’il a honteusement trahi la classe ouvrière. Le leader du PCMLF, Jacques Jurquet, est un ancien résistant communiste. Il a rompu dans les années 1950 avec le PCF, qu’il juge complice de la répression en Algérie – n’a-t-il pas voté les « pouvoirs spéciaux » avec les socialistes ? – et qui refuse encore à ce moment l’idée d’une indépendance algérienne [9].
On le sait, le 17 octobre 1961 proprement dit fut absent des références des mouvements étudiants et ouvriers de Mai 68. La guerre d’Algérie elle-même y fut peu présente [10]. Mais, au sein des organisations d’extrême-gauche maoïstes, trotskystes ou libertaires, chez certains chrétiens de gauche, les « vieux » cadres transmettent alors aux jeunes militants la mémoire de la lutte anticolonialiste, celle du refus d’obéissance des appelés et rappelés, celle des « porteurs de valises », et celle des crimes coloniaux, dont les « ratonnades » policières de 1961.
Jacques Rancière, né en 1940 et militant à la Gauche prolétarienne dans les années 1970, voit par exemple dans le massacre du 17 octobre une cause de la « désidentification » de sa génération politique d’avec la république gaullienne et de son ouverture politique à ce qu’il nomme « la cause de l’Autre » [11]. Au sein de la « GP », on rappelle souvent que « les flics de de Gaulle » ont « ratonné » et massacré. Alain Geismar voit dans le souvenir des répressions d’octobre 1961 et de Charonne l’origine du slogan « CRS, SS » [12]. À L’Humanité rouge, Jacques Jurquet est, lui aussi, un « passeur » de cette mémoire, notamment auprès du jeune militant Einaudi. En octobre 1969, le journal évoque par exemple, dans son inimitable style « prochinois », le 17 octobre :
« Les ouvriers immigrés algériens n’oublieront jamais la journée du 17 octobre 1961 qui fut pour eux l’occasion de se dresser par dizaines de milliers, en plein Paris, contre le pouvoir colonialiste […]. Ce jour-là, les dirigeants faussement communistes firent tout pour empêcher la classe ouvrière française d’intervenir activement aux côtés des frères algériens […]. Les nombreux Algériens tués et disparus au cours de cette journée, désormais historique, doivent être honorés par le prolétariat comme de purs combattants de la révolution anticapitaliste de notre pays » [13].
Einaudi signale lui-même cette filiation :
« Les recherches que j’ai entreprises par la suite, sur les années de la guerre d’Algérie et le colonialisme français, sont issues de ce que j’ai appris alors, transmis par Jurquet et d’autres » [14].
Inscrit en faculté de philosophie, Einaudi devient vite membre dirigeant de l’organisation et rédacteur en chef de son organe. En 1972, il participe à un numéro spécial pour le dixième anniversaire de l’indépendance algérienne. L’imprimeur auquel il porte alors le journal se nomme Simon Blumental ; il fit de la prison pour avoir apporté son aide au FLN. C’est là qu’Einaudi apprend le métier de journaliste et qu’il contracte le virus de l’enquête de terrain qui ne le quittera plus. L’Humanité rouge devient alors un quotidien. Il ambitionne vite d’être un peu moins l’organe du parti délivrant au prolétariat « la ligne » à suivre et davantage un journal d’enquêtes et d’informations sur les réalités sociales et politiques.
Ce sont des années de travail acharné pour informer sur les combats de « la classe ». Les « reporters » de L’Humanité rouge enquêtent sur les ateliers clandestins du Marais, suivent la longue grève des immigrés dans les foyers Sonacotra, celles des O.S. de Renault à Flins et à Cléon. Du Larzac à Plogoff en passant par l’usine Lip de Besançon, ils sillonnent la France des luttes. Un des leaders de la lutte des travailleurs immigrés contre la Sonacotra, instrument de contrôle et de répression des travailleurs immigrés, raconte aux militants-journalistes comment, le 17 octobre, il fut jeté à la Seine par la police française [15].
Gilbert Rigal, autre ancien de cette épopée, se rappelle que le camarade « rédacteur en chef » est déjà particulièrement à cheval sur certains principes : « Sans enquête sérieuse, pas d’article », serine-t-il aux militants-journalistes. En 1981, Einaudi demande à rencontrer le grand reporter Jean Bertolino. Ce dernier rentre d’un reportage des maquis afghans qui combattent l’occupation soviétique. Cela intéresse L’Humanité rouge. Le journaliste de la « Une » avouera avoir redouté la rencontre avec un maoïste « dogmatique et vindicatif ». Mais c’est avec un homme « hésitant et modeste » qu’il échange, et dont il dira lors des obsèques qu’il aurait fait « un sacrément bon journaliste » [16].
En 1982, « après avoir ouvert les yeux sur les réalités historiques et présentes du prétendu “socialisme” » [17], il quitte finalement l’organisation, tout en y gardant de solides amitiés, y compris avec Jurquet et son épouse Bahia, ancienne militante du FLN. Contrairement à tant d’autres, il ne passera pas « du col Mao au Rotary » [18]. Après avoir été brièvement instituteur, il devient éducateur. Désormais, il mènera de front l’exercice de ce métier avec un travail de recherche qui s’enclenche peu après la fin du militantisme politique. Il ne sera plus jamais membre d’une organisation, pas même, par souci d’indépendance, des associations luttant pour la reconnaissance du 17 octobre.
Le vibrant hommage à l’éducateur Einaudi rendu lors de ses obsèques par ses anciens collègues de la Protection judiciaire de la jeunesse montre qu’il met le même sérieux et la même ténacité dans les deux activités. Nombre de « graines de crapules » se rappellent manifestement cet éducateur exigeant et bienveillant qui entendait suivre les conseils de Fernand Deligny « aux éducateurs qui voudraient les cultiver » [19]. Travailler à réconcilier des adolescents, toujours pauvres et souvent enfants de travailleurs migrants, avec le monde des adultes est clairement pour lui un prolongement de son engagement militant [20].
Il en est à l’évidence de même pour son travail de recherche. Il faut rappeler ici que, dans les années 1980, la guerre d’Algérie ne fait guère partie du « territoire de l’historien » français. L’immigration encore moins. Un évènement comme celui du 17 octobre 1961 n’y a pas trouvé de place. En 1990, cependant, la jeune étudiante Sylvie Thénault propose au professeur Jean-Jacques Becker d’en faire le sujet de son mémoire de maîtrise. Ce dernier dit son étonnement devant le fait qu’une jeune fille de 20 ans ait cette idée :
« C’était un évènement déjà ancien, bien oublié. La guerre d’Algérie n’était plus un sujet de préoccupation et la manifestation encore moins. »
Par « principe », il accepte le sujet, non sans mettre en garde son étudiante. Il lui rappelle qu’elle aura « à faire un travail d’histoire et non un improbable travail “militant” » [21]. Mais qu’est-ce qui pouvait motiver alors un chercheur choisissant une telle question « socialement vive », sinon un désir d’ordre « militant » de s’attaquer à une occultation éminemment politique ? Sylvie Thénault confie aujourd’hui que, lycéenne antiraciste, elle avait pris connaissance du 17 octobre à Argenteuil, auprès « de militants d’extrême-gauche, de gauche, ainsi que des enfants d’immigrés dont les pères, les oncles ou les voisins avaient pu manifester en octobre 1961 » [22].
Benjamin Stora a rappelé, quant à lui, que ses propres premiers travaux doivent beaucoup à son engagement politique, durant les années 1970, dans le mouvement trotskiste, et bien peu à une université qui délaissa longtemps une histoire de la guerre d’Algérie trop « sensible » politiquement. Il avance, en sus de ses propres origines « algériennes », le « rapport actif à l’histoire » qui caractérisait alors les militants révolutionnaires pour expliquer sa décision de faire sa thèse sur Messali Hajj [23]. Combien de tabous l’exhumation de cette histoire étouffée pouvait-elle en effet faire tomber ?
Hors de l’université, Einaudi fait donc le pari, qui est alors aussi celui que fait Stora à l’intérieur de l’institution, selon les mots de ce dernier, « de ressusciter l’énorme rumeur des “oubliés” de l’histoire colonialiste ou nationaliste “officielles”, faire parler leur silence, réhabiliter leur temps » [24]. Mais sa position extra-universitaire servira souvent d’argument à Papon mais aussi à quelques historiens pour le discréditer. Claude Liauzu, historien universitaire, écrivit à ce propos :
« Je rappellerai que sur Vichy, sur la spoliation des biens juifs, sur le 17 octobre 1961, sur quantité d’autres grands problèmes de notre histoire, ce ne sont pas des historiens patentés de la Sorbonne ou d’ailleurs qui ont travaillé les premiers. Je rappellerai que si les communards sont parvenus à conquérir leur histoire, cela s’est fait sans et parfois contre les historiens professionnels […]. Ce sont des militants comme Lissagaray qui ont, parmi les premiers, permis la création de cette histoire » [25].
Son premier livre n’est pas consacré au 17 octobre 1961 mais à Fernand Iveton, ce « personnage tragique » dont l’histoire était tombée, comme bien d’autres, aux oubliettes. Dans Pour l’exemple. L’affaire Fernand Iveton, publié en 1986, Einaudi raconte par le menu et avec empathie l’histoire de ce « petit pied-noir » algérois, militant du Parti communiste algérien alors interdit, engagé avec d’autres de ses camarades, en dépit de la condamnation de leur position par le PCF, pour l’indépendance algérienne.
Arrêté pour avoir déposé une bombe qui n’explosa pas et qui ne devait tuer personne, Iveton fut torturé, et, au terme d’une procédure expéditive devant un tribunal militaire, condamné à mort. Sa grâce fut refusée, alors que François Mitterrand était ministre de la Justice. On le sait aujourd’hui, ce dernier « vota » pour la mort d’Iveton. Mollement défendu en métropole – le PCF interdit notamment à un avocat communiste de le représenter –, il fut exécuté à Alger le 11 février 1957. Il est le seul Européen à l’avoir été « au nom du peuple français » durant la guerre d’Algérie. Il le fut, démontre Einaudi, « pour l’exemple », un exemple voulu par le pouvoir, destiné aux pieds-noirs communistes qui estimaient être, comme Iveton, une des composantes de la nation algérienne insurgée et qui commettaient ainsi, aux yeux de beaucoup, la pire des trahisons [26].
Apportant sa caution à ce premier livre d’Einaudi, Pierre Vidal-Naquet loue dans la préface qu’il lui donne « l’extrême minutie » et la « grande probité intellectuelle » de l’auteur. Ce dernier, écrit-il, « a fait ce que font les historiens : ramasser tous les documents de l’époque, interroger les survivants, camarades de lutte, avocats, et, d’abord et avant tout, Hélène Iveton, veuve de Fernand. Il n’a rien négligé qui puisse l’éclairer, et il n’a pas dépendu de lui que les demandes de consultation des archives interdites qu’il a adressées aux ministères concernés aient eu un écho positif ». Einaudi, ajoute-t-il, « ne cache pas sa sympathie pour l’homme qui est au centre de son livre, et il a raison de ne pas la cacher » [27]. C’est Gilles Perrault qui rend compte du livre dans le Monde diplomatique. Jean-Denis Bredin, dans Le Nouvel Observateur, souligne quant à lui un parti pris de sobriété dans l’expression et l’exposition strictement factuelle qui deviendra une marque de fabrique des enquêtes d’Einaudi :
« Puisqu’il a fallu que Fernand Iveton soit condamné « pour l’exemple », c’est pour l’exemple qu’Einaudi dresse, trente ans après, sans commentaire, sans éloquence, le procès-verbal de l’affaire Iveton » [28].
En dépit de ces recommandations, le livre n’a connu, lors de sa sortie en 1986, qu’un succès d’estime extrêmement limité. Il en ira autrement, cinq ans plus tard, pour La bataille de Paris.


