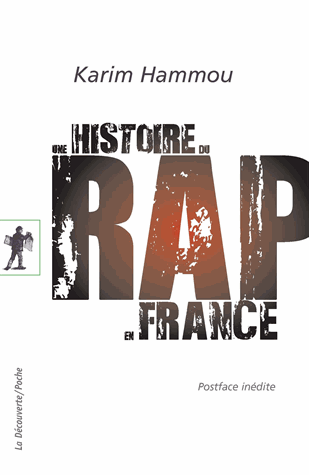
Pour mieux me faire comprendre ce qu’implique l’engagement dans l’industrie du disque, l’un des rappeurs que je rencontre m’énumère les critères qui font d’un morceau de rap un titre calibré pour le succès :
« Au niveau de la durée, le format, c’est le même pour tous : il ne faut pas excéder quatre minutes. Et puis bien sûr trois refrains au minimum, mais ça c’est des formats classiques de radio. C’est une règle. C’est du professionnalisme dans le sens où tu rentres dans le moule du disque. Je sais pas comment te dire, on nous a fait un lavage de cerveau sur le format de la musique, surtout depuis ces dernières années avec l’explosion des radios FM. Donc le format de la musique il est vraiment dans nos têtes. Et si toi tu n’obéis pas à ce format, les gens ont du mal à t’écouter, si tu ne fais que des titres sans refrain par exemple. […] Pour passer sur Skyrock, tu fais un titre mélancolique, avec des pianos ou des violons. Tu prends un thème qui parle vite fait de rue, même si tu n’as jamais vécu dans la rue, c’est pas grave, tu inventes, tu brodes. C’est comme une fiction, parce que paraît-il on a le droit à la fiction. Beaucoup de rappeurs disent ça : “On a le droit à la fiction.” Et il y en a plein qui en abusent, qui vont s’inventer des rôles. Et si tu veux passer sur Skyrock, je te conseille de faire ça, d’inventer un personnage, une histoire, dans laquelle tu es le méchant, bien sûr, surtout pas le gentil. Tu es le méchant qui fait du mal à tout le monde, et à la limite tu te repens à la fin : “ouais, c’est pas bien…”, après les faits. Voilà, tu as le morceau au format idéal [1]. »
Ce récit a la précision et la cohérence d’un bréviaire, et pourtant il est plus complexe qu’il n’y paraît. Les règles qu’il présente n’ont pas toutes la même généralité. Si le respect d’un format de trois à quatre minutes contraint tous ceux qui veulent réaliser un tube diffusé sur les grandes radios FM, quel que soit le genre musical, l’art de parler de « la rue » est devenu une figure imposée pour les rappeurs français au tournant des années 2000.
Ces règles renvoient aussi à différentes temporalités – celle de l’histoire de la radio, qui devient un moyen privilégié de promotion du commerce discographique à partir des années 1960, mais aussi celle de l’histoire récente de la bande FM, qui place Skyrock dans la position de débouché par excellence pour les morceaux de rap visant un large succès commercial à partir de 1998. Quant aux traits narratifs du morceau idéal que ce rappeur dépeint, ils rappellent un tube que Sully Séfil publie en 2001, « J’voulais ». Autrement dit, ce mode d’emploi est composé d’éléments hétérogènes et parfois instables, que seule l’épaisseur du présent tient ensemble.
Plutôt qu’un véritable mode d’emploi, cet extrait déploie un répertoire de ficelles du métier, inégalement durables, qui semble s’imposer à chacun – un ensemble de « conventions [2] ». À partir de discussions comme celles-ci, ma question de départ s’est déplacée. En effet, l’espace social dans lequel les carrières des rappeurs se déploient n’est pas statique [3]. Il s’agissait dès lors de comprendre non plus seulement les carrières des rappeurs au moment précis de l’enquête, mais aussi la façon dont « faire carrière dans le rap » a changé au fil du temps.
Comment ce répertoire de ficelles est-il né ? Comment se transforme-t-il ? Autrement dit, comment un « monde [4] » évolue-t-il en même temps que la position des personnes qui le composent se modifie ? Je me suis ainsi engagé dans un questionnement sur l’histoire du rap, fil conducteur d’une thèse de sociologie soutenue en 2009 et sur laquelle ce livre s’appuie considérablement.
Pourquoi écrire une histoire ?
Le choix d’écrire une histoire du rap en France, de la part d’un sociologue, n’est pas une simple option de présentation. Il s’appuie sur la conviction que sociologie et histoire sont « indiscernables dès que l’on considère la forme de présentation de leurs objets dans l’observation ou la trame sémantique de leurs assertions, et de leurs preuves dans leur travail scientifique [5] ». Mais ce choix s’explique aussi par l’idée que le recours à l’histoire est la meilleure façon de renouveler notre compréhension actuelle du rap.
Les travaux en sciences sociales analysant de manière frontale ou latérale le rap en France pèchent souvent par une insuffisante prise en compte de l’instabilité et de la complexité de ce que le mot « rap » désigne. À l’image de l’anthropologie critiquée par Alban Bensa [6], un défaut de nombre d’enquêtes sociologiques consacrées au rap consiste ainsi à uniformiser, réifier et décontextualiser le rap. La position d’un rappeur précis peut alors faire l’objet d’une extrapolation abusive sur l’ensemble de la scène rap, une configuration donnée du rap peut être projetée de façon anachronique sur le passé ou le futur, ou encore des extraits de chansons peuvent être assimilés sans autre forme de procès à l’opinion personnelle de l’artiste qui les interprète.
Sur ce dernier point également, le récit ouvrant cette introduction est éclairant. En insistant sur le dilemme moral lié à la part de fiction qu’il est légitime d’incorporer à ses raps, il rappelle les tensions qui existent entre licence esthétique et éthique du dire vrai. Chacune de ces généralisations hâtives néglige l’inscription du rap dans l’histoire, cette trame temporelle que des contraintes, des intentions et des hasards [7] croisent pour tisser le cours imprévisible des activités humaines.
Cette occultation n’est pas le monopole des milieux universitaires. Elle marque également la façon dont une définition dominante du rap s’est formée dans la sphère médiatique en 1990-1991. Le regard sociologique a bien souvent reconduit, avec ses outils propres, un regard journalistique surdéterminé par la volonté d’utiliser le rap comme révélateur du « problème des banlieues » [8].
Il est toujours tentant d’écrire l’histoire à partir des jugements de valeur contemporains. On tient alors compte de certaines façons de faire du rap, que l’on considère fidèles à l’« essence » du genre, et on en ignore d’autres, jugées illégitimes. Il s’agit alors de décrire l’origine d’une forme musicale, garante de l’authenticité du genre, et de promouvoir implicitement ou explicitement une certaine définition de ce que le rap doit être.
Contrairement à ce type d’histoire « axiologique [9] », ce livre s’intéresse à toutes les pratiques de rap, quelle que soit la légitimité qu’on leur reconnaît rétrospectivement. Suivant la démarche que Howard Becker suggère dans Les Mondes de l’art [10], je n’ai pas mené mon enquête à partir d’une définition a priori de ce qu’était le rap, avant de chercher les personnes qui produisaient les objets correspondant à cette définition. J’ai plutôt cherché qui définissait des choses comme du rap, avec qui ces personnes interagissaient, avant de remonter plus loin dans les « chaînes de coopération [11] », c’est-à-dire les personnes qui rendent ces activités possibles.
Car si le réel est en perpétuel changement, tout n’est pas toujours possible à chacun à chaque instant. La vie sociale est faite de relations entre des personnes poursuivant des fins différentes, et dépendantes les unes des autres au sein d’une division du travail. Elle oppose donc des contraintes qui viennent, en dernière instance, « de tous les autres hommes pour chacun d’entre eux [12] ». Elle ouvre également des possibles dans un jeu de luttes et d’« incitations réciproques [13] » dont les protagonistes disposent de moyens inégaux. Cette démarche m’a conduit à appréhender le rap comme un enjeu de conflits, de collaborations et de négociations multiples, plutôt que comme une forme univoque, atemporelle et homogène.
Ce livre ne prétend pas pour autant présenter toutes ces luttes et négociations. Il propose une histoire du rap parmi d’autres possibles. Il adopte une mise en intrigue qui se concentre sur une question apparemment triviale : comment le rap a-t-il duré en France ?
Le sens de cette question s’éclaire lorsqu’on la rapporte au parti pris que Howard Becker présente dans la postface. Saisir la réalité sociale comme un processus fait de changements continus donne les moyens de considérer l’apparente permanence de certaines choses comme une surprise, comme quelque chose qu’il faut comprendre. Mais s’attacher à cette question, c’est en abandonner d’autres, imaginées ou imaginables.
Ainsi, l’histoire des amateurs de rap n’est une dimension centrale que dans le deuxième chapitre de cet ouvrage, lorsque ces amateurs sont les principaux acteurs d’une recontextualisation du rap (américain) en France [14]. De même, la dimension proprement communicationnelle engagée dans différentes façons de rapper est peu abordée dans ces pages [15]. Les circulations transnationales dans lesquelles le rap s’inscrit sont elles aussi réduites à la portion congrue : cette histoire suit des chaînes de coopération dans lesquelles l’imaginaire national [16] joue un rôle prépondérant, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des maisons de disques françaises et des filiales des grandes multinationales du disque, des grands réseaux radiophoniques ou des chaînes de télévision généralistes dominant le paysage médiatique du pays dans les années 1980-1990. Le rapport durable que le rap en France entretient avec le rap américain, fait d’inspirations, de sélections et de démarcations artistiques, demeure périphérique et n’apparaît qu’au détour du témoignage de certains artistes. On pourrait en dire autant des liens étroits et complexes qu’entretiennent le rap et la chanson. Et ce ne sont là que les lignes de lecture les plus évidentes. Les histoires du rap en France sont multiples, et restent largement à écrire.
Une enquête guidée par des disques
Le mot « rap », appréhendé jusqu’ici comme s’il allait de soi, a lui aussi une histoire. La simplicité de ce terme masque une dynamique complexe d’influences circulaires entre la catégorie et les pratiques changeantes qu’elle désigne. Dès les années 1940, le mot « rap » est utilisé de façon proche de son sens contemporain [17] pour décrire une pratique d’interprétation ni parlée ni chantée, mais proférée en harmonie avec une rythmique. L’interprétation rappée se développe et s’élabore à New York dans les années 1970, sous l’influence des sound systemsa jamaïcains et de la musique funk [18]. Elle est bientôt popularisée dans le monde entier par des enregistrements discographiques qui présentent de façon croissante le rap comme un genre musical à part entière. Mais cette trajectoire nord-américaine ne prédit pas quelles appropriations vont prévaloir en France.
L’existence d’un genre musical suppose une opération de catégorisation commune de morceaux musicaux. Comme les genres littéraires, les genres musicaux peuvent naître en suivant des logiques d’étiquetage variées [19] : on peut rassembler des morceaux parce qu’ils obéissent aux mêmes règles formelles de composition, parce qu’ils s’inspirent les uns des autres, parce qu’ils se ressemblent en partageant certains thèmes, etc. Cette complexité des logiques de classification se renforce par les divergences qui peuvent advenir entre les acteurs qui participent à ces classifications. Dans le domaine musical, on peut citer les artistes, bien sûr, mais aussi les sociétés d’édition discographique, les promoteurs de concerts, les journalistes et critiques musicaux, les vendeurs, les amateurs, etc. Parce qu’elles servent de guide pour l’action de toutes ces personnes, les classifications génériques informent leurs pratiques (chanter, produire, vendre, évaluer…) et s’inscrivent dans des objets – disques, affiches, articles de presse, rayonnages, etc.
À leur tour, ces pratiques et ces objets transforment le genre : ils lui donnent une certaine forme, en soutiennent certains usages. Plus les relations entre ces discours, ces pratiques et ces objets sont étroites, plus un genre musical est stable. Du point de vue sociologique privilégié par cet ouvrage, l’existence d’un genre musical est donc une question empirique, tributaire des dispositifs d’appréciation musicale existant à un moment donné [20].
Sur le plan de l’enquête, je souhaitais partir d’une définition provisoire du rap suffisamment large pour pouvoir observer les transformations de ce que ce mot veut dire, des pratiques qu’il renseigne et des objets qui le font exister. Le point de départ de ce livre est donc que le rap est une catégorie, dont les débuts en France correspondent aux premiers usages de ce mot de ce côté-ci de l’Atlantique. Mais cette définition provisoire doit aussi être suffisamment précise pour borner l’enquête.
Je me suis donc concentré sur les auteurs et interprètes de rap, et j’ai retenu deux critères : la technique d’interprétation et la référence aux précédents américains. Autrement dit, ce que je qualifie de « rap » en France décrit a minima des paroles harmonisées sur un rythme, associées à un lien intentionnel – si ténu et indirect soit-il – aux formes musicales popularisées à partir du début des années 1980 par les industries musicales américaines sous le nom de rap [21].
Les documents qui m’ont permis de raconter cette histoire du rap en France sont d’une grande diversité. J’ai commencé par réaliser une enquête ethnographique dans le milieu rap parisien, puis dans le milieu rap marseillais, dont les chapitres 8 et 9 rendent compte. Dans chaque ville, j’ai procédé de la même façon : observer le fonctionnement ordinaire d’un lieu important dans la trajectoire des rappeurs aspirant à la professionnalisation – à Paris, il s’agissait de l’émission rap Big Up, diffusée chaque semaine sur une radio locale ; à Marseille, il s’agissait de l’association Sound Musical School B. Vice. J’ai également suivi pendant plusieurs années le parcours d’un rappeur lié à chacun de ces lieux, de ses premiers pas dans le milieu professionnel du rap jusqu’à la réalisation d’un album.
En parallèle, j’ai rassemblé un grand nombre de documents – anciens numéros de magazines spécialisés, témoignages rétrospectifs livrés dans des autobiographies… – et réalisé plus de soixante-dix entretiens avec des rappeurs, des disc-jockeys (DJ), des animateurs radio, des employés de maisons de disques, des journalistes, etc. J’ai également pu consulter divers documents (articles de presse, entretiens…) rassemblés par d’autres chercheurs, lorsque ceux-ci ont bien voulu me communiquer leurs sourcesb.
Mon but était de comprendre comment l’organisation ordinaire du rap en France s’était transformée au fil du temps. Mais pour mettre en ordre ce matériau hétéroclite, je cherchais un type de document « étalon », susceptible à la fois de porter la trace d’états antérieurs du rap en France, d’être relativement indépendant des élaborations rétrospectives de la mémoire et d’être étudié de façon systématique.
La démarche déployée par Howard Becker dans Les Mondes de l’art m’a permis d’imaginer un matériau d’enquête répondant à cette ambition : les enregistrements discographiques. J’ai travaillé en ethnographe dans les lieux où l’on faisait du rap dans la première moitié des années 2000. J’avais donc sous les yeux une partie des chaînes de coopérations de cette période. Mais comment imaginer la forme de ces coopérations dans les années 1990 ? dans les années 1980 ?
En inversant le raisonnement de Becker, qui vise à mieux comprendre les œuvres à partir des chaînes de coopération qui leur ont donné naissance, j’ai examiné les œuvres pour y repérer les traces des chaînes de coopération qui les ont rendu possibles. En d’autres termes, j’ai utilisé des disques de rap comme des documents constituant des « moments figés de l’histoire des interactions humaines [22] ».
Cette démarche m’a permis d’élaborer un ensemble d’indices complétant et parfois déstabilisant les souvenirs rapportés par les protagonistes qui ont eu l’occasion de s’exprimer sur tel ou tel aspect de leur histoire. Je me suis attaché à décrire un petit nombre de traits formels de deux corpus discographiques. Le premier rassemble environ 150 disques vinyles (la plupart au format 45-tours) publiés de 1980 à 1989 et mobilisant une interprétation rappée en français. Leur examen est détaillé dans les chapitres 1 et 2. Le second corpus visait à rassembler l’exhaustivité des albums de rap en français publiés sous forme de disque compact et distribués à l’échelle nationale jusqu’en 2004c soit, selon mon recensement, 424 albums qui sont analysés dans les chapitres 4 à 9.
Enfin, j’ai entrepris une recherche spécifique sur les premières définitions du rap en France et en français avancées dans l’espace public médiatique. À l’aide des archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), j’ai rassemblé et analysé un corpus composé des premières émissions télévisées évoquant ce thème, sur les trois principales chaînes hertziennes. À partir de la fin des années 1980, la télévision enquête sur le rap en France et le présente comme un phénomène nouveau qu’il s’agit d’expliquer. Le chapitre 3 propose donc une « enquête sur l’enquête », et joue un rôle à la fois empirique et critique dans l’ouvrage : il décrit un tournant majeur dans l’histoire du rap en France, mais il est aussi un miroir tendu aux recherches en sciences sociales interrogeant la façon dont elles se sont saisies du rap des années 1990 à nos jours.
Les métamorphoses du rap en France
Ce livre présente, dans son découpage, trois configurations historiques différentes, qui balisent le chemin que le rap s’est frayé en France jusqu’à nos jours.
La première configuration voit s’opposer, au cours des années 1980, deux usages du rap et deux chaînes de coopération en partie distinctes. D’un côté, des interprètes issus des variétés et souvent chanteurs au sens traditionnel du terme s’approprient ponctuellement l’interprétation rappée, dans le cadre des coopérations ordinaires de l’industrie du disque (chap. 1). De l’autre, des amateurs de musiques afro-américaines aux marges de l’industrie du disque se spécialisent peu à peu dans de nouvelles pratiques en suivant attentivement les évolutions du rap américain au cours des années 1980 (chap. 2). L’intérêt des grands médias pour le rap en France, aiguisé par l’acuité d’un certain nombre de problèmes sociaux, contribue à le redéfinir au tournant des années 1990. Il assigne l’écoute comme la pratique du rap à une banlieue imaginaire, lieu de toutes les altérités, et fait du jeune de banlieue le stéréotype par lequel les rappeurs sont compris (chap. 3).
Dès lors, une deuxième configuration émerge progressivement, marquée par l’intervention croissante des grandes maisons de disques dans les chaînes de coopération permettant de réaliser du rap en Fance. L’industrie discographique tente d’exploiter cet intérêt médiatique nouveau pour le rap, mais, face au scepticisme des grands réseaux radio, elle peine à transformer les rappeurs en marchandises profitables (chap. 4).
Au contraire, les pouvoirs publics reprennent à leur compte la définition du rap comme « expression des jeunes de banlieue » et en font un levier d’action sur les classes populaires. En s’appropriant et en déplaçant cette définition, des rappeurs introduisent de nouveaux thèmes et de nouvelles façons de faire du rap en France (chap. 5). Les opportunités ouvertes au sein des industries musicales et dans le domaine socioculturel multiplient les initiatives visant à pérenniser le rap en France. C’est ainsi que naît une nouvelle génération de rappeurs, mais qu’apparaissent aussi des dissensions croissantes sur les façons légitimes de rapper (chap. 6).
Ces dissensions se résolvent dans la seconde moitié des années 1990, par le biais des techniques d’authentification mutuelles entre rappeurs et du nouvel espace d’exposition radiophonique offert par Skyrock. Les rappeurs que les grandes maisons de disques avaient recrutés pour surmonter les préventions des radios nationales se voient marginalisés et une nouvelle scène rap produite en labels indépendants redéfinit la façon dominante de rapper en France (chap. 7).
La troisième configuration du rap en France voit émerger un monde social du rap français, intégré comme segment au sein des industries musicales, qui connaît une stabilité relative. Au début des années 2000, la façon dominante de faire du rap suppose un travail esthétique et commercial sur « la rue » qui est exploité par le biais d’un marketing de la marge (chap. 8). Cette référence à la rue peut notamment se comprendre comme un symbole honorifique légitimant les normes en vigueur dans le milieu rap underground et comme une appropriation à des fins professionnelles de l’assignation du rap aux banlieues (chap. 9).
Dans la seconde moitié des années 2000, le rap se banalise dans les industries culturelles et contribue à un renouvellement des formes musicales dominantes. Il est paradoxalement plus contesté que jamais par une frange de la classe politique qui l’érige en menace pour les valeurs nationalistes (épilogue).
Comment le rap a-t-il duré en France ? Par le biais, notamment, d’un « effet de boucle [23] », d’une interaction complexe entre des personnes et la façon dont elles sont catégorisées par d’autres. Les personnes qui se définissent comme étrangères au rap et leur façon de définir ce genre musical ont exercé une influence sur le destin du rap en France qu’on ne peut sous-estimer. C’est en composant avec elles qu’un petit nombre d’amateurs de musiques afro-américaines ont pu promouvoir une nouvelle forme esthétique jusqu’à en faire une composante culturelle majeure de notre société.
L’erreur inverse consisterait à négliger les marges de manœuvre que les animateurs du rap en France ont su trouver, parfois en s’affrontant les uns aux autres, parfois en profitant des rivalités entre des acteurs dont ils étaient dépendants. Ces luttes et ces négociations ont donné naissance à un monde du rap qui s’est approprié de manière sélective la définition du rap imposée de l’extérieure, et en a déplacé les termes. Assignés à une position minoritaire dans une interaction asymétrique avec le groupe majoritaire, rappeurs et DJ hip-hop ont ainsi travaillé la place qui leur était prescrite. Ils ont construit en France un espace d’autonomie culturelle relative [24], un lieu propre instillant dans la société dont ils font partie un ensemble de formes esthétiques et de voix nouvelles.



