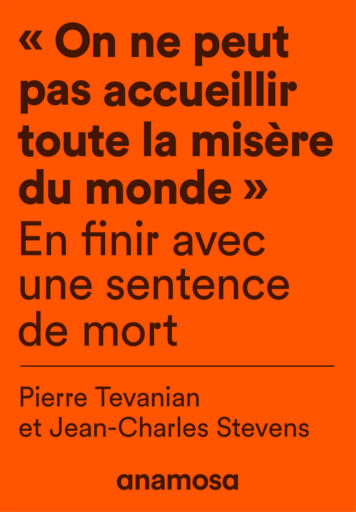
Proférés pour clore toute discussion, ces dix mots semblent constituer l’horizon indépassable de tout débat sur les migrations. En France comme en Belgique, et sans doute ailleurs, ils tombent comme un couperet pour justifier toujours le « contrôle » et la « maîtrise » des « flux migratoires » – c’est-à-dire, en termes moins euphémiques : le refus, la restriction, la fin de non-recevoir et la répression. En ce sens, ils constituent bien ce qu’on appelle une sentence, dans les deux sens du mot : une simple phrase tout d’abord, exprimant une pensée de manière concise et dogmatique, sans développement argumentatif, mais aussi un verdict, une condamnation, prononcée par une autorité à l’encontre d’un ou d’une accusé·e. La juridiction, ici, est l’État, ou tout bon citoyen qui s’en veut le garant ou le fondé de pouvoir. L’accusé·e est, bien entendu, le ou la réfugié·e, le ou la migrant·e [2]. Quant à la peine prononcée, c’est d’abord, purement et simplement, même si l’on feint de l’ignorer, une peine de mort – en premier lieu pour les 25 277 morts comptabilisés à ce jour en Méditerranée depuis 2014, ou les 902 morts au nord ou à l’est de l’Europe, ce que le réseau Migreurop a nommé la « stratégie du laisser-mourir en mer [3] ». C’est aussi, sous différentes formes, la mort sociale et la « vie mutilée [4] » qui attendent en Europe les survivant·es, devenu·es sans-papiers, dans leurs campements puis au-delà : harcèlement et violences policières, « destruction des biens personnels, interdiction de distribuer de la nourriture, batailles juridiques pour accéder à l’eau potable » [5], dédales administratifs, discriminations multiformes.
Nous laisserons de côté ici les controverses possibles sur la stature morale et les intentions de Michel Rocard [6], qui fut l’un des premiers politiciens à populariser cette sentence, et dont le nom est parfois utilisé comme argument d’autorité, pour nous concentrer sur le fond du propos et sa très discutable légitimité. Nous soutenons pour notre part que cette phrase est profondément xénophobe et, à ce titre, moralement et politiquement problématique. Nous soutenons également qu’elle repose sur de nombreux sophismes, que nous entendons déconstruire ici.
L’enjeu d’une telle déconstruction est ni plus ni moins que la levée d’un tabou : un interdit de parler, et même de penser et de sentir. C’est en effet l’émotion, autant et en même temps que la pensée, qui est empêchée, étouffée, verrouillée par ces dix mots prononcés toujours sur le mode de l’évidence et de la mise en garde : toute objection est importune. La sentence joue en somme le rôle d’« esquive » ou, pour reprendre les mots de Gilles Deleuze, de « schème sensorimoteur », dont la fonction est de neutraliser en chacun·e de nous toute affection, toute perception et toute idée de « l’intolérable » :
Nos schèmes sensorimoteurs, ils sont faits pour que nous passions à côté, […] pour que nous passions d’un objet à un autre […]. De toute manière, on appellera intolérable tout ce qui dépasse nos seuils sensorimoteurs. […]. Mais il y a des fois où ça ne fonctionne pas : vous êtes dans la rue, vous voyez un personnage, là, vous ne savez pas pourquoi, et vous comprenez d’un coup quelque chose que vous n’avez pas compris sur cent autres cas tout à fait semblables. Vous voyez quelque chose : un court moment vous êtes devenu un voyant, et vous en avez saisi en une seconde beaucoup plus que vous en avez saisi pendant quinze ans, et ou bien vous oublierez vite, ou bien il y a quelque chose qui ne sera plus pareil en vous. Là, par exemple, vous verrez dans un atelier un travail d’usine particulièrement dur, et puis votre esquive sensorimotrice, « Faut bien que les gens travaillent », ça ne vaudra plus, même à vous ça paraîtra dérisoire. Vous aurez aperçu, vous aurez entrevu quelque chose dont vous ne reviendrez pas. Rosselini, Europe 51 : la bourgeoise voit l’usine et elle balbutie : « J’ai cru voir des condamnés ». Pourtant, elle en avait vu mille fois en passant en voiture, des usines, mais voilà qu’un jour : « J’ai cru voir des condamnés » [7].
Notre travail vise en somme à défaire ces esquives qui nous déconnectent de nos propres affects et de notre propre pensée. Il ne s’agit pas d’opposer simplement l’authenticité de l’empathie et de l’indignation à la cruauté d’une froide raison calculatrice – ce qui reviendrait à reconduire, en miroir inversé, l’opposition artificielle et manichéenne qui est construite par la « pensée d’État » – entre une « raison » monopolisée par les gestionnaires, et des « élans du cœur » aussi « irréfléchis » qu’« aveugles » et « irresponsables » [8]. Ce que nous combattons n’est pas une raison pure mais une rationalité particulière, mêlée – pour ne pas dire asservie – à un ensemble d’affects, à commencer par la soif de pouvoir et la peur de « l’étranger ». Et ce que nous y opposons, en positif, est tout simplement une autre rationalité, nourrie de travaux scientifiques, soucieuse de véracité quant aux faits invoqués, et de cohérence logique dans les conclusions que nous en tirons, mais une rationalité qui n’en est pas moins, elle aussi, guidée par des affects. La différence et le différend résident simplement dans la nature des affects investis. S’il faut nommer ces ressorts intimes et affectifs [9] qui guident notre entreprise, motivent notre réflexion et nous imposent la rigueur dans le raisonnement, disons qu’il s’agit d’une sympathie pour des frères et sœurs humains, d’une colère contre une oppression, mais aussi d’un certain besoin d’estime de soi, lui-même corrélé à une certaine idée de la citoyenneté, de l’hospitalité, de la solidarité, et plus encore de l’égalité et de la justice.


