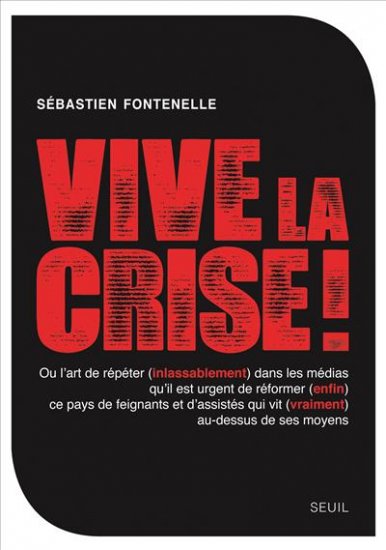
Aux premiers jours du mois de janvier 2012,
au sortir d’un semestre quotidiennement ponctué
par les effarants effets de la crise et à l’aube d’une
année d’élection présidentielle, François Hollande,
qui brigue pour le Parti socialiste la magistrature
suprême, explique, avec une crâne sûreté, que
l’instauration par la droite régnante, à quelques
semaines de la fi n du quinquennat sarkoziste, d’une
« TVA sociale » serait, si elle devait être confirmée, une « mystification »...
Cela n’est bien sûr pas faux : caractéristique des tricheries sémantiques de la novlangue libérale, l’appellation
faussement charitable de cette nouvelle
maltôte « sociale », directement inspirée (comme
de juste) par le patronat, occulte qu’elle frapperait
indistinctement les pauvres et les riches, et qu’elle
pénaliserait donc les moins fortunés.
Mais certains mots, lorsqu’ils viennent dans certains
discours votifs, sont d’un maniement délicat
(ou d’un pénible effet), et les socialistes en campagne
devraient s’astreindre à mieux trier leur vocabulaire,
car s’il est un « art », entre tous, où leur parti
excelle d’assez longue date, c’est bien celui, précisément,
de la mystification des masses – puisque
l’un de ses premiers soins, deux ans après l’élection
de François Mitterrand, fut de (faire) communiquer
(par des journalistes prodigues) au bon peuple que
cette victoire « historique » n’avait en somme été
qu’une gigantesque duperie, où la promesse d’en
finir avec le capitalisme préludait en réalité à une
(« nécessaire ») rupture d’avec le socialisme.
L’amusante blague fut reproduite quinze ans plus tard,
et presque à l’identique, par Lionel Jospin, qui avait (par
exemple) pris l’engagement qu’il n’abandonnerait jamais
les salariés de Renault Vilvoorde, mais qui, nommé Premier
ministre (de cohabitation) en 1997, se ravisa, et leur signifia
(promptement), du haut de Matignon, qu’il les laisserait finalement
à leur (triste) sort : ainsi fut fait.
Trois décennies plus tard, rien n’a d’ailleurs
changé, ou presque, de cette folklorique habitude
– au détail près que François Hollande, moins cauteleux
sans doute que ne l’étaient en leur temps
les caciques du mitterrandisme, a du moins la sincérité
de prévenir de bonne heure son (possible)
électorat qu’il n’a pas vraiment l’intention de tenir
toutes les nouvelles promesses de son parti (dont le
« projet », présenté en grande pompe peu de temps
auparavant, doit donc être tenu pour nul et non
avenu) et faire tôt confirmer par « son entourage »
que son engagement (symboliquement fort) de
revenir sur l’une des mesures les plus emblématiques
du mandat de Sarkozy en restaurant pour tous
une retraite à 60 ans ne sera pas tenu, merci qui ?
Merci la droite, qui a fait le sale boulot.
Itou : la promesse hollandaise de recruter – pour
l’Éducation nationale et quelques autres ministères
– plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires,
où quelques généreux gobe-mouches (trop
oublieux du lourd passif des socialistes désétatiseurs)
ont voulu deviner l’assurance d’une reconstruction
de quelques services publics, s’est rapidement
résolue, à la veille du dernier Noël de Sarkozy à
l’Élysée, dans l’annonce, discrète, que, « compte
tenu des contraintes budgétaires » imposées par la conjoncture, « les postes créés » seraient « compensés ailleurs »…
Exactement comme en 1981, donc : la crise
continue, en 2012, de servir de prétexte aux socialistes,
qui n’entendent nullement s’écarter du
chemin d’une très stricte orthodoxie libérale (au
fallacieux prétexte qu’elle génère pour le vulgum
pecus quelques récurrentes diffi cultés).
Et de nouveau, c’est la rigueur (exigeante, mais
nécessaire), et l’urgence qu’il y aurait à réduire la
dépense publique (plutôt qu’à la repenser à l’aune
– jugée, il va de soi, exagérément gauchiste – d’une
drastique redistribution des contributions respectives
du capital et du travail), qui « justifient » la
« reculade organisée » [1] d’un curieux candidat « progressiste
» chez qui « l’engagement de réduire à
néant le déficit public annuel de la France apparaît
comme le seul objectif prioritaire » , et qui, « en
disputant à la droite » sarkoziste « la manière de
réduire les défi cits, admet implicitement partager
avec elle » [2] cette classique obsession, où s’entend très
clairement l’écho de trente ans d’une propagande soclée dans la scansion que la- France-vit-au-dessus-de-ses-moyens-et-doit-réduire-sa-dépense-publique.
En résumé : les deux principaux candidats à
l’élection présidentielle de 2012 font campagne
sur le même terrain – et ne se distinguent guère,
par-delà leur personnalité respective, que par la
différence, au vrai petite, que l’un veut une austérité
de gauche, cependant que l’autre souhaite
une rigueur de droite.
Il est vrai : l’éditocratie, et pour cause, ne s’émeut
guère (comme ferait un extraterrestre découvrant
que les deux faces d’une même médaille font dans
la France des années 2000 une quintessence de
clivage partisan) de cette gémellité – de ce produit,
fini, de 10000 jours [3] d’un endoctrinement destiné
à circonscrire le « débat » dans un périmètre strictement
libéral.
Bien au contraire : elle l’encourage – fût- ce par
le biais de vraies- fausses concessions au réalisme.
Laurent Joffrin peut ainsi, dans un même savant
article (paru dans le cours de l’automne 2011),
supplier « la gauche » de ne pas tomber dans « le
piège de la rigueur », puis l’adjurer de ne pas se
laisser prendre aux discours de droite [4] prétendant que « la France vit au-dessus de ses moyens », et
qu’elle « doit réduire son train de vie, autrement
dit adopter la “rigueur”, qui est le nom poli de
l’austérité », puis enfin, et par un très subtil réalignement
de sa démonstration – car il serait alarmant
qu’un si réputé journaliste reste trop longtemps trop
éloigné de quelques sûrs fondamentaux –, que la
gauche devrait faire le choix, « non pas d’éviter la
rigueur, mais de l’imposer aux plus fortunés, même
s’il serait » bien évidemment « illusoire de croire
que les classes moyennes et populaires ne seront
pas touchées », et « donner un calendrier crédible
de réduction des déficits ».
Itou, Françoise Fressoz, journaliste au « service
politique » du Monde (dont les articles d’« analyse »
n’encourent que [très] rarement le reproche d’être
outrancièrement hostiles au libéralisme), peut au
même moment décréter, quant à elle, non moins
hautement et fortement, qu’« avec la crise qui s’aggrave,
le projet » de François Hollande « ne peut »
tout simplement « pas être celui que son parti a présenté
à ses adhérents », car il est insuffisamment
réaliste, et qu’il est donc bien normal que « M. Sapin »,
responsable de ce projet, ait (courageusement)
annoncé que « les dépenses annuelles » seraient
« très sensiblement inférieures aux 5 milliards
d’euros prévus », et que « la masse salariale sera
maîtrisée, ce qui signifie que le nombre global de
fonctionnaires continuera », si le Parti socialiste
revient aux affaires, « de diminuer » – comme sous
le règne de l’excellent M. Sarkozy, qui a si bien su,
précisera quelques semaines plus tard la même analyste,
« alléger les dépenses publiques ».
Ainsi font, font, font, les petits choreutes de la
politique et de la presse, qui depuis plus d’un quart
de siècle déclament en canon le même refrain : l’un
pépie que la France vit très au- dessus de ses moyens,
l’autre coquerique qu’elle doit se guérir de son
addiction dépensière, une troisième cacabe qu’urge
la réforme des services publics, puis d’autres encore
s’ajoutent à ce joyeux récital, où tous récitent finalement
qu’il messiérait de renoncer, pour conjurer
la crise, aux riches recettes qui l’ont faite – et cela
fait un spectacle dont le public ne se lasse décidément
pas…
…Puisque cela fait trente années que, très patiemment,
nous l’endurons.


