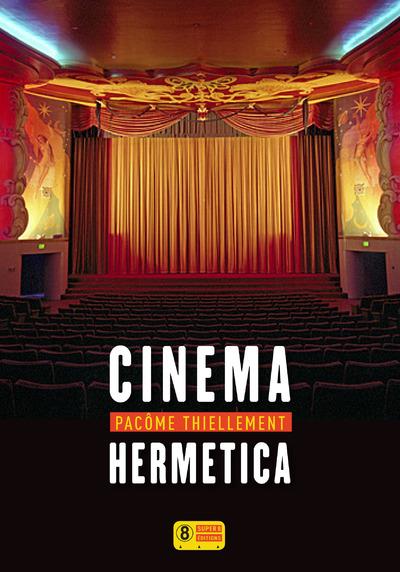Au début de Périclès, une pièce de Shakespeare écrite entre 1607 et 1608, le roi Antiochus propose à son hôte une énigme. Si celui-ci la résout, le roi Antiochus lui offrira la main de sa fille. Cependant, s’il échoue à la deviner, il mourra.
« Je ne suis pas une vipère, pourtant je me nourris
De la chair de ma mère qui m’a donné la vie
J’ai cherché un époux, et dans ce labeur,
J’ai rencontré un père qui m’a donné ce bonheur.
Il est père, fils et un tendre mari
Je suis mère, femme, pourtant sa fille chérie
Comment tout cela, en deux personnes, peut exister,
Si tu veux vivre, il te faudra le deviner. »
Périclès comprend que l’énigme en question est celle de la relation incestueuse entre Antiochus et sa fille. Il devine également que celle-ci est un piège, et, qu’il la résolve ou non, l’hôte mourra. Et il commente :
« C’était un compagnon sage et circonspect celui qui, invité à solliciter du roi ce qu’il désirait, demanda à ne jamais connaître aucun de ses secrets. »
C’est le commencement de cette pièce qui donne naissance à l’épigraphe qui ouvre Mr. Arkadin :
« Un jour, un Roi grand et puissant demanda à un poète : “Que puis-je te donner parmi toutes mes possessions ?” Il répondit sagement : “Tout ce que vous voulez, Seigneur… sauf votre secret.” »
Mr. Arkadin ne révélera pas le secret du Seigneur dont il conte le récit, un secret qui se confond avec le secret du pouvoir dans le monde moderne, un secret concernant l’identité des « agents de la contre-initiation » : les aventuriers de la finance, des affaires internationales et des « spiritualités ténébreuses » dont Gregory Arkadin est l’archétype wellesien.
À l’époque de la préparation de Mr. Arkadin, dans la chronologie incluse dans Moi, Orson Welles, à la date d’octobre 1953, Peter Bogdanovitch note :
« Pendant cette période, Orson Welles rédige un énorme volume sur la finance et les affaires internationales qu’il détruira plus tard. »
Mr. Arkadinnaît de cette destruction. Ce n’est pas l’adaptation de ce livre, c’est l’adaptation de cette destruction – dont il ne reste que les traces résiduelles, prémisses à une enquête infinie. C’est aussi le signe qu’Orson Welles renonce définitivement à la politique (une activité qu’il n’avait cessé de poursuivre pendant sa « période américaine », où il était devenu l’ami de Franklin Roosevelt) et plonge définitivement dans une lecture allégorique du monde moderne qui lui interdit l’activité politique.
L’œuvre de Welles contient 13 films anthumes : Citizen Kane (1941), The Magnificent Ambersons (1942), The Stranger (1946), Lady from Shangai (1947), Macbeth (1948), Othello (1952), Mr. Arkadin (1955), Touch of Evil (1958), The Trial (1962), Chimes at Midnight (1965), The Immortal Story (1968), F for Fake (1974) et le « making of » Filming Othello (1978). Il contient également un grand nombre de films inachevés, artificiellement bouclés après sa mort, partiellement perdus ou encore en attente d’une diffusion. Parmi ceux-ci : It’s all true (qui devait être son troisième film en 1942 et qui a été plus ou moins reconstitué en 1991), Don Quixote (tourné entre 1957 et 1972, plusieurs fois quasi-achevé et abandonné, finalement monté en 1992 de façon très discutable par Jesus Franco), The Deep (tourné entre 1967 et 1970, incomplet), The Merchant of Venice (tourné et achevé en 1969, mais dont une bobine a été perdue par Welles), The Other Side of the Wind (tourné entre 1970 et 1976, et dont les montages successifs restent aujourd’hui encore retenus pour des raisons contractuelles), l’autre « making of » Filming The Trial (dont des rushs ont été tournés en 1981 et restaurés en 2000), The Dreamers (dont des tests ont été tournés en 1982), et enfin Orson Welles’ Magic Show (tourné entre 1976 et 1985, et dont un montage posthume a été également complété en 2000).
Mr. Arkadin se tient non seulement au milieu de son œuvre anthume, mais il est également à mi-chemin du film achevé et du film inachevé. « Mon film le plus charcuté », comme le répétait avec tristesse Orson Welles, « mon chef d’œuvre raté ». C’est le premier film depuis Citizen Kane basé sur une idée originale de Welles, et ce sera le dernier parmi les films anthumes. C’est aussi, comme 8 1/2 pour Fellini ou Nymphomaniac pour Lars Von Trier, un film « portrait éclaté » où il fait se rejoindre tout ce qu’il a fait – et surtout, avant tout, tout ce qu’il aurait voulu faire. Si ce film recoupe dans la filmographie de Welles les enjeux du carnaval, c’est dans le sens où il tente de donner momentanément corps à toutes ses potentialités non exploitées – tous ses possibles inexplorés.
Il y a actuellement six versions de Mr. Arkadin en circulation, auxquelles il faut ajouter une version radiophonique et une version « roman ». Tout d’abord, chronologiquement, trois épisodes de la série radiophonique The Lives of Harry Lime écrite et jouée par Orson Welles entre 1951 et 1952, à la suite du succès du film The Third Man vis-à-vis duquel elle officie comme prequel. Un épisode, Man of Mystery, contient la trame de Mr. Arkadin : un homme qui commandite au personnage principal une enquête sur lui-même. Deux autres épisodes, Murder on the Riviera et Greek Meets Greek, contiennent des éléments secondaires réutilisés dans le scénario du film. Il y a ensuite un roman, écrit par le nègre Maurice Bessy à partir du scénario original de Mr. Arkadin nommé Masquerade. Sa principale différence avec le film est sa narration linéaire – ainsi que l’origine de Arkadin, polonaise dans le roman, russe dans le film. Il y a ensuite les six versions du film :
– Une première version espagnole qu’on appelle « Bob Harden », qui fut la première à être projetée en mars 1955, filmée en même temps que la version anglaise : le personnage de Guy Von Stratten y est nommé Bob Harden, et deux personnages, la baronne de Nagel et Sophie, sont joués par des actrices espagnoles.
– Une deuxième version espagnole, connue comme la version « Mark Sharp », plus longue et jamais diffusée, où le personnage de Guy ne s’appelle ni Guy Von Stratten ni Bob Harden mais Mark Sharpe.
– La version « européenne » nommée Confidential Report, diffusée à partir de Août 1955, qui contient une narration en voix-off de Guy Von Stratten.
– La version « Corinth », plus proche de la volonté originelle de Welles, découverte par Peter Bogdanovitch en 1961 et diffusée aux Etats-Unis à partir de 1962, mais dans laquelle manquent plusieurs éléments-clés, dont une des deux paraboles de Arkadin : celle sur le cimetière des amis.
– la version la plus diffusée, Mr. Arkadin, celle qu’on appelle la « version américaine », qui reprend l’intrigue de façon linéaire.
Enfin, depuis 2008, il existe :
– Une Comprehensive version montée par Stefan Drössier et Claude Bertemes, assistés par Peter Bogdanovicth et Jonathan Rosembaum. Cette « Comprehensive version » tente de reproduire au plus près les intentions d’Orson Welles.
Le fait que Mr. Arkadin soit un film dont il existe plusieurs versions accentuant différentes choses transforme nécessairement le spectateur en un double du stupide personnage de Guy Von Stratten. Et Mr. Arkadin devient lui-même un « dossier Mr. Arkadin ».
Mr. Arkadin est à la fois le plus compliqué des films d’Orson Welles, celui dont il espérait le plus grand succès populaire, et peut-être celui qui renferme le « secret » du cinéaste. Il a beau être réalisé en 1955, sa genèse remonte loin, et plus loin encore que le spectateur de Welles ne peut l’imaginer. A notre tour, commandités comme Von Stratten par Arkadin/Welles, nous allons tenter de remonter lentement à sa « source » ou son « secret », par flash-backs successifs, un peu comme la logique du film, où on cherche à remonter le long d’une histoire à la source d’un secret qui ressemble à un secret de polichinelle – à moins que celui-ci ne soit là que pour masquer un secret plus grand, toujours visible mais jamais dit tout le long du film. Ce secret est le secret du pouvoir – et son talon d’Achille. Et comme la lettre volée d’Edgar Poe, il est « caché en pleine lumière ».

Mr. Arkadin raconte le récit de deux aventuriers, un voyou un peu vulgaire, Guy von Stratten, et sa maîtresse, la strip-teaseuse Milly, à qui Bracco, un bandit mourant sur le port de Naples, confie un secret qui leur apportera la richesse. Ce secret contient deux noms : Grégory Arkadin et Sophie Radzweickz. A Juan-les-Pins, Von Stratten et Milly tentent de s’approcher d’Arkadin, Milly en séduisant Arkadin dans des soirées très alcoolisées (celui-ci l’assassinera en mer, et on retrouvera son corps abandonné sur une plage en ouverture de film ; une image qui annonce celle de Laura Palmer dans Twin Peaks), Von Stratten en séduisant la fille d’Arkadin, Raina, dont on ne rencontre jamais la mère.
La séduction de Raina par Guy ne plaît pas à Arkadin qui décide tout d’abord de régler cette affaire en déposant un « dossier secret » sur le petit escroc dans la chambre de sa fille. Mais cela est insuffisant : Von Stratten continue à ne pas déplaire à Raina ; et surtout il oppose son maigre dossier judiciaire – il s’appelle en réalité George Streitheimer et a fait du trafic de cigarettes – aux crimes possibles d’Arkadin. Arkadin change alors de stratégie. Il prétend lui confier un secret : « ne pas savoir qui il est ». Il dit ne se souvenir de sa vie qu’à partir de l’hiver 1927, alors qu’il était un jeune homme à Zurich, avec un costume et une mallette contenant 200 000 francs suisses. A mesure que Von Stratten remonte le secret des origines d’Arkadin, Arkadin tue, un à un, tous ses témoins et anciens amis.
A Munich, il finit par entrer directement en guerre contre Von Stratten. Dans un moment de malice, Von Stratten comprend que la seule chose qui compte aux yeux de Arkadin est sa fille, et il lui fait raconter un mensonge par une tour de contrôle reliée à un avion – le mensonge serait qu’elle « sait tout sur lui », ce qui provoque le suicide d’Arkadin. Le film s’achève sur la rupture entre Von Stratten et Raina, cette dernière repartant en voiture avec son ami, dont on ne sait trop s’il fonctionne comme un prétendant ou un chaperon, le baron de Rutleigh.
C’est une première couche de récit. Mais ce qu’on entraperçoit dès la première vision, c’est que le secret n’est probablement pas celui qu’on dit. Tout d’abord, Raina est morte de rire quand Guy Von Stratten lui explique l’enquête que lui a confiée son père. Elle ne croit pas un seul instant que son père ignore qui il est, ou qu’il ait oublié d’où il venait. Cette enquête est une première fausse piste, et elle est redoublée par le fait que les témoins ne cherchent aucunement à ennuyer Arkadin : soit ils se souviennent de cette histoire moins bien que lui ; soit ils y accordent une importance bien moindre ; soit, enfin, comme Sophie, ils lui pardonnent. Arkadin, par contre, les assassine les uns après les autres – n’ayant finalement qu’un seul motif : que sa fille n’en sache rien.
Ensuite, deuxième couche de récit : l’histoire qui relie souterrainement tous ces personnages. Celle-ci est difficile à retranscrire, tant elle est énoncée généralement vite, dans le plus complet désordre. Welles utilise une technique narrative qui lui plaît particulièrement, présente dès Citizen Kane et sa structure mélangeant flashbacks, films d’actualité, documents : à savoir jouer sur les limites de l’enregistrement d’informations du spectateur. Ce trait de composition permettra en 1974 le tour de force de F for Fake, où Orson Welles, en prestidigitateur suprême, passe insensiblement de la vérité au mensonge en faisant oublier au spectateur une des conditions de sa promesse : ne pas mentir pendant une heure, et le film fait une heure vingt. La trahison du pacte fait toujours partie du pacte. Comme le Scorpion finit toujours, quitte à se noyer, par piquer la tortue, Orson Welles finit toujours par tromper le spectateur – ou l’illusionner. C’est son caractère, c’est également son drame.
Le titre original de Mr. Arkadin est Mascarade. Les masques sont le thème principal du film, qui croise et englobe ceux de l’identité (ou du « caractère »), de l’amitié et du secret. Au cœur du film, peu de temps après la scène de bal masqué en Espagne, il y a une succession de saynètes mettant en scène les complices du jeune Arkadin. C’est une galerie de personnages, qui est aussi une galerie de masques, ou de marionnettes, et qui rythme le cœur du film : Radzinsky et son cirque de puces, Tadeus dans son bar gay à Tanger, Trebitsch et ses chats, la comtesse de Nadal, Oskar et son accordéon, Sophie tapant le carton avec son mari, Jacob Zouk obsédé par le foie d’oie. On peut considérer que les témoins et anciens amis d’Arkadin, allégorie de cette mascarade qui est le thème du film, sont comme les « peaux » successives d’un même personnage, l’effeuillement des personae d’Arkadin. Et tous sont reliés à une histoire collective particulièrement obscure et moche, qui fonctionne comme une scène derrière la scène. Leur caractère fantaisiste, farfelu, sentimental, est le plus pervers des masques utilisés dans le film. Ils ont une apparence grotesque très attachante mais un cœur très noir. Ils cachent tous de lourds secrets.
Ils sont tous complices – à part la comtesse, qui faisait partie de la police secrète ayant démantelé leur réseau – dans une affaire de traite des blanches masquée derrière une académie de danse à Varsovie, où on enlevait les jeunes filles et on les envoyait comme esclaves sexuelles en Amérique du Sud. Le chef de cette fausse académie de danse était Sophie Radzweickz. On pense à l’académie de danse de Suspiria, basée sur une véritable école de danse masquant un centre de magie noire. De ces éléments-là, comme de la première identité d’Arkadin, Wasaw Athabadze, nous ne saurons rien. Le film tourne ainsi autour de plusieurs cœurs sans qu’on puisse les voir. Mais, de ce rapprochement, on peut tirer une des spécificités du film : si Suspiria est une enquête sur les « centres de contre-initiation », Mr. Arkadin est le portrait d’un des « agents » formés par ces centres. Mr. Arkadin est le portrait d’un des plus puissants facteurs de destruction du monde moderne, qui se confond avec la destruction de l’innocence.
Ce qui fait circuler les éléments du film, ce sont les tabous. C’est aussi ce qu’on peut identifier comme des repères historiques mais inversés ou déplacés, tels le portrait d’Hitler à l’envers dans la mansarde de Jacob Zouk. Les éléments historiques liés à Grégory Arkadin après Zurich, finalement encore moins connus du spectateur, c’est Milly qui les prononce, ivre, dans une scène où la caméra mime un bateau qui tangue. Tout est flou et confus comme dans une soirée d’ivresse où des choses se disent mais où, le lendemain, on ne se souvient clairement de rien – et d’ailleurs le spectateur oubliera tout dès la scène suivante. Milly y évoque des armes vendues en Chine, l’or des nazis et les routes des fascistes en Ethiopie. Mais le spectateur, même s’il revoit le film quinze fois, aura du mal à se souvenir de ce qui a été dit, tout d’abord parce que la caméra tangue et l’enivre, ensuite parce que c’est la scène de séduction de Milly et de Arkadin qui le fascine à cet instant, et le danger de plus en plus évident que celle-ci représente pour Milly qui semble se jeter « dans la gueule du loup ».

Le spectateur sait également qu’Arkadin est trafiquant d’armes, aventurier du monde de la finance et actionnaire dans de multiples sociétés. Entre cette séquence et la forme générale du film, où Welles privilégie le grand angle, les flous, les décadrages et un montage très saccadé, on se rend compte que le cinéaste qui a, en quelque sorte, le mieux répondu au projet « wellesien » est probablement Oliver Stone, avec ses fresques politiques qui fonctionnent comme des portraits explosés, aux séquences aux tonalités émotionnelles contradictoires : JFK, Nixon… Un premier hommage réside dans Tueurs Nés, dans la scène de l’Indien, qui raconte une histoire faisant écho aux deux paraboles wellesiennes du caractère et de l’amitié. Enfin, Wall Street 2 montre directement au spectateur l’allégorie autour de laquelle Mr. Arkadin tourne sans jamais la dire directement – qu’on ne cesse de voir et de ne pas voir.
Comme dit le personnage de Sir Joseph : Grégory Arkadin est à la fois « un des plus grands aventuriers du monde de la finance », « un homme sans scrupule » et « le symbole d’une ère de crise et de dissolution ». Dans les commentaires en bonus du coffret Criterion, les deux wellesiens Jonathan Rosenbaum et James Naremore s’accordent à dire que la « critique du monde moderne », une constante du cinéma de Welles, n’a jamais autant de sens que dans Mr. Arkadin, à part peut-être dans Chimes at Midnight. Dans The Magnificient Amberson, malheureusement bien charcuté par les producteurs, Orson Welles exprimait déjà, dans sa focalisation sur l’automobile et sa répudiation par son inventeur, Eugène Morgan (Joseph Cotten), son rejet de la modernité défigurant la beauté et la grandeur du passé. Ce sentiment est évidemment exprimé dans The Chimes at Midnight dans la trahison de Falstaff par le prince Hal – pour lui le représentant du monde moderne, les Tudor. « Son petit œil de Gallois guette la gloire et la dignité futures dès le début, dit Orson Welles à Peter Bogdanovitch dans Moi, Orson Welles : cette créature abominable est un grand homme de pouvoir. » Orson Welles associe la fin de l’Age d’Or à la mort du dernier Plantagenet – la mort de Hotspur. Et l’arrivée des Tudor, « le nouveau type de prince, l’homme moderne ». « Le paradis perdu, dit encore Orson Welles à Peter Bogdanovitch, c’est un thème qui m’intéresse. Une nostalgie pour le jardin d’Eden. »
Dans Mr. Arkadin, le thème anti-moderne est exprimé d’abord dans la séquence des pénitents : le contraste entre la procession des pénitents et le personnage de Guy von Stratten, en chemise hawaïenne, fumant un cigare et mâchant un chewing-gum en même temps. Elle se retrouve dans la phrase de Sir Joseph, et même dans la visite dans une église à Munich le jour de Noël. Mais elle informe surtout la base sur laquelle le personnage d’Arkadin est construit : un archétype de la réussite dans les Temps Modernes, à savoir un homme qui efface son passé, assassine de ses propres mains ses amis, et s’enrichit à travers les pires méfaits que le siècle lui permet.
C’est à partir de cette figure (la duplicité et la nostalgie de l’innocence) qu’il faut comprendre l’usage particulier du masque dans Arkadin. Si le masque a plusieurs significations symboliques dans ce film, sa première est celle de l’intention cachée. Welles reprend là le motif de Othello et la confrontation entre le Maure de Venise et Iago qui dit « Je ne suis pas ce que je suis ». Arkadin dit « Je ne sais pas qui je suis » et d’une certaine façon, bien que son intention soit alors de manipuler son interlocuteur, c’est vrai. Passé un certain degré de duplicité, après les multiples trahisons de son passé et des amis avec qui il le partagea, l’homme derrière le masque finit toujours par perdre le sens de son identité. Délivrés de rien, intensifiés sur tout, les représentants de la « contre-initiation » meurent toujours d’une mauvaise mort.
Dans un certain nombre de ses films, Welles règle ses comptes avec des personnalités importantes de la vie publique : William Randolf Hearst dans Citizen Kane , Nelson Rockfeller dans La dame de Shangaï, Howard Hugues dans F for Fake. Mr. Arkadin est un mixte de figures, parmi lesquelles Joseph Staline et sa propension à assassiner les hommes qu’il a connus. Mais la pièce la plus essentielle et la plus mystérieuse de ce puzzle est sans doute Sir Bazil Zaharoff. Zaharoff faisait partie des personnages joués par Welles dans l’émission de radio The March of Time : il se faisait balader dans sa roseraie et parlait avec ses fleurs quelques jours avant sa mort. Il fait aussi partie des « modèles » de Citizen Kane, et, sur bien des points, Mr. Arkadin peut apparaître comme une variation sur Kane, un « remake métaphysique ». Comme si Welles voulait recommencer son œuvre à zéro, de façon plus claire, plus complète, mais également plus mystérieuse, plus intense.
Né Zacharie Vasiliou Zaaharoff, marchand d’armes et financier – un des hommes les plus riches de son Temps, d’une fortune estimée à 500 milliards d’anciens francs – Sir Bazil Zaharoff est peut-être né dans une famille grecque très pauvre de Constantinople le 20 octobre 1850 (comme Arkadin, on n’en sera jamais sûr). Ses vingt premières années sont très obscures. C’est un petit voyou des rues qui s’est hissé à l’état de grand aventurier par la ruse et l’absence de remords, et grâce à la crise économique de 1870 qui engendra une floraison de marchés d’armements dans la zone balkanique. Âgé de 24 ans, Zaharoff se lie d’amitié avec un journaliste politique, Etienne Skouloudis. Skouloudis le recommande au fabricant d’armes Thorsten Nordenfelt pour un poste de représentant. Une de ses ventes les plus importantes sera celle du Nordenfelt I, un sous-marin à vapeur dont Zaharoff vend le premier modèle aux Grecs, et deux autres aux Turcs en leur expliquant que le modèle vendu aux Grecs représente une menace sérieuse ; puis il persuade les Russes du danger de la flotte turque et il leur en vend deux autres…
Devenant actionnaire dans l’industrie de l’armement, armant réciproquement l’Allemagne et l’Angleterre, puis la Russie, rachetant l’Union Parisienne des Banques pour contrôler les arrangements financiers, prenant le contrôle du journal Excelsior pour s’assurer de lignes éditoriales favorables aux guerres qui l’enrichiront, s’assurant de l’implication de la Grèce dans le conflit pour renforcer le front oriental et destituant, par une inlassable campagne de presse, Constantin Ier qui refusait de s’y impliquer, Zaharoff peut être considéré comme un des artisans principaux de la Première Guerre Mondiale. Il en est également le principal bénéficiaire. Et son récit est l’illustration parfaite de la phrase d’Anatole France :
« On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels. »
Zaharoff meurt à Monte-Carlo en 1936.

Au moment où Welles écrit Arkadin, Zaharoff est déjà le modèle d’un personnage de film, The Most Dangerous Game (Les chasses du comte Zaroff) produit par le duo Cooper/Shoedsack en 1932, en même temps que King-Kong. Il deviendra également le personnage de Basil Bazaroff dans L’Oreille cassée de Hergé, où il arme le général Alcazar avant de s’envoler pour l’Etat voisin afin d’armer également ses adversaires. Il apparaît sous le nom de Sir Zenos Metevsky dans les Cantos XVIII et XXXVIII d’Ezra Pound. À son sujet, il écrit :
« La guerre, une guerre après l’autre / Ceux qui les déclenchent ne seraient pas capables de construire correctement un poulailler. »
Dans Mr. Arkadin, une remarque de la comtesse de Nadal définit assez bien le destin de Zaharoff :
« Les criminels sont simplement des ratés, qui ont échoué à bâtir une grande fortune. C’est une question de classe sociale. L’éthique n’a rien à voir là-dedans. »
Le nom de Zaharoff apparaît dans la correspondance de René Guénon avec Vasile Lovinescu. Guénon dit que Zaharoff était probablement la personne – identifiée comme Maître Ragoczy par les membres de la Société Théosophique – qu’il devait rencontrer en 1913 lors de la constitution de l’Albanie en état indépendant, la candidature pour ce titre du neveu de la Reine de Roumanie et l’intervention d’organisations islamiques alors présentes dans le pays vis-à-vis desquels on attendait l’intercession de Guénon. La personne au cœur de cette rencontre était le mystérieux Joseph Schneider, alias Bô-Yin-Râ, un initié allemand se disant médiateur et envoyé de la Great White Lodge. Dans une lettre du 25 novembre, Guénon émet la possibilité que Zaharoff soit un « représentant » d’une des branches de la contre-initiation. Et il évoque ses rapports avec Annie Besant, de la Société Théosophique, chargée par le chef du parti travailliste britannique Ramsay MacDonald, de rédiger un projet de constitution pour l’Inde.
Guénon revient sur les relations Zaharoff-Besant dans une lettre ultérieure et évoque un voyage commun en Transylvanie, dans le château de Herniach. Il parle également des liens de Zaharoff avec « un agent très actif de la contre-initiation », Albert de Monaco. Parmi les personnalités historiques que Guénon considère comme des agents de la contre-initiation, il y a Nicolas Roerich, lui aussi proclamé légat de la Great White Lodge. Un autre agent serait l’Aga Khan – dont Rita Hayworth épousera le fils. Enfin Guénon évoque également Ignaz Trebitsch-Lincoln, un confidence man de haut vol, dont le nom se retrouve, comme un signe bizarre, parmi ceux des complices de Arkadin.
Dans Mr. Arkadin, Welles rejoint Guénon puisqu’il fait du marchand d’armes la figure-archétype du monde moderne. Et si l’image principale de Arkadin est celle de l’aventurier de la finance comme héros d’une époque de dissolution, elle est aussi celle de l’homme sur lequel la transcendance, le sentiment de la responsabilité ou de la réalité du Mal, n’ont plus aucune prise.
Ce que le film suggère, c’est qu’Arkadin est l’aboutissement de ce monde et que n’importe qui peut devenir Arkadin si les circonstances lui sont favorables. Grégory Arkadin, comme Sir Basil Zaharoff, est simplement la production naturelle de la finance aventurière. Ce que Arkadin ne sait pas faire, c’est quelque chose qui vienne de ses propres mains. Corrélativement, Arkadin est l’homme qui ne peut pas vivre sans masque, et sans tuer tous ceux qui, selon lui, l’ont démasqué. On pense à l’aphorisme de Nietzsche :
« Donne-moi, je t’en prie, donne-moi... – Quoi donc ? – Un autre masque, un second masque ! »
Ce qu’Arkadin sait faire, c’est séduire, faire peur, troubler, inquiéter, voler, tuer. Devenu Arkadin par hasard, étant à la fois incapable de retenir une amitié et de résister à ses pulsions (ce qu’il appelle son « caractère »), il n’a pour construire son identité qu’un pivot : son secret, qui se confond avec sa propre fille. Et c’est ce qui fait à la fois le cœur d’Arkadin et le lieu de son tabou – reproduisant ici le « secret de Périclès ». Sa fille est le seul point dans sa vie qui ne puisse faire l’objet d’une transaction – c’est la limite de son capitalisme aventurier. Et c’est d’ailleurs ce qu’on peut élaborer, de Périclès à Chinatown, sur la figure de l’inceste associée au pouvoir. L’ultime transgression, celle de l’inceste, devenant à la fois le pivot de l’identité du personnage et son talon d’Achille, son unique « faiblesse ».
La relation père-fille de Arkadin-Raina annonce d’ailleurs les incestuosités contemporaines – et l’autre grand successeur de Mr. Arkadin, après Olivier Stone (dont Tueurs Nés contient également un rappel de l’inceste père-fille sur le personnage de Mallory Knox), est la série Alias produite par J.J. Abrams, jouant sur les questions de masques, d’identités, de caractères et de secrets. Dégringolant à partir de la quatrième saison dans une direction toujours plus caricaturale, les trois premières saisons d’Alias portaient la promesse d’une véritable fantaisie wellesienne, avec retournements de situations, cosmopolitisme, jeux de masques, mais aussi enquête sur une très équivoque et anxiogène relation père-fille, avec un père qui se révélait de plus en plus obscur et angoissant jusqu’à la fin de la troisième saison (avant de se transformer en toutou docile dès le début de la quatrième, faisant violence d’une façon inouïe à toutes les ramifications déductibles du dernier épisode de la troisième saison).
C’est aussi une série basée sur la duplicité, comme Arkadin et comme le destin de Sir Basil Zaharoff. Tout le long de la série, les agents secrets sont des agents doubles, toujours en train de travailler pour deux entités opposées. Ajoutons que si l’inceste est présent dans le théâtre élisabéthain – notamment la pièce Dommage qu’elle soit une putain de John Ford, dépeignant l’amour fou entre un frère et une sœur – l’inceste père-fille reste un tabou relatif, le commencement de Périclès ayant finalement quelque chose d’une proposition « extrême » de la part de Shakespeare.
Ce type de personnages – self-made men et hommes d’affaire se vivant comme des surhommes – semble apparaître régulièrement lorsqu’on aborde le terrain du pouvoir, et finalement forme une espèce particulièrement redoutable de figures récurrentes d’ogres nourrissant la fiction moderne. On peut penser à Noah Cross dans Chinatown de Roman Polanski. En effet, Cross engage le détective Jake Gittes pour qu’il retrouve le fruit de ses amours incestueux et nouvel amour possible, au risque, comme Arkadin avec Von Stratten, que celui-ci découvre son « secret ». Il faut également évoquer George Hodel, l’assassin du Dahlia Noir et père incestueux de sa propre fille tel que l’a recoupé son propre fils, Steve Hodel, dans sa grande enquête. On doit également penser à Leland Palmer dans Twin Peaks, avocat du magnat de l’industrie Ben Horne, dont l’objectif est de détruire la forêt de Ghostwood pour l’urbaniser.

Parmi tous ces films ou ces séries abordant la violence de l’inceste père-fille – Chinatown, Le Dahlia Noir, Twin Peaks, Tueurs Nés, Festen, De beaux lendemains, Veronica Mars, Les salauds, True Detective – le plus hallucinant reste Aguirre dans lequel le personnage du conquistador joué par Klaus Kinski annonce qu’il épousera sa propre fille pour fonder la lignée la plus pure d’Espagne. Ce qui est proprement incroyable, c’est la réalité des viols incestueux perpétrés par Kinski sur sa propre fille Pola entre ses 9 et 19 ans – viols qu’il excusait ainsi auprès d’elle :
« Tous les pères font ça. »
Ces viols n’ont été révélés que fort récemment dans son livre-témoignage, Tu ne diras rien, mais furent confirmés par sa sœur Nastassja. Du reste, lui-même ne les a pas tellement cachés. Dans son autobiographie de 1975 Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund (« Je suis tellement fou de ta bouche de fraise », paru en France sous le titre Crever pour vivre), Kinski déployait un long monologue sur ses relations sexuelles avec de très jeunes filles portant des cartables. Il disait avoir couché avec sa mère et sa sœur, parlait de son désir de faire jouer à Nastassja Kinski son amoureuse dans son film Paganini. Il évoquait Pola à Rome :
« Je reste seul avec elle. Elle a presque 13 ans et je suis fou d’elle. »
Et surtout :
« À travers toute cette fornication je ne cherche qu’à donner de l’amour. Peu importe à qui, ma mère ou ma sœur, ma femme ou ma fille. »
Dans Conquête de l’inutile, le journal tenu pendant le tournage de Fitzcarraldo, Herzog note, à la suite d’une colère violente de l’acteur :
« Il a alors raconté sur un ton menaçant ce qu’il avait fait avec ses deux filles, Pola et Nastassja, et ajouté que cela lui aurait valu vingt ans de prison aux Etats-Unis. »
Une des rémanences troublantes de cette histoire sont les récurrences indirectes du motif incestueux dans la filmographie de Nastassja Kinski. Son premier grand rôle fut dans Tess de Polanski. Et elle apparaît dans la conclusion de Inland Empire de David Lynch. Soit deux cinéastes ayant travaillé sur le motif du viol incestueux père-fille.
Chaque portrait que fait Orson Welles est une conjuration de l’homme qu’il aurait pu être. Ce sont des personnalités feuilletées, des « moi » illusoires qu’il s’agit de faire tomber. Citizen Kane, George Amberson, Michael O’Hara, Hank Quinlan, Mr. Clay… Sa cinématographie est une démascarade. Dans sa vie il n’a cessé de conjurer ces tendances pour laisser sir John Falstaff gagner sur celles-ci. Devenir Falstaff, soit faire gagner l’insouciance contre les puissances de duplicité. À l’époque de Mr. Arkadin, il a rencontré Paola Maori. Il a décidé de devenir un citoyen du Monde basé en Europe. Il a déjà le ventre et le cœur gros qu’il portera jusque dans sa tombe. Mais surtout il a enfin décidé de faire le deuil de son plus grand et célèbre amour : Rita Hayworth.
En 1943, Orson Welles épouse Rita Hayworth. Quatre ans plus tard, en 1947, alors qu’il réalise La Dame de Shangaï, ils sont déjà en instance de divorce. L’idée que La Dame de Shangaï représenterait une vengeance de Welles vis-à-vis de Rita est la plus stupide et la plus vulgaire qu’on ait jamais énoncée. Orson Welles aimait non seulement passionnément Rita Hayworth mais sa rupture fut pour lui un grand chagrin. Il n’en « voulait » pas à Rita Hayworth ; il était triste de ce qui avait pu empêcher leur amour de s’épanouir :
« J’avais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Il faut croire que je ne lui apportais que des tourments. Je me disais que quelqu’un d’autre peut-être pourrait la rendre heureuse. Manifestement je n’y arrivais pas, ou tout à fait exceptionnellement. Je me voyais condamné pour le restant de ma vie à retrouver une femme en pleurs à chaque fois que je rentrerais à la maison. Je me sentais affreusement coupable, d’autant que je l’adorais. C’était déchirant. »
C’est une ironie morbide de se dire qu’elle se jettera ensuite dans les bras du très cruel fils de l’Aga Khan, puis terminera sa vie atteinte d’Alzheimer.
Réalisé en 1955, Mr. Arkadin est le film où Welles tente de faire le deuil de cet amour impossible. Pour cela, il tente de l’exprimer comme le secret du film. Puis il le re-masque et le laisse réapparaître invisiblement comme secret. En effet, le secret autour duquel tourne inlassablement le film est la relation entre Arkadin et sa fille, comme complément de sa place dans l’Histoire. Et si Zaharoff semble un modèle adéquat pour la personnalité d’Arkadin, et Staline celle de l’homme qui tue les anciens amis qui l’ont connu, le rapport à l’inceste et au secret renvoie chez Welles à son grand amour et terrible chagrin, Rita Hayworth, qui fut elle-même une fille abusée par son père, le danseur Eduardo Cansino. Et ce traumatisme se rejoua toute sa vie dans ses relations avec les hommes. On sait à quel point Welles eut du mal à quitter Rita Hayworth. « Peut-être vivrai-je si longtemps que je finirai par l’oublier » disait encore d’elle Orson Welles, faisant écho à la conclusion de La Dame de Shangaï :
« Je vivrai peut-être assez vieux pour l’oublier. Je mourrai en essayant. »
Les deux éléments qui semblent obséder Welles se recoupent en ce point : le monde moderne se caractérise par une inversion de la transmission dans lequel les hommes de pouvoir dévorent leurs enfants et perdent alors la dernière trace d’innocence qu’ils pouvaient encore conserver. Le suicide d’Arkadin est la découverte par celui-ci qu’il a éteint la dernière trace de lumière qu’il contenait encore – un moment de lucidité comparable au suicide de Leland Palmer dans Twin Peaks. Le suicide de Arkadin, c’est le moment où il n’a plus aucun masque derrière lequel se cacher – pas même celui du père de Raina.
Rosenbaum et Naremore ont raison de citer John Ruskin pour expliquer la place du « grotesque » dans la mascarade qu’est Mr. Arkadin : il y a la dimension carnavalesque proprement dite, liée à la paysannerie du Moyen-Âge, la tradition populaire d’où découlent Shakespeare comme Rabelais (et Orson Welles s’y rattache profondément), mais il y a aussi le monde de l’aristocratie décadente et de la bourgeoisie triomphante, comme dans le cas du carnaval de Venise (et dans ce sens Arkadin annonce Eyes Wide Shut). Pendant longtemps, le carnaval, et son attribut : le masque, furent là pour compenser la sortie de l’Age d’Or et la division des hommes entre riches et pauvres, faibles et forts, grands et petits, hommes et dieux, etc. Les masques figurent alors, le temps du carnaval, la potentialité que la quotidienneté ne permet pas d’exploiter et impliquent la possibilité de la réalisation de chacun.

C’est probablement le sens métaphysique des saturnales : l’attribution momentanée d’une puissance qui dépasse l’homme. Lorsque le carnaval changea de nature (l’image du carnaval du dix-huitième siècle, avec son costume typique : le « domino », avec sa cape noire, son tricorne et son masque blanc), le masque aussi changea de nature, et devint l’image du vice comme bon plaisir du prince : non plus les potentialités non exploitées des hommes à la recherche de leur complétude mais, pour le privilégié, un moyen supplémentaire d’exercer son pouvoir sur les autres. Non plus la compensation mais l’accroissement des différences entre les hommes. Et le cinéma de Orson Welles ne cesse de passer de l’un à l’autre – d’où l’ambigüité du rôle du masque dans le film, et d’où la relation ambiguë de Welles avec le carnaval, auquel parfois il dit se rattacher, et que d’autre fois – comme lorsqu’il parle du carnaval de Rio dans It’s all true – il prétend haïr. Et d’où l’ambigüité, la fascination de Orson Welles pour le personnage d’Arkadin lui-même. Le masque est à la fois puissance carnavalesque d’épuisement des potentialités non-exploitées (carnavalesque médiéval), et annonce apocalyptique d’une dévoration définitive par le néant (carnavalesque aristocrate décadent). Le masque de Arkadin, c’est la disparition de l’être humain par la dévoration des pulsions intensifiées jusqu’à l’explosion de l’ego.
Dans Twin Peaks, on retrouve l’ambigüité « grotesque » qui hante le cinéma de Welles, figuré par le double-usage du masque. Le masque est le visage même du sauteur qui bondit pendant la scène mystique du Garmonbozia, symbole de métamorphose. Mais ce masque, lorsqu’il est porté par l’enfant, renvoie aux viols incestueux du père de Laura :
« L’homme derrière le masque recherche le journal aux pages arrachées. Il est déjà sous le ventilateur »
dit-il en apparaissant à Laura près du RR. L’homme derrière le masque, c’est l’homme qui cache sa véritable nature derrière les apparences d’un bon père de famille ; c’est le démon caché derrière le masque de l’homme ; c’est enfin l’impossibilité de voir cette atroce réalité directement, et la nécessité chez les enfants victimes d’abus sexuels de se raconter une histoire qui la recouvre, des histoires de contes de fée, comme Raina : avec des ogres, des loups, des monstres dangereux. Il faut ajouter que cette présence de l’inceste n’entre pas en contradiction avec le rejet de la psychanalyse freudienne par Welles ou par Lynch – la psychanalyse freudienne renvoyant au désir de l’enfant de coucher avec ses parents tandis que les films de Welles ou de Lynch parlent de l’inceste, non comme d’un fantasme mais comme d’une atroce réalité, réalité absolument non désirée, et de la tentative de conjurer celle-ci par des images-écrans ou des récits-couvertures.
La confrontation entre Arkadin et ses anciens complices raconte quelque chose de très triste. Tous les « masques » ou « hommes » qui traversent le film ont une beauté qui les traverse, une qualité d’innocence qui s’extrait de leur personnalité comme un rayon de lumière d’un mur de briques opaques. C’est l’idée, shakespearienne, de Welles que tout homme a quelque chose de bon – ou, renoirienne, que « tout homme, même mauvais, a ses raisons d’agir ainsi » – cette idée qu’on retrouve dans La Soif du Mal quand la diseuse de bonne aventure, Tanya, prononce au moment de la mort de Hank Quinlan le phrase bouleversante :
« C’était quand même une sorte d’homme. Quelle importance ce qu’on peut dire des gens ? »
Radzinsky a la passion du cirque, Tadeus une sentimentalité étrange, Trebitsch est attaché à ses chats, Oskar exprime une fragilité et joue de la musique, Zouk est obsédé par la nourriture, et Sophie, bien sûr, sait pardonner. Arkadin a une zone obsessionnelle : sa fille, mais on ne peut pas dire que cet élément le « sauve », au contraire elle apparaît comme un lieu supplémentaire d’intensification de ses pulsions destructrices. En réalité cet élément, qui distingue Arkadin des autres masques d’Orson Welles (de Kane à Clay), est le noyau de l’intrigue du film : Arkadin est l’homme qui, progressivement, s’est dépouillé de tout ce qu’il avait de bon. C’est un homme qui, à force de meurtres d’amis, n’est plus qu’un monstre de pulsions destructrices.
Le bal masqué donné par Arkadin dans son château en Espagne, avec des masques de Goya, fait partie de la mascarade qui dévoile et masque simultanément le sujet central – ces masques tournent autour de l’allégorie principale (et non montrée dans le film) de Goya, la célèbre peinture Saturne dévorant ses enfants. Cette peinture que Goya avait inscrite à même le mur de sa maison et qu’Oliver Stone filmera, à la place de Welles, dans Wall Street 2. On dit que Goya avait peint cette allégorie en réaction à sa vision du pouvoir dévorant ses sujets. Alors qu’il mange ses enfants, on voit Saturne se dissoudre lui-même dans le Temps. Tel le scorpion de la parabole, cette peinture parle de l’impossibilité d’échapper à ses propres pulsions autant que de la transmission renversée du monde moderne. Les représentants du monde moderne veulent manger leurs enfants de peur de se dissoudre eux-mêmes dans le Temps. Mais ils disparaîtront quand même.

Orson Welles, à la suite de Shakespeare, est un contempteur du monde moderne parce que celui-ci encourage le deuxième usage du masque, celui de l’hypocrisie, du mensonge, de la destruction d’autrui. Othello est toujours représenté comme un naïf – qui croit ce qu’on veut lui montrer, cible de Iago comme « symbole de l’homme moderne ». Mais Le Roi Lear également est une pièce basée sur le conflit entre ce qui est montré et ce qui est caché – l’amour de Cordélia étant silencieux, Lear croit les mensonges des deux autres sœurs. Le drame est là : que seules les âmes corrompues soient capables de certaines choses. Que seules les âmes corrompues puissent tirer leur épingle du jeu.
Dans l’interview qui structure le documentaire de 1986 de Leslie Megahey pour la télévision anglaise, (Stories from a life in film, Orson Welles le dit :
« Shakespeare était vraiment préoccupé, comme je le suis, à mon humble manière, par la perte de l’innocence. Il y a toujours eu une Angleterre, une Angleterre plus ancienne, qui était plus douce, plus pure, où l’herbe sentait bon, où la température était plus clémente et où les jonquilles s’ouvraient dans la tiédeur de la brise. On retrouve cette nostalgie chez Chaucer. On la retrouve chez Shakespeare. Il était profondément contre le monde moderne – comme moi. Je suis contre le monde moderne. Il était contre le sien. Ses mauvais sont des gens modernes, ils viennent du « continent ». Je vois les méchants dans Lear comme « non anglo-saxons ». Ils viennent de « là-bas », ils représentent le monde moderne. L’ingratitude filiale et tout cela. Je crois que Shakespeare était un écrivain anglais typique, archétype même dans le fait qu’il ait été préoccupé par Camelot, la grande légende anglaise. »
Arkadin est la représentation d’un monde d’où l’innocence a presque intégralement disparu.
Il faut encore ajouter une chose, qui conditionne la réception du film : Mr. Arkadin est aussi un film de Noël – avec le sapin, la fête, le foie gras… L’association des masques et de l’Hiver fait immédiatement penser à la généalogie de Claude Gaignebet, où le masque est associé au maillage, au visage maculé des lépreux, aux crêpes, aux cratères de la lune, et surtout au retour des morts lors des « douze jours ». Le masque révèle la présence, sur la Terre, du non-humain. Et si cette présence peut, dans certains cas, indiquer la délivrance de l’ego, la mort-au-monde et l’apparition d’une autre âme, elle dirige aussi notre attention vers l’intensification de l’ego et la disparition de l’âme dans l’inhumain. Ce que raconte Mr. Arkadin, c’est la proximité des sages, des « hommes réalisés » et des hommes d’affaires sans morale, qu’on pourrait dire « masques réalisés ». Tous deux ont « quitté l’humanité ». Tous deux sont dans le monde comme « des morts marchant ». Et surtout tous deux l’ont fait en « se dépouillant des pelures du vieil homme » comme dirait saint Paul.
Mais de deux façons différentes : le sage en tuant en lui tous ses masques grotesques, toutes ses identités monstrueuses – et finalement c’est ce que Welles fait à sa manière, pour conserver tout de même un masque, mais le plus aimable : Falstaff ; l’homme d’affaires sans morale, en les tuant sous la forme de ses complices et amis. En détruisant tous ceux qui connaissent son secret, Arkadin détruit tout ce qui le rattache à l’humanité. A la fin du film, qu’il se suicide, ou, selon la suggestion de Mathieu Dupré, qu’il « s’évapore dans le ciel », Arkadin n’est plus un homme mais un dieu du Mal. Ce qui explique peut-être l’influence mystérieuse de ce film sur Angel Heart, un film passionnant sur l’incapacité de l’homme à se voir lui-même, et sur l’exécution des anciens amis comme image de la descente en Enfer.
« On ne doit pas scruter les fautes des autres, non plus que les choses par eux faites ou non faites, mais ses propres actes faits et non faits » : cette phrase du Dhammapada (un des plus anciens textes bouddhistes, écrit en pâli au troisième siècle) est bien celle à laquelle les « masques réalisés » cherchent à échapper. Ils cherchent à échapper à leur propre visage, leur propre secret. Ce qui définit le monde moderne, au sens de Shakespeare, Orson Welles ou René Guénon, c’est un monde qui célèbre ce type d’individus. Ce qui définit ce « monde moderne », c’est que Tout, dans ce monde, encourage cette dissolution. C’est la base du libéralisme : la libre concurrence, qui amène inexorablement à cette apocalypse intime, la guerre de chacun contre tous et de tous contre chacun. « La victoire engendre la haine, le vaincu vit dans la souffrance. Le paisible vit heureux, abandonnant victoire et défaite. » dit encore le Dhammapada. Le libéralisme est l’invention diabolique la plus parfaite : un monde qui ne fonctionne plus que sur un système de défaites et de victoires.
C’est Twin Peaks et Chinatown qui permettent de voir Mr. Arkadin comme un film sur le tabou de l’inceste ; mais c’est Angel Heart et Twin Peaks qui nous révèlent ce que Mr. Arkadin raconte également : la découverte, par Guy Von Stratten (et par le spectateur) que le diable est un rôle, une fonction, que celui-ci nous demande toujours d’enquêter sur elle pour mourir et être remplacée par nous. À la fin de Mr. Arkadin, Von Stratten est simplement trop idiot ou pas assez pur pour se rendre compte qu’il n’a pas d’autre choix que de devenir Gregory Arkadin à son tour, ou laisser Raina le devenir. La meilleure ruse du Mal est la provocation au combat. On ne se débarrasse pas du diable en l’anéantissant, mais en anéantissant, en soi, son désir de l’anéantir.