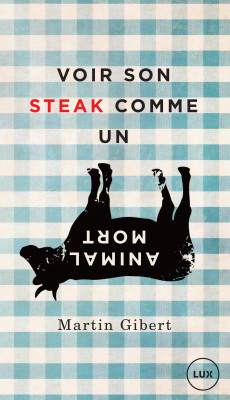
Deuxième partie "mais nous avons besoin de protéines animales "
Être convaincu qu’on a besoin de manger des animaux est évidemment une stratégie d’atténuation de la dissonance cognitive. Elle s’appuie sur le principe « devoir implique pouvoir » : il ne peut exister de devoir d’être végane, si ce devoir est impossible à suivre.
Autrement dit, si c’est dangereux pour la santé, il paraît difficile de faire du végétalisme un devoir moral [1]. Or, en se persuadant qu’on n’a pas le choix, on nie sa liberté d’action – ou on réduit le nombre d’options perçues – et on s’autorise ainsi une forme de désengagement moral.
De façon plus générale, je ne mérite pas d’être blâmé pour les conséquences d’un acte si « ça ne dépend pas de moi ». Le célèbre psychologue américain et père de la théorie du désengagement moral [2], Albert Bandura, voit dans le déplacement ou la diffusion des responsabilités un puissant mécanisme qui opère « en occultant ou en minimisant le rôle de l’agent dans le mal qui a été causé [3] ».
Cette occultation prend plusieurs formes. On peut, par exemple, se dire que la viande qu’on achète provient d’un animal qui est déjà mort ; il n’y a plus rien à faire pour lui ; autant « honorer » son cadavre en le cuisinant correctement.
Du côté des producteurs, on peut invoquer la loi de l’offre et de la demande. On ne vend pas du foie gras, de la fourrure ou des yogourts par sadisme, mais pour répondre aux désirs des consommateurs. Dès lors, si tout le monde est coupable, alors personne ne l’est vraiment. La responsabilité morale est soluble dans la division du travail et l’économie de marché.
C’est aussi ce qu’a pu constater une équipe de chercheurs portugais [4]. Après avoir présenté des arguments contre la diète carnée à des omnivores, ils ont scrupuleusement consigné les contre-arguments qui émanaient de différents focus groups : sur l’environnement, le bien-être animal et la santé publique.
Ils ont ainsi pu repérer différents mécanismes de désengagement moral : reconstruire le comportement problématique (« c’est dans notre nature/culture de manger de la viande »), relativiser les mauvaises conséquences (« il ne faut pas oublier l’envers de la médaille ») ou, encore, le pur et simple évitement (« je préfère ne pas y penser »).
Dans l’étude portugaise, l’occultation de la responsabilité personnelle se manifeste de deux manières : 1) les participants blâment l’élevage industriel, mais pas la consommation de masse ; 2) ils minimisent le rôle des acteurs en renvoyant à d’autres entités : c’est surtout une affaire d’experts (biologistes, vétérinaires, agences gouvernementales) ou bien une question d’ordre juridique qui dépasse les simples citoyens.
Certaines personnes se dédouanent ainsi en suggérant qu’elles boycottent déjà le système. Elles n’achètent pas de viande en supermarché, mais au petit boucher du coin de la rue. L’effet de halo de la viande bio [5] et le charme discret de la « viande heureuse » viennent alors consolider ce qui, la plupart du temps, n’est autre qu’un aveuglement volontaire.
À défaut de boycotter l’élevage industriel, on peut se compter pour quantité négligeable. C’est l’alibi classique du « je ne mange qu’un tout petit peu de viande ». Il s’agit encore une fois de se désengager en modifiant la perception de son propre comportement. Je n’ai pas à changer puisque je l’ai déjà fait ; mes actions coïncident déjà avec mes valeurs. On a ainsi montré que des personnes qui s’apprêtent à voir un reportage sur le traitement des animaux sous-estiment leur consommation de viande [6].
Je me demande aussi parfois si l’ampleur du problème n’entraîne pas une sorte de sidération paralysante : du point de vue utilitariste, par exemple, les 60 milliards d’animaux terrestres et les 1 000 milliards de poissons tués chaque année par l’homme représentent une somme de souffrances inimaginable. Est-il simplement possible de se faire une idée de la quantité de stress, de privation et d’agonie que cela constitue ?
Quatrième partie "mais les vegans sont sectaires"


