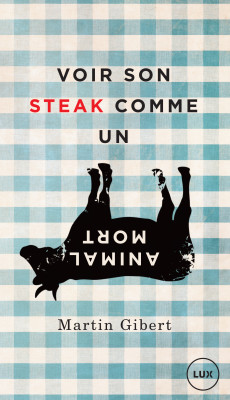
Pour le théoricien Leon Festinger, la première stratégie pour résoudre ou réduire une dissonance cognitive consiste à modifier l’importance d’une cognition conflictuelle. Dans le cas du paradoxe de la viande, cela peut se traduire ainsi : se persuader que les animaux ne sont pas conscients ou, du moins, qu’ils ne sont pas assez conscients pour vraiment souffrir.
Ce déni de la conscience animale est un phénomène très répandu et bien documenté. Pour David Chauvet, il convient même de parler d’une phobie – une « mentaphobie » – « parce qu’on a peur de reconnaître cette conscience, dans la mesure où la reconnaître signifie devenir un criminel en tuant des animaux [1] ». Pourtant, comme la déclaration de Cambridge sur la conscience animale le souligne (voir le chapitre 1), il ne fait aujourd’hui plus aucun doute que les vertébrés ressentent la douleur et éprouvent des émotions.
Les poissons sont probablement les premières victimes de ce déni de conscience. Dans ma transition vers le véganisme, j’ai moi-même eu ma phase « pesco-végétarienne ». Je ne mangeais plus de viande, mais je ne voyais pas de problèmes – sinon environnementaux – avec les poissons. Je n’arrivais tout simplement pas à me représenter la souffrance d’un poisson.
Et, pour dire la vérité, je n’ai pas depuis lors développé d’empathie particulière pour les saumons ou les truites. Mais je me suis renseigné. Comme tous les vertébrés, les poissons ont un système nerveux central (un cerveau) et ils peuvent ressentir la douleur [2]. Or, le nombre de poissons tués chaque année est considérable – bien plus que les 60 milliards d’animaux terrestres envoyés à l’abattoir.
Dans les préoccupations sur le bien-être animal, les poissons sont assurément les grands oubliés. Mais leur mort par asphyxie ou éclatement des organes internes (conséquence d’une décompression rapide lorsqu’on remonte les filets de pêche) est peut-être la plus douloureuse de tous les animaux de consommation. Il n’est pas non plus rare qu’ils soient éviscérés alors qu’ils sont encore vivants. Ne pas consommer de poisson – ni d’animaux terrestres nourris avec des farines de poisson [3] – c’est donc éviter une vaste quantité de souffrance non nécessaire.
On peut, comme en mon temps avec les poissons, contester l’existence même d’une conscience animale ; mais on peut aussi essayer de la minimiser. Steve Loughnan et ses collègues ont mis au point plusieurs expériences astucieuses qui prennent les participants en flagrant délit de « démentalisation ».
Dans une première expérience sur de prétendues « préférences alimentaires », on demande à certains participants de goûter des noix de cajou et à d’autres du bœuf séché [4]. On leur propose ensuite une seconde étude qui n’est pas censée être en lien avec la première. Ils doivent noter leur degré de préoccupation morale pour différents animaux, dont une vache. Comme le prédit la théorie de la dissonance cognitive, les participants qui ont goûté au bœuf séché manifestent globalement moins de considération morale pour les animaux. Et tout particulièrement pour la vache.
Dans une autre expérience, on présente à tous les participants la photo d’un mouton dans un pré. Mais tous ne voient pas la même légende. Certains lisent « Ce mouton va être changé de pré et passer le reste de sa vie avec d’autres moutons », tandis que pour les autres, il est écrit « Ce mouton va être conduit à l’abattoir et sa viande sera bientôt disponible dans un supermarché ». Les participants doivent alors évaluer différentes capacités mentales de l’animal (planifier, souffrir, éprouver de la peur, du plaisir, etc.).
Cette fois encore, les résultats vérifient les prédictions : le mouton destiné au supermarché est perçu comme ayant moins de capacités mentales que son jumeau qui sera simplement changé de pré. Ce phénomène est même accentué lors qu’on annonce aux participants qu’ils vont ensuite goûter de la viande pour un prétendu sondage de consommateurs. Pour les auteurs de l’étude, cela signifie que « le déni d’un esprit facilite des pratiques moralement douteuses, mais appréciées et valorisées culturellement, en alignant des cognitions avec un comportement pour réduire la dissonance [5] ».
De façon plus générale, on constate que les gens attribuent moins de capacités mentales aux animaux qu’ils jugent comestibles comme les vaches ou les chèvres qu’à d’autres espèces comme les chiens, les chats, les lions ou les antilopes [6]. Toutefois, on peut se demander si c’est parce que les gens jugent qu’une espèce souffre moins qu’ils la consomment ou, au contraire, si c’est parce qu’ils la consomment qu’ils jugent qu’elle souffre moins.
Une dernière expérience permet de tirer les choses au clair [7]. On demande à des étudiants américains si les kangourous arboricoles ressentent la douleur et méritent notre considération morale. Il est alors précisé soit que cette espèce exotique est consommée par les habitants de Papouasie–Nouvelle-Guinée, soit qu’elle vit simplement sur ce territoire. Or, quand bien même les participants n’ont jamais mangé de kangourou arboricole, le simple fait de le mettre dans la catégorie « nourriture » les conduit à minorer sa conscience et sa valeur morale.
Bref, on peut atténuer le paradoxe de la viande en « démentalisant » les animaux qu’on consomme. Nous nous persuadons qu’ils ne souffrent pas pour pouvoir les manger sans trop culpabiliser.
[Deuxième partie « …mais nous avons besoin de protéines animales.


