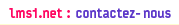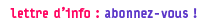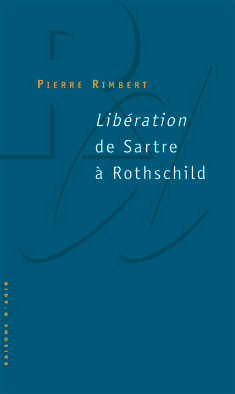
« Mai 68 a remis la révolution et la lutte des classes au centre de toute stratégie. Sans vouloir jouer au prophète, l’horizon 70 ou 72 de la France, c’est la révolution. » (Serge July, 1969)
« La vraie subversion, aujourd’hui, c’est l’information.
C’est la seule idéologie qui m’intéresse désormais. » (Serge July, 1981)
« La rupture, c’est de s’affirmer libéral au sens du XVIII e siècle. » (Serge July, 1986)
« Moi, je suis pour une économie libérale.
Moi, je suis effectivement pour la concurrence. » (Serge July, 2002)
« Tout m’a profité. » (Serge July, 1985) [2]
Lorsqu’il prit sa retraite en avril 1907, Joseph Pulitzer, fondateur du Saint Louis Post-Dispatch (Missouri), consigna les « principes fondamentaux » que ses successeurs devraient observer pour maintenir le quotidien au rang de référence américaine. Ce journal « ne cessera de lutter contre les classes privilégiées et les profiteurs, ne se détournera jamais du sort des pauvres, restera toujours dévoué au bien public » [3]. À l’époque, des résistances au capitalisme se multipliaient dans le monde occidental : conseils ouvriers en Russie, Industrial Workers of the World aux États-Unis, CGT en France. Elles visaient l’abolition du salariat.
Une gauche qui voulait changer le monde, des journaux soucieux de justice sociale : l’attelage n’aura pas résisté aux bourrasques politiques, économiques et intellectuelles de ces trente dernières années. Quand elle accède au pouvoir, la gauche administre l’ordre des choses ; quand elle prend position, la presse justifie le monde tel qu’il va.
Fondé en 1973 pour « donner la parole au peuple » et finalement revendu par tranches à Édouard de Rothschild, Libération constitue un bon révélateur français de ces bouleversements. Au départ, un projet éditorial contestataire déclare la guerre à la grande presse. « Libération luttera contre le journalisme couché », promet son manifeste en novembre 1972 ; Jean-Paul Sartre, premier directeur du journal, formule l’exigence imposée par un tel objectif : « nous avons refusé de devenir une entreprise industrielle et commerciale » [4]. À l’arrivée, Libération se présente comme une société anonyme dont le conseil d’administration réunit en 2005 un banquier d’affaires, un ancien directeur financier de Vivendi, l’ex-directeur général du Forum économique mondial de Davos et une directrice générale adjointe de Suez qui fut aussi l’attachée de presse d’Édouard Balladur... « Je crois que c’est un peu une vue utopique de vouloir différencier rédaction et actionnaire », a expliqué Édouard de Rothschild (France 2, 30.9.2005).
À parcourir les pages sans sève de ce quotidien bousculé par les journaux gratuits, on imagine mal le rôle idéologique que joua Libération dans les années 1980. Il procura à la bourgeoisie culturelle française ce que Commentary proposait aux néo-conservateurs américains : un salon d’essayage de la pensée de marché que le gouvernement socialiste revêtit à partir de 1983-1984. Car la « “grandeur” de Mitterrand », estima peu après Serge July, fut de « réussir à aligner la démocratie hexagonale sur le modèle anglo-saxon et de soumettre l’économie nationale à toutes les contraintes du marché mondial » [5].
La volte-face d’un contestataire peut paraître banale. En Italie, Marco Panella, ancien dirigeant d’un parti internationaliste et libertaire, se rallia à Silvio Berlusconi ; Christopher Hitchens, l’une des plumes de la gauche radicale américaine, opéra à partir de la guerre du Kosovo un virage qui devait le conduire à appuyer George W. Bush dans le Wall Street Journal ; au Brésil, Fernando Henrique Cardoso, théoricien du combat anti-impérialiste et de l’autonomie économique des pays du tiers-monde, se changea en tribun du développement par le libre-échange avant de camper un président libéral. À ces basculements individuels, Libération oppose en France l’exemple d’une normalisation collective. Auberge des luttes sociales de l’après-Mai 68, il devient en 1981 l’expression organique d’un embourgeoisement, le journal-mouvement du conservatisme branché. Journalistes et lecteurs avançaient d’un même pas sur le chemin du vieillissement social. Leurs intérêts matériels les portaient au conformisme économique ; leurs goûts culturels vers l’excentricité. Libération offrait à ce public un sas d’acclimatation idéologique d’autant plus efficace que les conversions s’y déroulaient à l’abri d’un rideau d’audaces artistiques et de « transgressions » sexuelles éventées. En 1986, Guy Hocquenghem décrivait le procédé habituel des fausses avant-gardes : « L’essentiel, c’est d’être juste ce qu’il faut en retard, pour coïncider avec la réaction générale. » [6]
Bien sûr, Libération ne fut pas l’unique metteur en scène du grand retournement. Tout prévenu qu’on soit de la responsabilité des médias dans l’imposition du credo néo-libéral, on reste interdit devant le spectacle que livrent les archives de presse du premier septennat de François Mitterrand [7]. Ici, des chefs d’entreprise, essayistes et éditorialistes paradent sur les plateaux de télévision pour enjoindre leurs concitoyens à « s’adapter » au nouvel ordre économique ; là, des publications « de gauche » comme Le Nouvel Observateur, Globe ou L’Événement du jeudi dépoussièrent les équations d’une « modernité » vieille d’un demi-siècle : libre-échange = réalisme, syndicalisme = archaïsme, propriété collective = faillite. Comme il y eut un réalisme socialiste, c’est le printemps du réalisme libéral. Il exalte la figure du patron, célèbre le culte de l’entreprise, chante la réussite individuelle - et blâme l’ouvrier « replié sur ses acquis ».
Mais l’accomplissement du vœu de Serge July - « faire de “Vive la crise !” un mot d’ordre populaire » [8] - exigeait que ces vieilles lunes fussent rapiécées aux couleurs futuristes du « progrès ». L’avenir radieux serait informatique, globalisé, en réseau.
Ces années changèrent aussi la presse. À mesure qu’ils étendaient leur périmètre économique, les groupes de communication enfantés par la libéralisation de l’audiovisuel renforçaient leur contrôle sur la représentation du jeu politique. À tel point que les partis ont cessé de réagir quand la concentration des moyens d’information menace d’imprimer sa marque mercantile à l’ensemble de la société. Entre le printemps 2004 et l’été 2005, les trois principaux quotidiens français ont bouleversé leur actionnariat dans une relative indifférence : Le Figaro racheté par Dassault, Libération recapitalisé par Rothschild, Le Monde renfloué par Lagardère.
Libération fut alternativement le sismographe et l’aiguillon de ces métamorphoses.