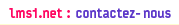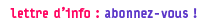1. Pourquoi France Culture ? Pour permettre à un philosophe de témoigner de son dégoût pour la sociologie
Dans l’émission L’Esprit Public de Philippe Meyer (sociologue de formation…) , le 21 octobre 2007, on a pu entendre un philosophe recommander en ces termes, le livre de Nathalie Heinich intitulé Pourquoi Bourdieu ? [1] :
« Moi, je recommande un livre de la sociologue Nathalie Heinich qui vient de publier chez Gallimard dans la collection “Le Débat” un livre d’évaluation, de réévaluation - et en même temps c’est un peu d’autobiographie – sur Pierre Bourdieu : “Pourquoi Bourdieu ?”. Et effectivement, comment se fait-il que Bourdieu soit devenu à ce point le sociologue français mondial, universel, alors que finalement il était - sa pensée était – probablement beaucoup moins importante qu’il le pensait et que beaucoup le pensaient ? Que ses concepts étaient extrêmement vagues, c’est peut-être pour ça d’ailleurs qu’ils s‘appliquaient à peu près à tout et n’importe quoi ? Domination, distinction, habitus, violence symbolique, champ – la notion de champ, hein ? C’était tellement vague que… Comment se fait-il que des gens aient été séduits par Bourdieu au point de devenir quasiment des membres d’une secte ? Et comment se fait-il aussi qu’il y ait eu ce succès quasiment universel de ce dénonciateur des oppressions ? C’est un livre qui est très attachant, parce que je dirais qu’il y a à la fois l’analyse intellectuelle et la bonne distance personnelle de quelqu’un qui a su prendre ses distances d’avec Bourdieu. Mais, effectivement, la question qui se pose quand même, cette fois sans le point d’interrogation, c’est vraiment “ Pourquoi Bourdieu”.
Du livre ainsi promu avec un tel enthousiasme, nous ne dirons rien sur le fond, l’œuvre de Bourdieu se défendant très bien elle-même, du moins pour ceux qui se donnent la peine de la lire. Nous dirons seulement ceci : c’est un pamphlet, travesti en enquête sociologique, rehaussé de psychanalyse sauvage, pimenté d’anecdotes pseudo-biographiques (dont on pourra lire un usage dans l’annexe de cet article). Mais ce n’est pas un livre qui cherche ouvertement à faire passer la sociologie de Pierre Bourdieu comme une pure et simple imposture. Comme quoi le commentaire élogieux d’un livre sur France Culture peut être pire que celui-ci !
Ainsi, un philosophe hexagonal découvre que la réception internationale de l’œuvre de Bourdieu est moins méritée que celle d’Harry Potter ! Yves Michaud, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’est pas seulement l’auteur injustement méconnu de livres impérissables sur la violence, la politique, la peinture et sur ce qu’il appelle « la crise de l’art contemporain ». Il est aussi directeur de « L’Université de Tous les Savoirs » et l’un des invités inamovibles de L’Esprit public. Il montre au moins que, manifestement, il ne suffit pas d’être le directeur de « l’Université de Tous les Savoirs » pour tout savoir soi-même et que ce titre ne protège pas de l’enflure et du ridicule. Mais peut-être est-ce trop de demander à certains de ceux qui, à l’instar d’Yves Michaud, ont le privilège de disposer chaque semaine du micro de France Culture de ne pas confondre la critique toujours souhaitable d’une œuvre avec une exécution sommaire ?
2. Pourquoi France Culture ? Pour permettre à Alain Finkielkraut de ressasser ses obsessions.
Le 3 novembre, c’est au tour d’Alain Finkielkraut d’honorer le livre de Nathalie Heinich, d’un débat, mais de l’un de ces débats dont Alain Finkielkraut a le secret : des débats qui ne sont qu’autant d’occasions, pour le producteur de « Répliques » de ressasser ses thèmes et ses phobies, de concert avec ses interlocuteurs quand leurs avis convergent, en présence d’un contradicteur-prétexte quand les positions divergent. Bref, des « Répliques à moi-même » [2].
Cette fois, pour parler de « La pensée de Pierre Bourdieu », qu’il ne cesse de pourfendre d’émission en émission [3], Alain Finkielkraut avait réuni autour de lui, non seulement Nathalie Heinich, mais également Gérard Mauger, auteur d’un livre d’hommages à Pierre Bourdieu, dont il ne fut question que pour en citer le titre… à la fin de l’émission. C’est donc autour du livre de Nathalie Heinich et des ruminations d’Alain Finkielkraut que tourna le « débat ». Très équilibré, comme toujours, comme le montre le comptage des temps de parole : sur 50 minutes 47,
– Finkielkraut a pris la parole durant 19 minutes 32 secondes
– Heinich pendant 17 minutes 41 secondes
– Mauger pendant 13 minutes 47 secondes
Soit :
– pour Finkielkraut : 38,5% du temps de parole
– pour Heinich : 34,8%
– pour Mauger : 26,7%.
Autrement dit, les critiques de Pierre Bourdieu ont occupé près des trois quarts du temps de parole (73,3%)…
Encore ces chiffres n’illustrent-ils que partiellement ce que sont de tels simulacres de débat auxquels les contradicteurs sont convoqués à comparaître par un producteur-animateur qui se réserve le premier et le dernier mot non seulement dans une émission, mais dans nombre de celles qui la précèdent et qui lui succèdent. De quoi réfléchir sérieusement avant d’accepter l’interrogatoire, voire le guet-apens. Refuser une invitation « à débattre » dans de telles conditions peut être une forme d’exigence pour que s’instaurent de vraies discussions.
Trois quarts du temps de parole. Mais pour dire quoi ? Que l’Ecole sociologique animée par Pierre Bourdieu était une secte, que le sociologue et ses œuvres étaient violents (tandis que Finkielkraut est d’une délicate douceur…), qu’il était animé d’un fort ressentiment contre la culture et que son succès s’explique par la passion égalitaire et la radicalité.
3. Pourquoi France Culture ? Pour permettre à un producteur-animateur de présider un procès sans défenseurs.
Entre temps, le jeudi 1er novembre 2007, l’émission « Du grain à moudre » offrait une nouvelle tribune aux adversaires de Pierre Bourdieu sous le titre « Reste-t-il une sociologie en France après Bourdieu ? ». Si Alain Finkielkraut avait eu la décence d’inviter un contradicteur, Brice Couturier et Tara Schlegel s’en sont carrément passés. Ce n’est pas la première fois (et sans doute pas la dernière) que les responsables de cette émission usent et abusent de leur position pour agir non en médiateurs du débat public, mais en polémistes à sens unique [4].
Invités : Nathalie Heinich (au titre de la dissidence), Pierre Demeulenaere (en qualité de disciple de Boudon) et Michel Wieviorka (en qualité de disciple de Touraine).
Il est pour le moins étrange que pour parler de la sociologie en France « après Bourdieu » aucun de ceux qui ont travaillé avec lui et/ou dans le sillage de son œuvre et continuent de s’en inspirer aujourd’hui n’ait été invité. Cela signifie-t-il que la sociologie de Bourdieu est déjà dépassée et qu’il n’existe plus de sociologue « bourdieusien » ? Ou alors, s’agissait-il seulement de donner la parole à d’autres courants sociologiques pour qu’ils fassent le point sur leurs propres travaux ? Rien de tel ! Il s’agissait simplement de permettre aux sociologues invités de dire tout le mal qu’ils pensent de l’œuvre de Pierre Bourdieu, de son auteur et de ceux qui, très nombreux, appartiennent, directement ou pas, à son école (en les traitant en simples « épigones », comme les compères réunis autour du micro ne cesseront de le dire). Bref : une émission de règlement de comptes, affranchie des règles les plus élémentaires de la discussion rationnelle.
On apprit ainsi de Nathalie Heinich (soutenue par Michel Wieviorka, dans le rôle de la victime) que Bourdieu était le chef charismatique et paranoïaque d’une secte, qu’il était inutile de lire ses livres pour en parler (Pierre Demeulenaere), que ses engagements étaient équivoques, voire délirants, et que, somme toute, il n’y avait rien à en dire !
Passe encore que les invités, certains de n’être pas contredits, disent ce qu’ils veulent et, en l’espèce, n’importe quoi. Mais que les producteurs-animateurs d’une émission de France Culture renchérissent sur les propos de leurs interlocuteurs et s’ingénient à disqualifier la sociologie et les engagements d’un sociologue dont ils ne connaissent manifestement l’œuvre qu’à travers le filtre des vulgates médiatiques [[Cf., dans le même sens : « L’œuvre de Pierre Bourdieu et l’écran médiatique »] invite à s’interroger : au nom de qui et de quoi des producteurs-animateurs s’arrogent-ils le droit d’instruire systématiquement à charge, avant de se comporter en procureurs dans un procès sans défenseurs ? Au nom de la culture ? Vraiment ?
Pourquoi France Culture, somme toute ? Pour permettre à des médiateurs culturels de faciliter l’accès aux œuvres (comme il arrive que certaines émissions de qualité le fassent encore) ou pour permettre à de médiocres pamphlétaires de confisquer les débats qu’ils prétendent animer ?