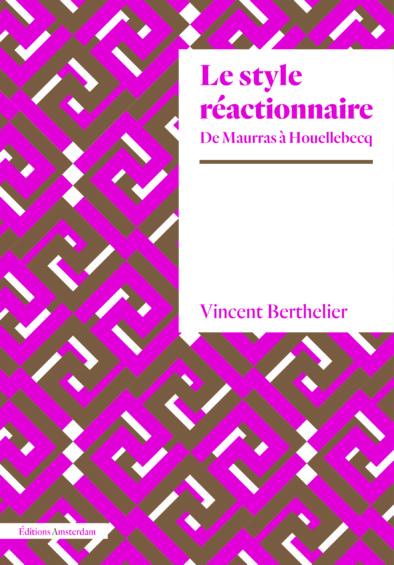
Céline représenterait, selon l’expression de Philippe Roussin, un « purisme populiste », certes opposé en tout point au purisme des chroniques de bon langage, mais aussi normatif dans sa conviction que l’écrit doit s’efforcer de transcrire l’expressivité de la langue parlée. Le chambardement stylistique qu’il inaugure (dont on trouve cependant des prodromes chez Zola, Ramuz, etc.) doit donc être envisagé par rapport à ce qu’il exclut et pas seulement par rapport à ce qu’il invente. Anti-intellectualiste et anti-élitiste malgré son caractère « savant », le style de Céline prétend s’appuyer sur la langue d’un peuple, entendu au sens national et racial, et rejoint ainsi les tendances contestataires et anti-bourgeoises de la « droite révolutionnaire » et du fascisme (tendances qui par ailleurs ne résistent guère à l’épreuve du pouvoir).
Les choses changent après l’Épuration : Céline se met à affirmer que ses ennuis (l’emprisonnement au Danemark, l’exil, l’exclusion du monde littéraire parisien) sont moins dus à ses idées antisémites et fascistes qu’à son esthétique. On lui reproche en fait, sans le dire ouvertement, le Voyage au bout de la nuit et la radicale nouveauté de son style :
« Mes idées racistes sont pour rien ! […] c’est le Voyage qui m’a fait tout le tort… mes pires haineux acharnés sont venus du Voyage… Personne m’a pardonné le Voyage… depuis le Voyage mon compte est bon !… »
Cette idée est relayée par une partie de ses lecteurs et commentateurs (Henri Godard, Régis Tettamanzi), y compris à gauche, comme le montre l’enquête du Libertaire de janvier 1950, lancée par le lettriste (juif) Maurice Lemaître – sans parler de la lecture de Philippe Sollers. L’hostilité à Céline devient donc simple affaire de jalousie, d’incompréhension face à l’audace et à la nouveauté.
Dans les Entretiens avec le professeur Y (1955), c’est toute la vision du monde (si capitale dans l’hommage à Zola de 1933) qui passe derrière le style, seul vecteur du « rendu émotif ». On a vu quelle était la fonction que Céline conférait à l’émotion quand il écrivait les Bagatelles pour un massacre ; dans les Entretiens, la volonté de provoquer un sursaut chez les « indigènes » n’est bien sûr plus explicitée. Les entretiens accordés à Louis Pauwels vont dans le même sens : chez les écrivains, ce n’est pas l’histoire qui importe (« tout le monde a une histoire »), mais le style. Certes, Céline n’a jamais produit de roman à intrigue ; il n’empêche que ce virage vers l’esthétique pure est une mystification. D’un château l’autre (1957), Féerie pour une autre fois (1952) ou Rigodon (écrit entre 1960 et 1961) sont des livres largement politiques, dirigés contre des ennemis (« Tartre », « Triolette », « Larengon », etc.), et réhabilitant, sur le mode bouffon, la France vichyste et l’auteur lui-même.
L’opposition entre le style et les idées fait, selon Nelly Wolf, partie de la stratégie de réhabilitation entreprise par Céline après -guerre. Le style, comme catégorie purement esthétique et apolitique, est mis en avant pour sauver ce qui peut l’être : non pas l’homme et ses idées, mais l’artiste et ses inventions littéraires et formelles. Cette stratégie de substitution du style aux idées n’est d’ailleurs pas propre à Céline, comme j’aurai l’occasion de le redire.
Philippe Roussin livre de cette évolution une interprétation légèrement différente, mais complémentaire. Si, après 1945, Céline ne peut plus garder publiquement ses cibles juives, il continue néanmoins d’exprimer sa xénophobie sur le terrain linguistique. La défense de la langue française (orale et authentique) remplace la défense de la race française. Son virage esthète, incarné en premier lieu par les Entretiens avec le professeur Y, lui laisse d’ailleurs le champ d’émettre, en privé, quelques opinions sur la race française, comme dans une lettre à Paulhan du 27 février 1949, où il affirme que
« Proust, s’il n’avait pas été juif, personne n’en parlerait plus ! Il n’écrit pas en français mais en franco-yiddich tarabiscoté absolument hors de toute tradition française ».
En somme, le fascisme et le racisme de Céline sont chevillés à son discours sur la langue et le style, et ce discours accompagne une pratique littéraire (celle du « roman parlant », pour reprendre l’expression de Jérôme Meizoz). Mais il faudrait opérer un saut théorique supplémentaire pour considérer que les choix stylistiques céliniens sont en eux-mêmes fascistes. Je me contenterai de renvoyer aux tentatives faites en ce sens par Hélène Merlin-Kajman. Quoi qu’il en soit, Céline offre l’exemple d’un écrivain qui, d’une part, tâche par son discours métalittéraire de faire concorder son travail stylistique et ses positions politiques, et dont, d’autre part, les positions sont distinctes de celles de la droite réactionnaire. Il est politiquement proche de Darquier de Pellepoix (antisémite germanophile apprécié par l’équipe de Je suis partout, mais pas par l’Action française) et d’autres officines de propagande antisémite, avant d’exprimer sous l’Occupation sa sympathie pour Jacques Doriot. Antidémocrate anarchisant, anticommuniste qui revendique des origines prolétariennes, raciste biologique, pacifiste hitlérien, Céline est bel et bien un représentant du fascisme français, fascisme qui s’accorde avec son avant-gardisme, son anticlassicisme et son anti-purisme.
Quoique issue d’un processus littéraire collectif, la démarche stylistique de Céline tend à lui être exclusivement et mythiquement attribuée ; parallèlement, à partir du cas Céline, on associe l’innovation et la transgression stylistiques à l’extrême droite ou au fascisme littéraires. Il reste donc à savoir si cette corrélation est fondée, et si cette configuration se retrouve chez les autres écrivains de tendance fasciste.
(…)
Le projet stylistique célinien fait figure d’exception. Entretenant à dessein la confusion entre peuple-classe et peuple-race, il essaie de créer la langue littéraire correspondant à une communauté nationale et raciale, une langue de masse adaptée au fascisme comme mouvement de masse. Brasillach, Rebatet, Drieu ou Montherlant n’envisagent le problème des masses que de loin, de manière idéalisée, et sans parvenir à l’articuler à leur production littéraire. D’origine bourgeoise, ils héritent d’une culture classique et savante. Et même s’ils se réfèrent à Péguy et à un Moyen Âge chrétien fantasmatique, plus qu’à l’idéal versaillais de Maurras, même s’ils se sentent plus nordiques que méridionaux, tous sont largement tributaires de l’Action française.
Walter Benjamin s’est retrouvé face à un problème analogue. Tout en ayant l’intuition qu’un trait essentiel du fascisme se joue sur le plan de la modernité esthétique (décadentisme, futurisme, expressionnisme, etc.), il explique dans un texte de 1930, « Théories du fascisme allemand », que, formellement, la littérature fasciste ne se distingue pas de la production journalistique, voire publicitaire de son temps. Sous leur idéalisme guerrier anachronique, les fascistes se vendent en fait comme mercenaires à la bourgeoisie – qui doute de la capacité de l’État à protéger ses propriétés. C’est cette orientation actuelle et mercantile qui détermine chez eux un style lisse (« Glätte der Fügung »), « qui ferait honneur à n’importe quel éditorial ». Voilà qui répond par avance à Thibaudet, interrogeant la possibilité d’un fascisme écrit qui serait « un tumulte littéraire autonome, à discipline et à tension ».
Hormis Céline, l’avant-garde fasciste française reste introuvable. Le point de vue modeste du stylisticien constate que la continuité (âprement débattue parmi les historiens) entre réactionnaires et fascistes vaut pour la plupart des écrivains. Si tous ont été marqués par Céline, celui-ci ne peut en aucun cas être pris comme archétype de l’écrivain fasciste, et constitue bien plutôt l’exception que la règle. Le style des fascistes français est aussi peu prolétarien que le fascisme est anticapitaliste, et leurs aspirations révolutionnaires ne se sont pas traduites par une révolution des formes. La transition du journalisme pamphlétaire à l’écriture pour la postérité -s’accompagne bien plus volontiers d’un retour à l’ordre littéraire.


