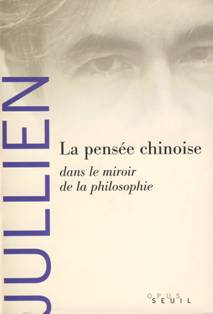
Le temps qui passe, les temps anciens, le temps qu’il fait, les trois temps de la valse, autant d’emplois du mot « temps » que nous distinguons fort bien et nous savons pertinemment qu’il n’existe aucun concept nommé « temps » qui recouvrerait intégralement ces différents emplois. Nous le savons tellement bien que si nous devions traduire chacune de ces expressions dans une langue étrangère, il est probable que nous commencerions par vérifier quel est dans cette langue le mot qui correspond à tel emploi et que nous traduirions chacun de ces temps par un mot différent.
Imaginons maintenant que par le plus grand des arbitraires nous choisissions de traduire systématiquement temps par un même mot. Il y a peu de chance pour que l’étendue des emplois de ce mot recouvre parfaitement celle qu’il a en français. On peut imaginer le désarroi du lecteur, ignorant du français, et les difficultés qu’il aurait à ce faire une idée claire du temps français. Il pourrait en déduire qu’il y a une « pensée française » dans laquelle il existe un concept « temps » qui s’appliquerait indistinctement à des domaines que pour sa part il distingue : la durée, la météorologie, l’histoire, la musique. Il pourrait conclure à l’absence de distinction entre ces domaines dans une « Pensée Française » qui leur appliquerait les mêmes concepts.
Que nous utilisions le même mot pour désigner des réalités différentes et que ce mot puisse par ailleurs recouvrir des concepts ne signifie aucunement que nous n’opérons aucune distinction entre ces réalités, pas plus que cela ne signifie que nous étendions ce concept à l’ensemble de ces réalités. L’exemple peut paraître volontairement outrancier, et il l’est sans doute, mais c’est pourtant ainsi que se construit l’altérité : en posant comme faits de nature ce qui est faits de langage. L’altérité est le caractère de ce qui est autre, de celui qui nous est entièrement différent. C’est selon les cas l’oriental, l’arabe, l’africain, l’asiatique. Cet « autre » ne pense pas comme « nous ». Les concepts qui me sont familiers lui sont étrangers et je ne peux accéder à ceux qu’il utilise couramment. Cet autre donc pense différemment de moi dans des catégories qui me sont étrangères et avec des concepts dont la compréhension m’est refusée.
Pourtant cette fameuse altérité n’est dans la plupart des cas qu’une construction qui repose pour l’essentiel sur des jeux de langage. Elle se base sur la croyance assez naïve que nous avons que les mots désigneraient inévitablement et invariablement des choses et des réalités.
Prenons l’exemple du chinois et du Tao. Je peux considérer qu’il s’agit d’un mot d’emploi fréquent dans des textes et des énoncés de natures diverses, et partant de ce constat chercher à comprendre les sens qu’il recouvre dans ces différents énoncés. La méthode sera alors essentiellement négative, en éliminant les sens qu’il ne peut pas avoir dans un énoncé donné. Je m’appuierais pour cela sur une évidence et une conviction :
– l’évidence, qui devrait apparaître à chacun, est qu’il n’y a aucune raison pour que le chinois et le français ne soit pas également polysémiques : il serait donc étonnant qu’un mot ai dans l’une ou l’autre langue invariablement le même sens dans tous les énoncés où il apparaît ; en retour, je ne vois pas non plus de raison pour qu’il existe en français un mot dont l’étendue des sens qu’il pourra prendre se superpose exactement avec celle des sens d’un mot chinois ;
– la conviction est que l’exigence de sens n’est pas moindre pour un chinois, de quelque époque qu’il soit, que pour un lecteur français, et qu’il n’est pas d’énoncé ayant un sens en une langue qui ne puisse être traduit par un énoncé ayant un sens équivalent en une autre langue ; le travail du traducteur consiste alors à chercher le mot qui en français fait sens de la même manière, et il est certain que ce ne peut être une traduction littérale.
Je peux également considérer que le Tao est plus qu’un mot, que c’est une notion, un concept, qui n’appartient qu’à la « pensée chinoise ». Je peux prendre le parti, adopté par bon nombre de sinologues, de traduire par Voie, ou bien, ce qui revient au même, ne pas traduire et laisser dans le texte français la transcription du mot : le Tao. Je pourrais alors gloser sans fin sur la difficulté à approcher cette « pensée chinoise », et sur l’impossibilité qu’il y a trouver dans la « pensée occidentale » une notion équivalente à celle du Tao. Je ne m’attarderais pas sur la portée opératoire de cet étrange concept qui, selon un « on ne peut nommer », s’applique aussi bien au gouvernement des hommes, à la natation, à la découpe des bœufs, qu’au mouvements des astres et qui selon un autre permet de dormir paisiblement « si on a pu l’entrevoir au cours de la journée ». Je doute simplement qu’il puisse servir à qui que ce soit pour penser quoi que ce soit. Il est en tout cas fort utile pour construire cette fameuse altérité chinoise.
Serais-je en train de dire que les penseurs chinois n’ont pas eu sur la nature, le politique, le pouvoir, les relations entre les hommes et que sais-je encore des idées autres que les miennes, qu’ils ne les ont pas pensé différemment ? Serais-je en train d’affirmer contre l’évidence qu’il n’y a pas en Chine de grandes notions totalisantes dont le Tao serait un exemple ?
Certes non ! Mais n’avons-nous pas, « nous » aussi, un certain nombre de grands Tout tel que la Nature, la Réalité, l’Idée, dont nous serions bien en peine de donner une définition générale qui engloberait leur totalité – et qui ne prennent donc sens que dans des contextes et des textes ? Ne suis-je pas capable de discerner des différences entre l’idée de nature chez Pythagore ou Platon, chez Lucrèce ou Pline, chez Spinoza et Pascal ? Je perçois parfaitement en les lisant que, bien qu’ils utilisent le même mot, le concept de nature n’a pas la même étendue chez l’un et chez l’autre, de même que je ne m’attends nullement à ce que ce mot ait strictement le même sens pour un biologiste que pour un anthropologue. Pourquoi donc, pour peu qu’on me le donne à lire dans une langue intelligible, serais-je face à un auteur chinois soudainement incapable de saisir que là, il ne pense pas tout à fait comme moi ? Ce n’est qu’au prix de cette intelligibilité du texte que je pourrai comprendre en quoi les penseurs chinois ont pensé différemment.
La compréhension d’une pensée dépend peut-être autant de celle de ses enjeux que de celle de ses « théories ». Il n’existe pas de pensée qui ne soit pensée de quelque chose, et ce quelque chose est par définition accessible à l’esprit humain. Comprendre ce qui est pensé, c’est autant comprendre comment il l’est que pourquoi il l’est de la sorte. Pour que l’on puisse y trouver un intérêt qui dépasse la simple érudition, il faut également que l’on puisse en dégager une portée suffisamment générale pour qu’à partir du commun, nous puissions reconnaître du différent :
– je doute par exemple qu’ils soient aujourd’hui nombreux, ceux qui ne trouvent pas abscons les âpres débats théologiques sur la consubstantialité qui agitèrent les débuts de la chrétienté, et cela même en les restituant dans le contexte des rapports entre une église naissante et le pouvoir impérial : c’est qu’en dehors du domaine particulier de la théologie, il est difficile d’extraire de ces débats et des doctrines qui s’affrontèrent une portée générale qui nous concerneraient encore ;
– réciproquement, si nous lisons encore les Provinciales, c’est peut-être pour les qualités littéraires de Pascal, mais c’est plus sûrement parce qu’au delà de la grâce – fût-elle « efficace »ou « suffisante » – à laquelle pour ma part j’avoue ne pas comprendre grand chose, nous pouvons y trouver une réflexion de portée générale sur des sujets qui nous parlent encore tels que le libre arbitre et la détermination – et au delà : la morale, dans le débat qui oppose Pascal aux Jésuites, et par-delà, à l’absolutisme royal.
Il en va de même pour la Chine : si elle peut nous parler, ce n’est pas au nom d’une altérité qui ne nous renvoie jamais qu’à nous même, mais parce nous pouvons trouver, dans les enjeux de la pensée des Chinois, suffisamment de commun et de général pour qu’à partir de lui nous puissions appréhender le différent. Et il est de la responsabilité des sinologues de rendre accessible ce général et ce commun.


