Naguère professeur de philosophie à la Sorbonne, et auteur de livres à succès, André Comte-Sponville a publié en 1998, avec Luc Ferry, un essai intitulé La sagesse des modernes. En feuilletant la section « politique » de ce livre, on tombe sur un chapitre de trois pages signé Comte-Sponville et intitulé « Comment lutter contre le Front National », dont la lecture laisse perplexe. On y lit que « le philosophe » ne doit pas être « engagé » politiquement, puisqu’il s’occupe de « la vérité », qui « n’est ni de droite ni de gauche », puis on tombe sur une analyse politique qui, elle, engage son auteur, et sur un drôle de bord.
On trouve en effet dans ces trois pages une bonne part des lieux communs de la rhétorique réactionnaire :
– un dualisme extrêmement manichéen (et à vrai dire glaçant) entre la politique, qui serait l’affaire de l’État (sic), et la morale qui serait, elle, l’affaire des individus ;
– le renvoi dos à dos des « extrêmes », sous la bannière du « ni-ni » (« ni la générosité ni la technique ne font une politique ») ;
– l’invocation de l’« évidence », qu’il faudrait avoir le « courage » de « rappeler » (plutôt qu’un appel à des solutions politiques singulières et complexes, qu’il faudrait chercher, construire, inventer) ;
– la critique des « donneurs de leçons » (mais que fait-il, pourtant ?) et la haine du « politiquement correct » (une véritable obsession : l’expression revient trois fois en trois pages, sans qu’on sache jamais de quoi exactement il s’agit) ;
– l’anti-intellectualisme (le texte ironise sur l’indignation « médiatique » de « nos intellectuels », et s’en prend à « la bonne conscience satisfaite qui rend insupportable tant d’intellectuels de gauche », sans toutefois préciser qui sont ces si nombreux « insupportables ») ;
– l’invocation misérabiliste et paternaliste du « peuple français », de sa « détresse », de ses souffrances et de ses « peurs », dont il serait urgent de « s’occuper » ;
Une telle concentration de poncifs exclut l’hypothèse du simple dérapage. Il faut se rendre à l’évidence : ce texte a une cohérence, et tous ces thèmes convergent vers une proposition politique extrêmement claire, présentée comme audacieuse, iconoclaste, « politiquement incorrecte », et pourtant conforme en tous points à ce que la pensée dominante a produit de pire en matière de « lutte contre l’extrême droite » : après les désolants et contre-productifs « Il ne faut pas laisser au Front National le monopole de la nation », « de la fermeté », « de la sécurité » et « des questions d’immigration et d’identité », voici carrément : « Il ne faut pas laisser au Front National le monopole de la préférence nationale ».
J’exagère ? Jugeons sur pièces. C’est extrait de La sagesse des modernes, page 471 :
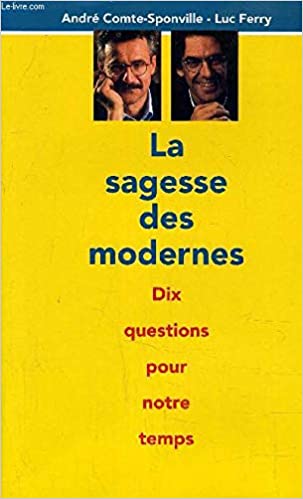
« Imaginez que Jospin ou Séguin, lors de la prochaine campagne électorale, utilisent cette expression : Les Français d’abord. J’imagine la levée de boucliers, surtout à gauche, les protestations indignées de nos intellectuels, l’effervescence des médias, la dénonciation presque partout de la "lepénisation des esprits", enfin le scandale et la honte. Voilà Jospin et Séguin déshonorés, fascisés (...) à ceci près, c’est où je voulais en venir, qu’ils n’auraient pourtant rien fait d’autre qu’énoncer l’évidence de la politique, qui n’est pas de servir indifféremment les intérêts de tout homme (cela c’est la tâche de la morale, non de la politique, de chacun d’entre nous, et non de l’État), mais bien de servir ceux, d’abord, de tel ou tel pays, de tel ou tel peuple. Hobbes, Spinoza et Rousseau n’ont jamais écrit autre chose. Les gouvernements n’ont jamais fait autre chose. Que serait un politique américaine qui ne privilégierait pas l’intérêt des américaines ? Une politique européenne si elle ne considère pas les intérêts des Européens comme une priorité ? Une politique française, si elle ne défend pas, d’abord, les intérêts des Français ? Et faut-il être fasciste pour défendre l’intérêt national ?
Dire "les Français d’abord" n’est pas proférer une monstruosité, ni afficher je ne sais quelle complaisance pour l’extrême droite : c’est énoncer une banalité, une évidence, mais qu’il pourrait être nécessaire parfois - et spécialement contre le Front National- de rappeler. Nos politiques, pourtant, ne l’osent plus guère : comme Le Pen le dit aussi, on n’a plus le droit de le dire... Le politiquement correct veille, et nous endort. Pourquoi est-ce grave ? Parce que Le Pen apparaît dès lors comme le seul à défendre les intérêts des Français (...) ou le seul à en faire une priorité, ce qui est le plus grand service qu’on peut lui rendre. »
Le meilleur service à rendre à Le Pen, ne serait-ce pas plutôt ce type d’écrits, élevant au rang d’« évidence de la politique » le principe lepéniste de la « préférence nationale », c’est-à-dire de la discrimination, dans l’accès au travail ou aux droits sociaux, au profit des nationaux et au détriment des résidents étrangers ? N’est-ce pas offrir à la xénophobie une légitimation inespérée que de lui apporter des cautions philosophiques aussi prestigieuses que celles de Spinoza, Hobbes et Rousseau – qui, en réalité, quoi qu’en dise Monsieur Comte-Sponville, ont assez souvent écrit « autre chose » que ces insanités ?
Ces auteurs ont même toujours écrit tout autre chose. Ils sont considérés comme les fondateurs de la philosophie moderne du Droit, principalement parce qu’ils ont démontré la nécessité de la loi, c’est-à-dire d’une règle s’appliquant à tous sur un territoire donné (un pays), en s’éloignant donc d’autres modèles théoriques comme le modèle pastoral qui fait du Politique un guide s’occupant de « son » peuple, comme un berger de ses brebis ou un patriarche de ses enfants. On se demande comment celui qui fut docteur en philosophie, professeur agrégé puis maître de conférence en histoire de la philosophie à l’Université de Paris Sorbonne, peut se livrer à un aussi grossier révisionnisme et faire de Rousseau, et pire encore de Spinoza, enfant d’immigrés juifs portugais réfugiés en Hollande, des précurseurs du nationalisme et du populisme le plus étroit et le plus excluant.
Il est étonnant surtout de voir un philosophe invoquer « l’évidence », qui ressemble fort à la doxa, à « l’opinon commune », au préjugé – contre lesquels la philosophie s’est fondée. Ce à quoi devrait servir la philosophie politique, c’est avant tout à nous apprendre qu’en politique comme ailleurs, il n’existe pas la moindre « évidence » : tout est construit, et il existe en l’occurrence plusieurs manières, différentes, divergentes, antagonistes, d’envisager la politique. En particulier deux manières, qui s’excluent l’une l’autre :
– la politique peut être vue comme une activité qui, sur un territoire donné (la cité, polis), concerne tout le monde (les hommes sont tous des « animaux politiques », pour reprendre la formule d’Aristote), et qui est faite de concorde et de discorde ;
– ou bien elle est avant tout le domaine réservé d’une élite : « les politiques », chargés de « s’occuper » de « leur peuple », en apportant des réponses à « leurs préoccupations », leur « détresse » et surtout leurs peurs (et cette seconde option peut elle-même prendre diverses formes, suivant que le souverain se préoccupe du bien-être de l’ensemble d’une population, ou d’une partie : une ethnie, une communauté religieuse, une caste ou une classe parmi d’autres).
La première vision correspond grosso modo à ce qu’on vise sous le nom de démocratie : le peuple (démos) y est actif, il participe à la prise de décision, il exerce donc une forme de pouvoir (cratos), dans la mesure où il s’exprime, se manifeste et se bat. La seconde vision, celle que défend Monsieur Comte-Sponville, lui est antinomique : le peuple y est passif, en quelque sorte « infra-politique », et des tuteurs bienveillants s’occupent de lui. La vision démocratique pose comme « évidence » première l’égalité des capacités et sa nécessaire traduction minimale en une égalité devant la loi (dans un même pays), tandis que la seconde pose comme « évidence » la « préférence nationale » : la prise en charge prioritaire d’un groupe (les nationaux), au détriment d’un autre (les étrangers).
Il se trouve que cette seconde « vision du monde » est celle dont la traduction politique contemporaine la plus pure est incarnée par Le Pen, le Front National et tous les partis fascistes ou néofascistes, et que tout, dans le texte de Monsieur Comte-Sponville, s’inscrit dans cette vision fasciste et xénophobe du monde :
– la primauté de « l’intérêt national » sur l’universalité de la loi, la même pour tou.te.s ;
– la primauté du « peuple » sur le « pays » ;
– la fétichisation et l’essentialisation dudit « peuple », conçu comme homogène et soudé derrière un même et unique « intérêt national » ;
– la représentation misérabiliste de ce « peuple », passif et souffrant ;
– le monopole de l’action politique laissé à une élite dirigeante.
Monsieur Comte-Sponville finit sa leçon par une précision, en forme de dénégation :
« Ces évidences ne retirent rien, bien au contraire, au combat nécessaire contre le racisme (c’est d’ailleurs un tout autre problème : il y a des Français de toutes les races), ni aux droits de l’homme (dont doivent bénéficier aussi les immigrés, y compris en situation irrégulière). Mais cela, à nouveau, ne tient pas lieu de politique (fût-ce dans le domaine de l’immigration : vivre en France, cela ne fait pas partie des droits de l’homme) et ne suffira pas à vaincre Le Pen. »
On se contentera de rappeler que ces dénégations se retrouvent de manière quasi-identique chez les Le Pen eux-mêmes : Jean-Marie Le Pen comme ensuite sa fille ont toujours aimé, eux aussi, rappeler qu’ils n’étaient pas racistes puisqu’« il y a des Français de toutes les races ». On peut certes créditer Monsieur Comte-Sponville de davantage de bonne foi que les dirigeants d’extrême droite, et admettre qu’il se soucie réellement de tous les Français sans distinctions, mais il ne se démarque en revanche aucunement des Le Pen en termes de xénophobie : les Français d’abord, qu’on veuille ou non le reconnaître, cela veut dire les étrangers après.

Pour marquer sa différence, notre Comte-Sponville se penche tout de même, le temps d’une demi-phrase, sur le sort des « immigrés ». On peut noter au passage le caractère peu rigoureux, et politiquement douteux, de l’antinomie « français/immigrés », qui vient dans cet écrit à la place de l’antinomie français/étrangers. Tout se passe en somme comme si, pour Monsieur Comte-Sponville, il était inconcevable qu’un immigré soit français – alors que beaucoup le sont, par mariage ou naturalisation. Pourquoi ? Laissons cette question en suspens, mais rappelons que la philosophie est censée être l’apprentissage et la construction d’une pensée rigoureuse, attentive aux concepts et aux catégories qu’elle mobilise.
Venons-en pour finir au sort de ces « immigrés » qui doivent donc passer, d’après Le Pen et Comte-Sponville, après les Français. Que leur reste-t-il ? Il leur reste, nous dit le philosophe, les « droits de l’homme » – mais attention : en n’oubliant surtout pas que « vivre en France ne fait pas partie des droits de l’homme ». Ici encore, Monsieur Comte-Sponville reprend sans le savoir une formule fétiche de l’extrémiste qu’il prétend combattre. Et comme cet extrémiste, il occulte en disant cela les très réels problèmes de « droits de l’homme » que rencontrent les immigrés : car si vivre en France ne figure effectivement dans aucune Déclaration des droits humains (ce que personne ne soutient, au demeurant), il se trouve en revanche que vivre en France donne droit aux « droits de l’homme » dont la France se prétend « le pays » – et cela, qu’on soit français ou étranger, en situation régulière ou irrégulière. Vivre en famille, dans la dignité, accéder aux soins médicaux, plus largement être égaux en droits au travail, face à la police, face à la justice, tout cela fait partie des droits élémentaires de la personne humaine, et tout cela est constamment bafoué par les multiples pratiques administratives, policières et parfois judiciaires instituées depuis des décennies afin de défendre cet « intérêt national » si cher à notre philosophe : non-motivation des refus de visas, expulsions forcées, mises en rétention, mise sous condition de régularité du séjour pour certaines prestations sociales, double peine pour les étrangers condamnés en justice, et même une « préférence nationale » déjà en vigueur sur près d’un tiers des emplois (publics et semi-publics essentiellement). Tout ceci mériterait d’être développé, mais il est temps de conclure.
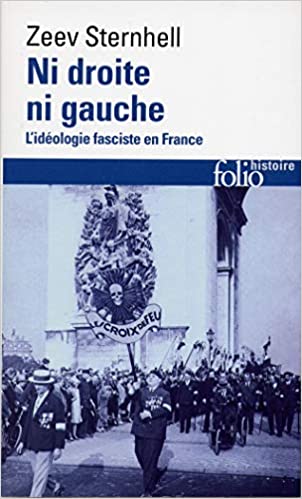
Monsieur Comte-Sponville ignore tout cela, et il déclare ne pas voir ce que pourrait être « une politique française qui ne défend pas, d’abord, les intérêts des Français ». Ce manque d’imagination, à lui seul, est parlant – et accablant. Notre philosophe demande, en une question rhétorique qui appelle la réponse « Bien sûr que non ! », si « c’est être fasciste » que de défendre l’intérêt national, mais la réponse est : bien sûr que oui, si cet « intérêt national » devient, comme il le préconise, le fondement et l’« évidence première » de la politique. Nous voici donc obligés de rappeler ce qui nous semblait pourtant une « évidence », notre évidence à nous : quoi que prétende notre Diafoirus, dire « les Français d’abord », c’est bel et bien « proférer une monstruosité ». Et pour reprendre d’autres mots de Monsieur Comte-Sponville, mais sans ses dénégations et sa méprisante ironie : un philosophe célèbre, enseignant à la Sorbonne, publiant des essais de philosophie morale et politique, s’est bel et bien « fascisé et déshonoré ». Tout en se rangeant, en toute modestie, dans le camp d’une « vérité » qui ne serait « ni de droite ni de gauche », il a proposé au grand public une « part de vérité » qui est d’extrême-droite, et qui rappelle un vieux mot d’ordre, né au début du vingtième siècle puis réactivé par le Front National : « Ni droite ni gauche, Français ».



