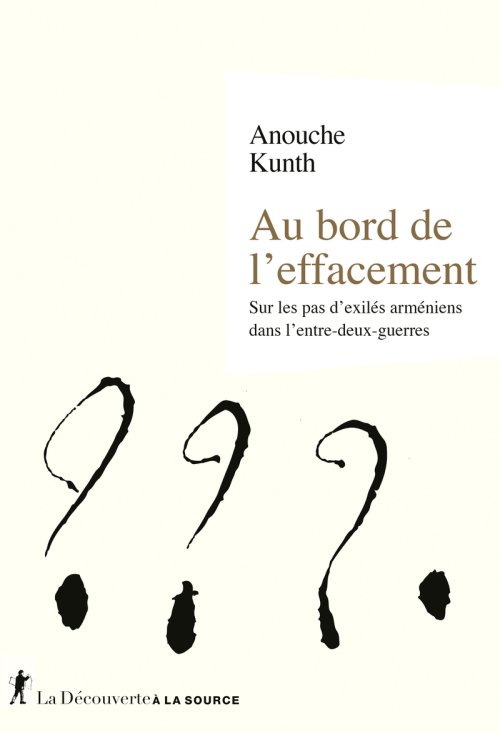Les certificats ajoutent une pièce de plus à l’édifice de papiers qui fait tenir ensemble le processus d’identification d’un résident étranger et la jouissance, par celui-ci, de droits sociaux [1]. « Pour servir et valoir ce que de droit »... Cette capacité s’exerce toutefois dans un cadre particulièrement restreint pour ces étrangers privés de nationalité que sont les réfugiés. Car, on s’en doute, jamais leur État d’origine ne s’est soucié de conclure en leur nom un traité bilatéral de réciprocité avec la France, destiné à protéger leur insertion sur le marché du travail, leur rémunération, leur santé, leur vieillesse...
À défaut, le directeur de l’Office des réfugiés arméniens s’y prend autrement dans son adresse aux autorités : il décrit une situation sociale. En creux, on devine l’existence en France de lois d’assistance qui pourraient soulager les difficultés pointées, y remédier peut-être. En creux encore, on comprend que ces lois de la République ne s’appliquent pas aux réfugiés, en l’absence de traité de réciprocité avec le gouvernement turc.
Boîte 4, année 1931. Duplicata rédigé à la main – phrases brouillonnes. Au sujet d’une veuve de 58 ans, arrivée à Marseille en 1923 avec sa fille et son gendre :
se trouve actuellement complètement abandonnée [rature] et vit de la charité de ses voisins. Elle prie [illisible] les autorités compétentes de bien vouloir lui délivrer une carte d’id. à titre gratuit d’indigente *.
L’écriture est tassée dans la marge, en pattes de mouche. Peu de mots pour constater ce grand dénuement, mais assez pour déduire qu’il n’ouvre pas accès au statut d’indigent. L’enjeu, par conséquent, consiste à obtenir de l’administration qu’elle aille au-delà de ses propres grilles statutaires pour considérer un état de fait. Celui d’une misère préoccupante, dont les vérités se perdent dans un point aveugle du droit mais ressurgissent comme par en dessous : tissées aux liens d’interconnaissance qui s’animent autour d’une réfugiée démunie pour lui apporter un secours quotidien.
Même boîte, autre malheur.
[mari et femme] se trouvent dans un état de détresse absolue, par suite de la maladie mentale de leur fils qui était leur unique soutien. Ces malheureux, incapables de travailler à cause de leur état de vieillesse avancée, sont dignes de la pitié des gens charitables.
En 1935, un certificat évoque à nouveau ce cas d’infortune en mettant l’accent, cette fois, sur l’infirmité du vieil homme. Personne n’ignore qu’en principe des dispositifs de solidarité nationale répondent à ces nécessités de protection : la loi de 1893 sur l’assistance médicale des malades pauvres, et celle de 1905 sur l’assistance aux vieillards, aux infirmes et incurables. Mais l’aide ne pouvant être invoquée ici sur un fondement juridique, il faut l’implorer au nom de la morale publique.
Le fils malade est non pas soigné ou hospitalisé mais « interné », déclare aussi le document de 1935 qui, ne pouvant se contenter d’être un certificat d’indigence, s’oblige à donner un peu de contenu au problème exposé. Son internement pour cause de « maladie mentale » laisse penser que le fils a été placé à l’asile Saint-Pierre de Marseille, dont les archives nourrissent un autre aspect de mon travail sur les exilés. Je me prends à espérer que ce fils soit un point de rencontre entre ces deux fonds, et que l’un apporte des intensités subjectives à celui qui en est presque dépourvu.
Dans mes notes sur les hommes placés d’office entre 1918 et 1942, son nom surgit. Et, dans la mêlée des observations médicales, se découpe la silhouette d’un jeune homme de vingt et un ans que sa famille « réclame inlassablement ». On le dit sujet à des excitations « anormales », comme ce jour où il brisa les fenêtres et la vaisselle chez lui, ou quand il se rendit à l’usine Saint-Louis pour y arrêter les machines (à lui, ce sont les raffineries de sucre qui paraissaient « anormales »). Il raconte aux médecins psychiatres ses troublantes visions oniriques (« explosions, vision d’eau et de bêtes »), leur parle de son désir de s’installer en Arménie soviétique, à Erevan. Il est vu « soliloquant ». C’est que, déplore-t-il, « le monde entier l’oblige à parler seul ».
Le directeur de l’Office arménien, comme d’autres représentants communautaires, s’implique pour attirer les ressources de l’Assistance publique au bénéfice des plus nécessiteux, mais sa voix ne saurait porter loin sans la réflexion engagée des juristes internationaux dont les travaux, lentement, charpentent le statut de réfugié apatride. Ces évolutions sont visibles dans la masse des certificats, où de nouveaux usages apparaissent sur la durée. Ainsi, à partir de la boîte 9, des certificats sont destinés aux services de l’Assistance obligatoire : au « service des hospices ou d’assistance publique », à l’« assistance aux vieillards », à l’« assistance aux familles nombreuses ».
Arrivent aussi des certificats pour le « service du chômage ». Alors que rien ne semblait varier d’un carton à l’autre, ces inflexions rendent soudain perceptibles les avancées par lesquelles la législation française aménage des droits aux réfugiés. Au vrai, elle ne fait qu’adapter les prescriptions de la convention de Genève de 1933, recommandant que la protection sociale des réfugiés soit égale au « traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger ». La boîte où ces changements sont manifestes mène à décembre 1936. Trois ans se sont donc écoulés avant que la France, le 20 octobre 1936, ne ratifie ladite convention, ce que le Journal officiel annonce dans son édition du 5 décembre. Le mérite en revient au Front populaire.