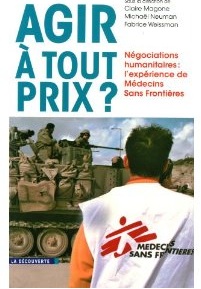
Contrairement à l’image popularisée par la presse et l’association, l’idée que le silence est une condition nécessaire à l’action est majoritaire parmi les fondateurs de MSF. La première charte de l’organisation (1971) stipule que ses membres s’interdiront « toute immixtion dans les affaires intérieures des États » et s’abstiendront de « porter un jugement ou d’exprimer publiquement une opinion – favorable ou hostile – à l’égard des événements, des forces et des dirigeants qui ont accepté leur concours ». À la question : « Un médecin témoin d’atrocités doit-il se taire ? » le médecin-colonel des sapeurs- pompiers, Gérard Pigeon, cofondateur de l’association, répond par l’affirmative dans un entretien accordé à L’Est républicain paru le 26 décembre 1971 : « Il faut être tout à fait clair : le médecin ne part pas comme témoin. Il ne va pas écrire un roman ou un article de journal, il vient soigner. Le secret médical existe, on doit le respecter. Si les médecins se taisent, on les laissera venir, sinon ils seront refoulés comme les autres. »
De fait, entre 1971 et 1975, la jeune association promeut une image dépolitisée mettant en avant le courage de ses volontaires et son efficacité technique médicale. C’est en 1977 qu’un représentant de MSF enfreint pour la première fois l’engagement statutaire à la confidentialité. Lors de son retour des camps de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise, Claude Malhuret dénonce sur la première chaîne de télévision française les « crimes révolutionnaires » des Khmers rouges, qui « exterminent des secteurs entiers du peuple au nom d’une voie communiste rénovée1 ». On ne trouve pas trace, dans les archives de MSF, des débats suscités par cette prise de parole qui entraîne pourtant une polémique, l’association recevant plusieurs lettres qui accusent ses dirigeants d’être des propagandistes à la solde de la CIA. Toujours est-il qu’en 1977-1978, l’engagement envers le « secret médical » est officiellement remis en question par les dirigeants de MSF. En 1978, le président annonce dans son rapport moral que les volontaires « rendront compte au bureau des violations des droits de l’homme et des faits inacceptables dont ils auront été témoins [...]. Le bureau décidera alors souverainement d’en informer l’opinion dans le cas où MSF aura été le seul témoin ».
Si une majorité de membres de MSF est favorable au « droit de témoigner », l’équipe dirigeante se déchire sur la place à lui accorder. Bernard Kouchner et une partie des fondateurs y voient la fonction première des « médecins sans frontières », qui doivent se garder de devenir des « bureaucrates de la misère, des technocrates de la charité2 ». L’action incombe aux États (démocratiques), que MSF doit se contenter de mobiliser à coups de tapage médiatique. Malhuret entend pour sa part ancrer le témoignage dans une pratique autonome et efficace de la médecine humanitaire, impliquant la professionnalisation de l’association. Mis en minorité, Bernard Kouchner quitte MSF en 1979.
La nouvelle équipe dirigeante utilise immédiatement le « droit de témoigner » au sujet du Cambodge en 1979-1980. Persuadée que le pays est en proie à une famine et que le régime provietnamien détourne l’assistance humanitaire, MSF réclame la distribution d’une aide massive sous contrôle international à partir de la Thaïlande. À cette fin, ses dirigeants lancent, le 20 décembre 1979, un appel à l’organisation d’une Marche pour la survie du Cambodge. Le 6 février 1980, une centaine de manifestants, parmi lesquels Rony Brauman et Claude Malhuret pour MSF, Bernard-Henri Lévy pour AICF (Action internationale contre la faim) et Joan Baez pour IRC (International Rescue Committee) se présentent à la frontière thaïlando-cambodgienne à la tête d’un convoi de nourriture. Sans surprise, ils sont refoulés. Plus nombreux que les manifestants, les journalistes couvrent abondamment l’événement, qui est dénoncé par le régime provietnamien et ses alliés comme une manifestation impérialiste et réactionnaire. La contestation se développe également à l’intérieur de MSF, où certains accusent la direction de s’être prêtée à une manipulation propagandiste des États-Unis, notamment en s’associant avec IRC (souvent considéré comme une officine de la CIA).
À ceux qui soutiennent que MSF doit « faire de l’humanitaire, pas de la politique », Malhuret répond : « C’est de la politique au bon sens du terme. Des types crèvent de faim au Cambodge, on ne peut pas intervenir. Si vous aviez su pour Auschwitz, auriez-vous fait l’autruche3 ? » La référence au rôle contesté du CICR pendant la Seconde Guerre mondiale est alors omniprésente dans les justifications avancées par Malhuret et Brauman, pour qui le totalitarisme communiste est la matrice des processus génocidaires contemporains. Or, à leurs yeux, la « détente » ne recouvre qu’une vaste offensive soviétique dans le tiers monde. À la fin des années 1970, l’ancienne Indochine est entièrement passée aux mains des alliés de Moscou et de Pékin, l’influence soviétique s’étend en Afrique (Angola, Éthiopie, Mozambique...), l’Amérique latine connaît plusieurs mouvements révolutionnaires (Nicaragua, Salvador, Guatémala) et l’Armée rouge envahit l’Afghanistan. Présente dans les camps de réfugiés, dont le nombre passe de 3 millions à 11 millions entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, MSF constate que 90 % d’entre eux fuient des régimes communistes.
Au regard des objectifs opérationnels affichés – assurer une distribution indépendante des secours –, la Marche pour la survie du Cambodge est un échec. Il se trouve qu’il n’y avait pas de famine, comme l’apprendra l’association quelques années plus tard. Non que les autorités aient distribué l’aide qui leur parvenait, mais tout simplement parce qu’il n’y avait pas de pénurie alimentaire généralisée. Contrairement à l’opinion générale, l’état de dénutrition des réfugiés arrivant en Thaïlande (qui avait déclenché l’alerte) n’était pas représentatif de la situation à l’intérieur du Cambodge 4. La Marche permet cependant à l’association de revenir sur le devant de la scène médiatique en posant un acte politique porteur d’au moins trois significations : en réclamant une distribution des secours indépendante, MSF affirme que, sans un minimum d’autonomie d’action, l’aide est condamnée à servir les intérêts des pouvoirs politiques au détriment de la population ; en s’adressant à l’opinion publique, et par son intermédiaire aux États, elle souligne que cette autonomie se gagne à l’issue d’un rapport de forces dans lequel pèse l’image des pouvoirs sur la scène internationale ; en mettant en scène le refus des autorités provietnamiennes, elle signifie que cette autonomie est inexistante dans les régimes totalitaires, où l’aide est condamnée à se transformer en instrument d’oppression. Neuf ans après la création de MSF sur la base du silence et de la neutralité, ses dirigeants font de la prise de parole publique une modalité de l’action humanitaire permettant de soutenir et de prolonger les politiques d’assistance.
Années 1980 : La guerre contre le communisme
La dénonciation des crimes de l’Armée rouge en Afghanistan est emblématique de la pratique du témoignage comme prolongement de l’action médicale. Présente dans les maquis afghans depuis 1981, MSF doit faire face aux contraintes logistiques et sécuritaires associées au caractère clandestin de sa mission mais aussi aux stratégies politiques et militaires tribales des chefs de guerre afghans : « Les relations avec les moudjahidines nous donnaient infiniment plus de fil à retordre que l’Armée Rouge5 », rapporte Juliette Fournot, principale responsable de la mission. Pourtant, MSF ne prend pas la parole pour critiquer les entraves à l’action imposées par la résistance afghane ; elle dénonce les bombardements massifs, le largage de mines antipersonnel, l’incendie des villages et des récoltes par les forces d’occupation soviétiques. « En dénonçant ce qui se déroulait là-bas, nous “soignions” davantage de gens qu’en portant assistance à quelques Afghans que nous pouvions atteindre. Alertant l’opinion publique, nous mettions les politiques face à leurs responsabilités, nous les contraignions à intervenir pour arrêter le massacre6 », estimera Malhuret des années plus tard.
Pour les dirigeants de l’association, « mettre les politiques face à leurs responsabilités » signifie, dans le contexte de la guerre froide, appeler les démocraties libérales à redoubler d’efforts dans la lutte contre le communisme7. À cette fin, Malhuret se rend plusieurs fois aux États-Unis entre 1983 et 1985, à l’invitation d’intellectuels néoconservateurs et du sénateur républicain Gordon J. Humphrey. Ce dernier est l’un des promoteurs de l’« opération Cyclone », par laquelle la CIA équipe et finance la résistance afghane entre 1979 et 1989. La médiatisation de l’action de MSF en Afghanistan et de ses récits sur les exactions de l’Armée rouge alimente alors l’entreprise de réarmement moral lancée par les intellectuels néoconservateurs et l’administration américaine à partir du milieu des années 1970. Profitant du nouvel engouement politique pour les droits humains qui saisit une Amérique en quête de purification morale (retour du religieux, malaise de l’opinion à l’égard des atrocités commises au Vietnam, scandale du Watergate), ils utilisent les mouvements de défense des droits humains dans la guerre idéologique contre le communisme (soutien aux dissidents soviétiques, au syndicat polonais Solidarnos ́c ́, aux signataires de la Charte 77 en Tchécoslovaquie, etc.)8. MSF reçoit plusieurs financements de la NED (National Endowment for Democracy), fondation destinée à exporter le soft power américain par le biais d’organisations de la société civile.
La NED n’est pas flouée. En 1984, MSF crée la fondation Liberté Sans Frontières (LSF), centre de recherche sur les questions de développement et de droits humains. Son comité scientifique est composé de penseurs de la droite libérale et atlantiste, issus pour la plupart du comité de rédaction de la revue Commentaire, fondée par Raymond Aron. En 1985, LSF organise un colloque, « Le tiers-mondisme en question », dans lequel est fustigé ce qu’elle considère comme le prêt-à-penser idéologique du milieu de l’aide : le tiers-mondisme, qui, au nom de l’anti-impérialisme, justifierait l’alignement aveugle des ONG derrière les gouvernements issus des indépendances alliés de Pékin ou de Moscou. « Le discours de LSF est profondément imprégné des idéologies dont il prétend être dégagé ; il ne se situe pas ailleurs mais en un lieu bien précis, celui de la pensée reaganienne et proaméricaine », commente Alain Gresh dans un cahier spécial du Monde diplomatique en mai 1985.
Parallèlement à la dénonciation des crimes du totalitarisme, MSF prend la parole dans les années 1980 pour tenter de s’extraire des situations où elle estime que l’aide humanitaire « joue un jeu pervers » au point d’être « complice d’une politique criminelle9 ». En 1984-1985, l’Éthiopie est le théâtre d’une famine et d’une importante opération de secours. Celle-ci est financée par les États occidentaux et les donateurs privés mobilisés par une campagne médiatique sans précédent qui culmine avec l’organisation, par le chanteur Bob Geldof, du concert Live Aid. Au premier semestre 1985, MSF, qui mène des activités nutritionnelles et hospitalières dans plusieurs camps accueillant des dizaines de milliers de personnes fuyant la famine, comprend que les centres de distribution de nourriture sont des pièges : les autorités exercent un chantage à l’aide alimentaire, réservant celle-ci aux familles qui acceptent de participer à un programme de réinstallation du nord vers le sud du pays, visant principalement à dépeupler les zones rebelles. Les récalcitrants sont embarqués à la pointe du fusil.
MSF estime qu’au moins 100 000 personnes sont mortes au cours de leur transfert et durant les trois premiers mois de leur réinstallation. En septembre 1985, elle lance une campagne d’opinion, appelant – sans succès – les bailleurs de fonds et les organisations humanitaires à constituer un front commun pour exiger un moratoire sur les déportations, qui tueraient plus que la famine elle-même. Un mois plus tard, elle est expulsée d’Éthiopie.
Si cette prise de parole finit par se confondre avec la dénonciation des désastres du totalitarisme, elle procède d’une démarche différente des interventions publiques concernant l’Afghanistan. Elle n’entend pas prolonger l’action de secours, mais mettre en cause l’enrôlement de celle-ci dans la mise en œuvre de programmes meurtriers. Par le biais de l’opinion, MSF s’adresse à l’ONU, aux ONG et aux États occidentaux, dont elle vise à transformer les pratiques d’assistance afin que celles-ci ne dépassent pas « la limite, floue mais bien réelle, au-delà de laquelle l’aide aux victimes se transforme insensiblement en soutien aux bourreaux10 ».
Au final, dénonçant le totalitarisme communiste comme l’origine des plus grands désastres humains et du retournement de l’action humanitaire contre ses bénéficiaires, MSF fait cause commune pendant la guerre froide avec le camp libéral. Elle inscrit son action dans le combat pour les droits humains et la démocratie : « Même imparfaits, les [systèmes politiques libéraux] sont les seuls de l’histoire ayant permis des avancées importantes sur le plan des libertés et de la justice sociale11. » Dans cette ligne, l’association se porte candidate, en 1988, au prix européen des droits humains, décerné par le Conseil de l’Europe. Estimant que celui-ci constituerait une « reconnaissance morale donnant plus de poids à [ses] interventions dans le tiers monde12 », elle fait valoir que « depuis ses origines, MSF inscrit son action dans le cadre de la promotion et de la défense des droits de l’homme » : par son action, elle répond au « droit des populations à avoir accès aux soins médicaux », par sa présence, elle joue un « rôle dissuasif déterminant pour éviter les atteintes aux droits de l’homme ». Elle se réserve enfin le « droit de témoigner publiquement sur les exactions dont ses équipes ont connaissance lorsqu’elles se trouvent seules sur un terrain où les observateurs extérieurs ne peuvent enquêter13 ». Le prix – triennal – est décerné en 1989 à Lech Waleçsa, avant d’être attribué en 1992 à MSF.
Voir la deuxième partie.


