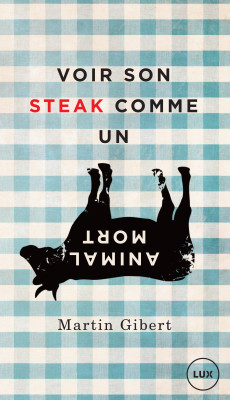
Quatrième partie « mais les véganes sont sectaires »
On peut aussi botter en touche. Il s’agit d’appeler en renfort certaines croyances morales – qui, dans le cadre de la dissonance cognitive, feront office de cognitions consonantes. Ainsi, les gens réagissent souvent aux arguments pro-véganes en soulignant qu’il existe des problèmes plus graves que la souffrance animale. Dans le monde, tous les jours des enfants meurent de la pauvreté et des femmes sont battues.
Ce genre de faux dilemmes (puisqu’on peut évidemment se soucier de la souffrance animale et humaine) vise à conforter celui qui le pose dans son statut d’agent moral. Il met ses priorités au bon endroit : les femmes et les enfants d’abord, et loin devant les vaches et les cochons. Pourtant, comme on le verra dans le prochain chapitre, les véganes sont habituellement très sensibles aux souffrances des humains. Il n’y pas lieu de jouer le jeu de la concurrence victimaire.
Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres. Depuis le « ça coûte trop cher d’être végane [1] » jusqu’au « mais ce n’est pas un individu qui va changer le système », il existe toute une panoplie de croyances plus ou moins élaborées que les gens mobilisent pour tenter d’accorder leur respect des animaux et leur désir d’en manger. Certains esprits facétieux en ont même fait un jeu, le « Bingo de l’omnivore ». Il faut dire qu’on peut vite se lasser d’entendre à longueur de « débats » les mêmes « arguments ».
Le plus commun est sans doute l’affirmation selon laquelle « les plantes aussi sont sensibles » : c’est le fameux cri de la carotte dont le caractère drolatique disparaît après quelques occurrences. Comme le rappelle le jeune chercheur en philosophie
Frédéric Côté-Boudreau, il ne faut pas confondre la capacité des plantes comme êtres vivants à réagir à leur environnement et la « sentience ». Contrairement aux animaux, et jusqu’à preuve du contraire, les plantes n’ont pas d’expérience subjective du monde, elles ne l’éprouvent pas. Elles ne possèdent donc pas d’intérêts à proprement parler – dont celui à ne pas souffrir.
Les découvertes récentes sur leur capacité à communiquer – via des messagers chimiques – ne signifient pas que les plantes peuvent souffrir. Notre système immunitaire, par exemple, communique lui aussi avec nos différents organes ; cela n’implique pas qu’il soit sentient et qu’il ait des intérêts propres.
En définitive, pour Frédéric Côté-Boudreau, l’argument de la souffrance des plantes vise à « animaliser les plantes pour mieux subordonner les animaux [2] ».
Dire qu’il y a des problèmes plus graves (comme la souffrance des plantes !), c’est comparer la souffrance animale à d’autres maux afin d’en relativiser l’importance. On peut aussi appeler le relativisme moral à la rescousse. Il s’agit de soutenir que le bien et le mal n’existent pas en eux-mêmes, mais qu’ils sont relatifs aux individus ou
aux groupes. Il s’ensuit que la souffrance et les intérêts des animaux ne méritent pas d’être considérés parce que nous ne possédons pas de critère universel pour distinguer le bien du mal.
Platon l’avait déjà remarqué, le relativiste moral est rarement conséquent avec ses prémisses. Il reconnaît assez vite que certaines actions sont meilleures que d’autres et qu’il vaut la peine d’argumenter lorsqu’on est face à un dilemme moral. D’ailleurs, celui qui justifie sa consommation carnée à l’aide du relativisme moral suit souvent un double standard : il ne doute pas une seconde qu’il serait mal de mettre bébé dans le micro-ondes.
Je crois aussi qu’il existe une propension assez française à ne pas prendre au sérieux les questions morales [3]. J’ai souvent été frappé de voir des intellectuels français afficher une sorte de mépris pour « la morale ». Ils la considèrent sans doute, dans une certaine tradition marxiste, comme une superstructure qui masquerait la réalité politique, économique et sociale. L’appel à des valeurs morales est alors reçu avec un sourire en coin et l’air entendu de celui qui connaît le sens de l’Histoire (mais pas la métaéthique).


